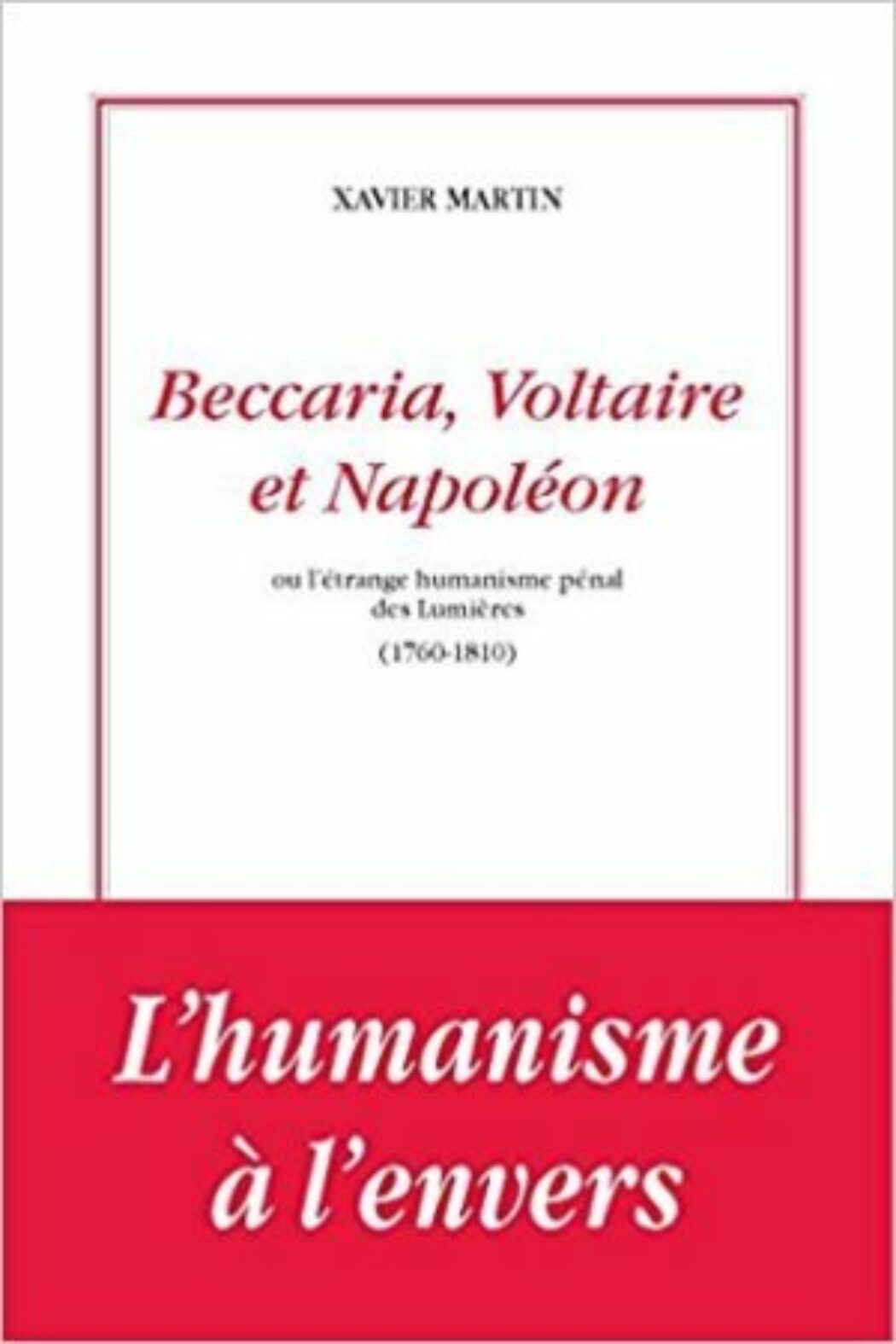Questions à Xavier Martin à propos de son ouvrage sur Beccaria, Voltaire et Napoléon :
Beccaria est généralement connu comme le juriste qui a le plus fait pour l’abolition de la peine de mort. Pourquoi remettez-vous en cause cette vision ?
Cesare Beccaria (1738-1794), jeune aristocrate milanais, auteur en 1764 d’un petit livre foisonnant intitulé Des délits et des Peines, y dénonce notamment l’inutilité des supplices qui accompagnent ordinairement la peine de mort, et souligne aussi l’inutilité de celle-ci même, qui prive sottement la société de la force de travail du condamné. L’atmosphère de l’écrit est donc à coup sûr abolitionniste, et les philosophes des Lumières français se sont d’emblée enthousiasmés pour cet écrit et son auteur, ipso facto promu et encensé comme parangon d’un humanisme de combat. Premier malentendu ! Que l’on relise la première phrase de cette réponse, et l’on conviendra que ce Beccaria, en homme de son temps, n’est pas motivé par l’humanité, mais par l’utilité. Jeremy Bentham (1748-1832), géant de l’utilitarisme, s’est reconnu précisément sans équivoque une dette majeure, doctrinalement, envers Beccaria. La grande et symbolique formule-programme de Francis Hutcheson (1694-1746), « Le plus de bonheur possible pour le plus grand nombre », qui chez Bentham a fait bannière, et dont lui-même assez souvent est crédité, celui-ci l’aura découverte, relevée d’italiques, dès le second alinéa du livre de Beccaria.
Bref, il peut donc être utile, selon ce dernier, de ne pas tuer le criminel, pour le faire travailler. Mais il est à souhaiter, en tant qu’utile tout aussi bien, pour impressionner l’opinion publique et pour tenir tout un chacun dans la voie droite, que la condition de ce condamné soit rude et pénible, et même inhumaine. Jugeons-en : Beccaria prône expressément, comme châtiment de substitution à la peine de mort, une « peine d’esclavage perpétuel », « le long et pénible exemple d’une homme […] transformé en bête de somme », donc dans les fers, et dans les chaînes, « et sous le bâton ». C’est là un « humanisme » très particulier ! Voltaire – il est de ceux qui ont à cœur de faire connaître Beccaria – verrait bien, quant à lui, le forçat perpétuel « chargé de chaînes et de coups de fouet ». Diderot, de son côté, imagine le condamné à mort offert vif au scalpel farfouilleur d’un naturaliste affamé d’apprendre, – et gracié s’il en réchappe ! La prétendue humanité, observe-t-on, n’a rien à voir avec tout ça, dont rend compte, au contraire, l’anthropologie des Lumières, qui réduit l’homme à l’organique, à l’animal. J’ai souvent évoqué, dans mes divers ouvrages, l’importance méconnue de cette spectaculaire mais très inaperçue déshumanisation par l’esprit « éclairé », qui se targue là d’être « scientifique », et d’échapper donc à l’obscurantisme de la Genèse. Faut-il ajouter que le vulgarisateur en chef de cette vision de l’homme, au siècle des Lumières, c’est Helvétius, relativement auquel Beccaria puis Bentham – tout est donc cohérent – ne tarissent pas d’éloges. Lui et Beccaria, qu’il a dessillé, ont ensuite conjointement influé, au tout premier chef, sur Bentham lui-même.
Un second malentendu achemine à serrer de plus près votre question. En matière d’abolition de la peine de mort, estimerons-nous, il n’y a pas de demi-mesure : l’abolition est absolue, ou elle n’est pas. Or Beccaria tend à souffrir des exceptions, et qui plus est, des exceptions mal circonscrites ! La peine de mort, il la concède, d’une part, en certaines conjonctures d’anarchie politique (ce qui n’a rien de rassurant), et d’autre part, lorsqu’elle constitue « le seul véritable frein pour détourner les autres de commettre des délits ». Voilà un critère fort incirconscrit. Comment, dès lors, oser parler d’abolition ? Ultime posture de Beccaria, sur la question : hostilité, oui, à la peine de mort, sauf cas de « nécessité positive ». Nous voilà fameusement avancés. Pastichant Malebranche au sujet de Descartes, on pourrait écrire : « M. Beccaria a quitté la partie là-dessus ».
L’ « abolitionnisme » des philosophes est du même tonneau. Condorcet, qui voit la peine de mort « absolument injuste », n’en agrée pas moins – étrange absolu– l’exception des cas « où la vie du coupable peut être dangereuse pour la société ». Voltaire et Diderot ? Ça dépend des jours. Tantôt ils sont hostiles, et tantôt favorables à la peine capitale. Levés d’un certain pied, ils déplorent qu’on « tue inutilement de beaux hommes, qui peuvent être utiles », qu’on prive la société d’un « homme sain et vigoureux, de trente ans », d’une « fille belle et bien faite », a fortiori « d’une rare beauté » : le tout, bien sûr, mérite surtout qu’on en sourie. Ne songe-t-on pas ici à un texte grinçant de Barbara, supposée « femme de président », et encline à gracier « si la photo est bonne » ? Levés d’un autre pied, nos deux philosophes en tiennent sans façon pour la peine suprême. Voltaire alors, à l’occasion, ne rechigne pas à l’adjuvant des pires supplices. Pour les cas graves, il veut « une mort dont l’appareil soit effroyable », allant un jour jusqu’à confier : « J’aurais condamné sans regrets Ravaillac à être écartelé ». Voltaire, Diderot… ou Beccaria passent donc volontiers, sous un tel rapport, pour le contraire parfois violent de ce qu’ils sont ! Tout cela, vraiment, est-il sérieux ? Bouquet final et symbole fort de ce réel manque de sérieux : doit-on rappeler que Robespierre avait été non sans ferveur, à la Constituante, un des rarissimes abolitionnistes ?
À suivre votre critique de l’utilitarisme moderne, on a l’impression que la vision classique de la peine – jusqu’à la peine capitale – respecte mieux la dignité humaine que la vision moderne. N’est-ce pas paradoxal ?
À proprement parler il n’y a pas, dans mes écrits, de « critique » des auteurs du passé, des acteurs observés, des courants étudiés. Ainsi, bien que certains m’en félicitent, et quoique je les préfère à ceux qui me le reprochent, je ne « critique » ni les Lumières, ni la Révolution. Tel n’est pas mon objet d’historien. Simplement constaté-je, non sans quelque étonnement, que la version académique qui en prévaut (dans l’enseignement et les médias) est massivement en désaccord avec les sources : ou bien beaucoup d’entre elles, de première importance, qu’on croit archiconnues, demeurent inexplorées, ou bien on leur fait dire, sur des points décisifs, le diamétral contraire de ce qu’elles nous indiquent, et qui est pourtant clair, dénué d’ambiguïté. Mes tentatives de démonstration se placent toujours au niveau de l’établissement des faits ; ce qu’elles comportent éventuellement de subjectif tient uniquement, je le redis, à l’étonnementde voir consacré, par la rhétorique officielle, l’exact inverse de ce qu’indiquent, au premier degré, des sources riches, très suggestives, et concordantes.
L’utilitarisme moderne ? Par-devers moi, je n’en pense pas nécessairement que de bonnes choses, mais ça n’a pas grande importance, et mon ouvrage ne le critique pas : il s’étonne que prosaïquement, cet utilitarisme soit l’essentiel inspirateur de choix pénaux derrière lesquels on préfère voir et révérer, ingénument, un humanisme imaginaire, mais qui rassure. Beccaria, Voltaire, prophètes inspirés de cet humanisme ? Leur réduction du criminel à un statut de « bête de somme » fouettable à loisir, claironne assez l’anomalie d’une telle vision. Ceci noté, il n’est nullementparadoxalque de la sorte, l’inspiration moderne soit très déficitaire en respect de la dignité humaine : ses fondements mêmes, radicalement, sont négateurs par hypothèse de cette dernière ; réduction de l’homme à l’organique, à l’animal, au machinal, de toute vie intérieure au jeu des sensations, et négation du libre arbitre, tels sont les fondements de l’anthropologie des Lumières[1]. Faut-il redire le mot de Diderot ? Il a l’intérêt de tout condenser : « L’homme et l’animal ne sont que des machines de chair ou sensibles ». Dans un tel décor anthropologique, une « dignité humaine » n’a pas où se nicher. Et se pose le problème du fondement des « droits de l’homme », auxquels en fait, et logiquement, les révolutionnaires sont bien moins attachés qu’il n’est usuel de le croire. Et les « dérives » actuelles de la bioéthique ne méritent pas ce nom, puisque celle-ci découle, par lignée naturelle et quasi-nécessaire, de la conception scientiste de l’homme que nous évoquons.
Ceci étant, pour dissiper une équivoque qui pourrait naître de votre question et de ma réponse, reste à donner une précision. La « vision classique » de la peine que vous évoquez, ne saurait cautionner certaines extrémités qu’ont supprimées, ou achevé de supprimer, les réformes modernes du droit pénal. Je vise bien sûr là supplices et torture. Le discours pénal des philosophes du XVIIIesiècle, et parfois encore l’historiographie qui en est issue, grossit très indûment la « barbarie » du droit royal en la matière, et par exemple la campagne de Voltaire dans l’affaire Calas est un tissu de faux-semblants ; mais, de par divers traits, l’indignation suscitée par la condamnation du chevalier de La Barre (1765-1766) ne saurait être désavouée, et logiquement a pesé lourd, et pèse encore, dans le discrédit – très globalement et fortement exagéré, redisons-le – du droit pénal traditionnel en 1789.
Ce qui m’a le plus frappé dans votre livre, c’est de constater que Beccaria, les penseurs des « Lumières » et Bonaparte, aussi différentes que soient leurs conclusions pratiques, partageaient les mêmes principes anthropologiques. Comment expliquez-vous cela ?
L’esprit de leurs conclusions pratiques, c’est vrai, peut être vu comme différant radicalement. Mais c’est surtout à première vue, donc de façon superficielle, ce qui dissout en fait la radicalité. Le législateur révolutionnaire de 1791, date du premier Code criminel, dans la lignée de Beccaria et des Lumières tels que perçus ou ressentis par l’opinion, incline à un certain discours d’indulgence, de bienveillance philanthropique, et rompt en tout cas avec les supplices. Le législateur napoléonien, quant à lui, en phase avec une opinion publique harassée de désordres sociaux, donc réceptive dorénavant sans restriction aux vocalises de la sirène « sécuritaire », ce législateur renoue sans complexe et progressivement avec certaines sévérités à forte charge symbolique, dont l’efficace et inhumaine « marque » corporelle. Rupture évidente ? Si l’on veut, bien sûr, mais exclusivement au premier degré. Car en quoi, au fond, n’est-elle qu’apparente, à tout le moins superficielle ? En ceci que l’inspiration, de Beccaria au Code pénal de 1810, est constamment utilitaire, et que ce qui varie – assez naturellement – avec la conjoncture, n’est que l’appréciation de ce qui est utile. Efficacité, exemplarité, sont les maîtres mots du législateur en matière pénale, de 1789 à 1810. Dans de telles conditions, la même technique pénale sévère, d’abord supprimée en tant qu’inutile, peut très bien ressurgir si l’expérience consécutive suggère des raisons de la croire utile. C’est d’une logique élémentaire. L’impression première, pour qui s’y laisse prendre, est de rupture nette et spectaculaire. Mais les principes inspirateurs n’ont pas varié. À l’échelle historique, la rupture en question apparaît donc seconde, elle est occasionnelle et quasi-accessoire, c’est jusqu’à l’extrême qu’elle est pour le moins relativisée.
Varié, ces principes, ils l’ont d’autant moins, que le soubassement anthropologique – vous le rappeliez – n’a nullement bougé. La chose est trop peu sue, ou de façon trop lâche : Bonaparte est un homme des Lumières, il en est même exemplairement un concentré. La possible surprise qu’induit cette assertion, ne peut être d’emblée que très édulcorée par le rappel de l’idéal des philosophes du XVIIIeen matière politique : à savoir le fameux « despotisme éclairé », notamment incarné par les énergiques personnalités de Frédéric II et de Catherine II, beaux spécimens d’autocratie. Mais un tel argument, tactiquement efficace et presque suffisant, risquerait de masquer l’essentiel, qu’il nous faut au contraire marteler : comme il est normal, le jeune Bonaparte a été nourri au lait des Lumières. Il est donc empreint de leur anthropologie réductrice telle qu’évoquée un peu plus haut et davantage (la réduction à la matière, au mécanique, à l’animal, aux sensations, l’absolue souveraineté de l’intérêt dans les comportements etc.), et ce d’autant plus que tout ce corpus est en profondeur de fibre scientiste, et que sa formation d’officier d’artillerie ne l’a pu pétrir que de sciences physiques et mathématiques. La vision réductrice de l’humain transpire souvent dans ses propos, et non sans un relief qu’accentue volontiers le caractère expéditif et cavalier qui fait son charme spécifique dans la façon de s’exprimer.
Sous sa botte, l’atmosphère législative pénale n’en est donc plus à cette philanthropie au moins verbale des constituants, qu’en plein Conseil d’État il qualifie un jour d’ « humanité d’opéra ». Concomitamment, corrélativement, la rhétorique, à la tribune parlementaire, ne rechigne pas à bestialiser le criminel. En cela, peut-on croire par approche conformiste des choses, et trop peu avertie du dossier, l’on est fort éloigné des Lumières : n’en est-on pas même à leur antipode ? Eh bien ! non, pas du tout. Cette réponse négative, les propos qui précèdent nous y ont préparés. Une illustration voudrait achever d’en persuader. Lors de l’ébauche première d’un nouveau Code pénal au cours du consulat, un rapporteur fait valoir que la marque est de ces « châtiments qui font la plus vive impression sur des hommes grossiers ». Ainsi parle Target (1733-1806), un des plus grands juristes de son temps. Cet accent n’est-il pas typique éminemment de l’esprit répressif napoléonien, donc d’une réaction caractérisée contre les Lumières ? À première vue c’est vraisemblable, et c’est pourtant plus que douteux. Car ce même Target, en 1789, au comité criminel de la Constituante, a contribué personnellement à équiper la grande Déclaration des Droits de précieuses garanties pénales. Et puis surtout, auparavant, comme avocat, on l’a vu à la pointe de quelques grands combats juridiques de son siècle. Son engagement dans l’affaire Sirven, lui a valu l’estime appuyée de Voltaire. Or lorsque Target, en 1801, plaide pour un retour à des moyens durs qui fassent « impression sur des hommes grossiers », en réalité il ne s’exprime pas autrement que son aîné Voltaire, prônant trente ans plus tôt un châtiment corsé « qui fasse impression sur ces têtes de buffle », ces mêmes êtres grossiers qu’il est recommandé par mesure préventive, toujours selon Voltaire, d’ « emmuseler comme des ours ». Bref, derrière le discours sécuritaire « musclé » de la séquence napoléonienne, c’est toujours la vision réductrice de l’humain héritée des Lumières ; et c’est, tout bien pesé, quant aux options pénales, des « conclusions pratiques » moins éloignées des leurs qu’on n’est conditionné à le croire.
Un autre aspect est remarquable dans cet ouvrage, c’est l’enquête sur ce qui est véritablement dû à Beccaria. Peut-on aller jusqu’à dire que Beccaria est une sorte de symbole utile pour les « philosophes » dans leur attaque de l’ordre social traditionnel, mais dont on se moque de la pensée profonde ?
Comme vous en faites rappel, il est un relatif mais trop réel problème d’attribution du fameux Des Délits et des Peines. Problème à deux degrés. D’une part, Beccaria travaillait dans et avec un petit groupe de jeunes hommes, comme lui impatients de secouer le milieu des notabilités milanaises dont ils émanaient. Parmi eux, ses bons amis les frères Verri, Pietro et Alessandro : il ne fait aucun doute qu’ils ont contribué à la genèse du livre en cause, et spécialement Pietro, qui plus âgé de dix années que les deux autres, avait un rôle, informellement, de direction intellectuelle. Il y a sûrement, dans Des Délits, du propre fonds de Pietro, possiblement beaucoup, probablement fort peu, et l’on n’en peut dire plus… Détail anecdotique, mais significatif : le rapide succès international du livre en question a suscité la jalousie des deux Verri, qui sont devenus hypercritiques sur la personne de Beccaria (leurs médisances, à son endroit, sont volontiers assaisonnées, donc pittoresques), et simultanément ils lui ont fait reproche, – allez arranger ça, – et d’avoir produit un livre médiocre, et d’en accaparer impudemment le mérite !
D’autre part, le Des Délits et des Peines qui instantanément a rayonné sur toute l’Europe n’est pas l’original en italien, mais une traduction française par l’abbé Morellet (1765), qui était de ces philosophes parisiens si entichés de Beccaria, mais n’était pas le plus malin. Rarement l’adage traduttore, traditore conviendrait mieux. Morellet, soucieux peut-être de donner une leçon de clarté française à ce jeune Lombard un peu exalté, a « amélioré » le texte premier, modifiant l’ordre des matières et ajoutant ponctuellement de son cru. À ces inconvenances, perpétrées au nom de l’inévitable « utilité », Beccaria semble avoir mollement consenti un accord de passivité, – presque d’indolence ? Les retombées de l’épisode ne sont pas minces. Selon Philippe Audegean, qui ces dernières années a donné une impulsion puissante, en France, au renouveau des études « beccariennes », le texte mythique, « déjà palimpseste » (allusion à l’apport, problématique à circonscrire, de Pietro Verri), Morellet s’en mêlant, « devient apocryphe et le reste pendant deux siècles ». L’aura de Beccaria internationalement ne va donc faire tache d’huile que « sur fond de trahison », Morellet s’étant « rendu coupable de l’un des détournements de texte les plus lourds d’effets de toute l’histoire des littératures ». Non, ce connaisseur ne mâche pas ses mots. Le tout est très complexe, et comme inextricable. On a aujourd’hui, bien sûr, une traduction française fidèle du texte en cause, et c’est beaucoup. Demeure le mystère du nombre et de l’ampleur des interférences de la plume de Pietro Verri. Sauf entreprises exorbitantes d’érudition réitérées, la sagesse est de continuer à citer Beccaria comme l’auteur de chaque phrase de l’ouvrage, en n’oubliant pas qu’une part élastique d’approximation obère cette option.
Peut-on dire que l’utilitarisme et le réductionnisme de Beccaria ont triomphé ?
Oui et non. Sans conteste ils ont triomphé, mais ne sont pas, ou ne sont guère, ceux de Beccaria. Entendons-nous. Celui-ci a une vision utilitaire et réductrice de l’être humain, mais il n’est, en cela, qu’un reflet très banal de son temps. Le double courant dont vous faites état y est très ample et très puissant, et il déborde infiniment la seule personne et l’œuvre seule du Milanais, et n’a donc pas besoin de lui pour s’imposer, y compris sans doute en matière pénale, où l’évolution, imaginerons-nous, aurait eu lieu de toute manière, peut-être même à bref délai. Cela est si vrai que sur le vif, redisons-le, il a passé pour autre chose que ce qu’il était et prétendait être : pour un parangon de philanthropie. Target, lorsqu’il en tient – avons-nous dit – pour le retour à des techniques très répressives à l’ancienne mode, reproche gentiment à Beccaria d’avoir théorisé en « ne consultant que son cœur », ce qui n’est pas vrai. S’exprimant ainsi, ou bien il ignore l’exacte démarche du réformateur, ou, la connaissant, il se laisse aller par paresse mentale à la somnolence des idées reçues qui l’ont altérée. Tout cela est délicat. À la limite, on en viendrait à l’idée d’un mérite historique presque nul de Beccaria. Comprenons qu’on hésite à aller jusque-là. Et notons pourtant qu’Adhémar Esmein, pionnier français de l’histoire pénale, et féru de Voltaire, tend nettement à conclure en ce sens : les idées de Beccaria, estime-t-il au total, « ne sont pas en réalité bien hardies ; elles ne sont pas beaucoup au-delà de ce que demandait jadis le président de Lamoignon » – oui, Lamoignon (1617-1677), premier président du Parlement de Louis XIV, et décédé un petit siècle avant Des Délits et des Peines !
Au demeurant, le durable triomphe de l’utilitarisme et du réductionnisme des Lumières excède beaucoup, de toute façon, la chose pénale. Sous un discours essentiellement superficiel sur les droits de l’homme, la réduction de l’être humain à l’organique, avec ses lourdes retombées axiologiques, a traversé le XIXepar le vecteur de la médecine. La « science » raciale qui a produit ce que l’on sait en est issue, et nos « progrès » contemporains en matière de bioéthique (et notamment d’immolations anténatales) procèdent strictement de ce même filon[2]. Il reste que ces évidences élémentaires sont difficiles à faire entendre.
[1]Voir notre premier livre Nature humaine et Révolution française…, Editions Dominique Martin Morin (DMM), 3eéd., Poitiers, 2015, et les suivants.
[2]Voir nos ouvrages Régénérer l’Espèce humaine. Utopie médicale et Lumières, 1750-1850, Bouère, Éditions Dominique Martin Morin (DMM), 2008, et Naissance du sous-homme au cœur des Lumières (Les races, les femmes, le peuple), Poitiers, même éditeur, 2014.