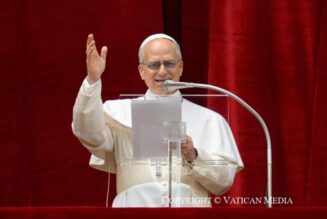Réagissant à la tribune libre publiée hier par BarthelemyLP, un prêtre m’envoie une sélection de textes de Léon XIV sur la Croix :
9 juin 2025 – Homélie du Pape Léon XIV lors de la Messe en la fête de Marie Mère de l’Eglise. Jubilé du Saint-Siège
[…] Commençons par le récit fondamental, celui de la mort de Jésus. Jean, le seul des Douze présent au Calvaire, a vu et témoigné que sous la croix, avec les autres femmes, se trouvait la mère de Jésus (v. 25). Et il a entendu de ses oreilles les dernières paroles du Maître, parmi lesquelles celles-ci : « Femme, voici ton fils ! », puis, s’adressant à lui : « Voici ta mère ! » (v. 26-27).
La maternité de Marie, à travers le mystère de la Croix, a fait un bond en avant inimaginable : la mère de Jésus est devenue la nouvelle Ève, car le Fils l’a associée à sa mort rédemptrice, source de vie nouvelle et éternelle pour tout homme qui vient en ce monde. Le thème de la fécondité est très présent dans cette liturgie. La « collecte » l’a immédiatement mis en évidence en nous invitant à demander au Père que l’Église, soutenue par l’amour du Christ, « soit toujours plus féconde dans l’Esprit ».
La fécondité de l’Église est la même que celle de Marie ; elle se réalise dans l’existence de ses membres dans la mesure où ils revivent “en petit” ce qu’a vécu la Mère, c’est-à-dire qu’ils aiment selon l’amour de Jésus. Toute la fécondité de l’Église et du Saint-Siège dépend de la Croix du Christ. Autrement, ce ne serait qu’apparence, voire pire. Un grand théologien contemporain a écrit : « Si l’Église est l’arbre qui a poussé à partir du petit grain de sénevé de la croix, cet arbre est destiné à produire à son tour des grains de sénevé, et donc des fruits qui répètent la forme de la croix, car c’est précisément à la croix qu’ils doivent leur existence » (H.U. von Balthasar, Cordula ovverosia il caso serio, Brescia 1969, 45-46).
Dans la Collecte, nous avons également demandé que l’Église se réjouisse « de voir grandir en sainteté » ses enfants. En effet, cette fécondité de Marie et de l’Église est inséparablement liée à sa sainteté, c’est-à-dire à sa configuration au Christ. Le Saint-Siège est saint comme l’Église, dans son noyau originel, dans la fibre dont elle est tissée. Ainsi, le Siège apostolique conserve la sainteté de ses racines tout en étant gardé par elles. Mais il n’en est pas moins vrai qu’il vit aussi de la sainteté de chacun de ses membres. C’est pourquoi la meilleure façon de servir le Saint-Siège est de s’efforcer d’être saint, chacun selon son état de vie et la tâche qui lui est confiée.
Par exemple, un prêtre qui porte personnellement une lourde croix en raison de son ministère, et qui pourtant se rend chaque jour à son bureau et s’efforce de faire son travail du mieux qu’il peut avec amour et foi, ce prêtre participe et contribue à la fécondité de l’Église. De même, un père ou une mère de famille qui vit une situation difficile à la maison, un enfant qui a des soucis, ou un parent malade, et qui poursuit son travail avec engagement, cet homme et cette femme sont féconds dans la fécondité de Marie et de l’Église.
Nous en arrivons maintenant à la deuxième icône, celle écrite par saint Luc au début des Actes des Apôtres, qui représente la mère de Jésus avec les apôtres et les disciples au Cénacle (1,12-14). Il nous montre la maternité de Marie à l’égard de l’Église naissante, une maternité « archétypale » qui reste d’actualité en tout temps et en tout lieu. Surtout, elle est toujours le fruit du mystère pascal, du don du Seigneur crucifié et ressuscité.
L’Esprit Saint qui descend avec puissance sur la première communauté est le même que celui que Jésus a rendu dans son dernier souffle (cf. Jn 19,30). Cette icône biblique est inséparable de la première : la fécondité de l’Église est toujours liée à la Grâce qui a jailli du Cœur transpercé de Jésus avec le sang et l’eau, symbole des Sacrements (cf. Jn 19, 34).
Marie, au Cénacle, grâce à la mission maternelle reçue au pied de la croix, est au service de la communauté naissante : elle est la mémoire vivante de Jésus et, en tant que telle, elle est, pour ainsi dire, le pôle d’attraction qui harmonise les différences et rend d’un seul cœur la prière des disciples. […]
30 juillet 2025 – Enseignement du Pape Léon XIV lors de l’Audience Générale
[…] Pour vraiment connaître Jésus, il faut accomplir un cheminement, il faut rester avec Lui et passer aussi par sa Passion. Quand nous l’aurons vu humilié et souffrant, quand nous aurons fait l’expérience de la puissance salvifique de sa Croix, alors nous pourrons dire que nous l’avons vraiment connu. Pour devenir disciples de Jésus, il n’y a pas de raccourcis. […]
15 août 2025 – Homélie du Pape Léon XIV lors de la Messe de l’Assomption
[…] Sur la croix, Jésus a librement prononcé le “oui” qui devait vider de son pouvoir la mort, cette mort qui sévit encore lorsque nos mains crucifient et que nos cœurs sont prisonniers de la peur, de la méfiance. Sur la croix, la confiance a vaincu, l’amour qui voit ce qui n’est pas encore a vaincu, le pardon a vaincu.
Et Marie était là : elle était là, unie à son Fils. Nous pouvons aujourd’hui deviner que Marie, c’est nous quand nous ne fuyons pas, c’est nous quand nous répondons par notre “oui” à son “oui”. Dans les martyrs de notre temps, dans les témoins de la foi et de la justice, de la douceur et de la paix, ce “oui” vit encore et continue de lutter contre la mort. Ainsi, ce jour de joie est un jour qui nous engage à choisir comment et pour qui vivre. […]
15 août 2025 – Message du Pape Léon XIV aux Cad Schonborn à l’occasion du 350 ans du sanctuaire de la Vierge Noire à Cologne
Nous invoquons la Mère de Dieu, la Vierge Noire, afin qu’en cette Année Sainte elle obtienne pour nous tous une foi sincère, forte et inébranlable en Jésus-Christ, son Fils et notre Seigneur. De lui, né de la Mère, a resplendi sur la terre une étoile nouvelle ; né du Père, il a façonné le ciel et la terre. En naissant, une lumière nouvelle a brillé dans l’étoile ; en mourant sur la croix, l’ancienne lumière fut voilée dans le soleil (cf. saint Augustin, Sermon 199). Dans les ténèbres et les incertitudes, nous implorons donc cette foi patiente et constante que l’apôtre saint Jean déclare être notre victoire, celle qui triomphe du monde (cf. 1 Jn 5, 4).
17 août 2025 – Homélie du Pape Léon XIV lors de la Messe célébrée dans le sanctuaire marial Santa Maria della Rotonda (Albano)
Nous recherchons la paix mais nous avons entendu : « Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division » (Lc 12, 51). Et nous lui répondrions presque : “Comment cela, Seigneur ? Toi aussi ? Nous avons déjà trop de divisions. N’est-ce pas toi qui as dit lors de la dernière Cène : “Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ? ” “Oui – pourrait nous répondre le Seigneur – c’est moi. Mais souvenez-vous que ce soir-là, mon dernier soir, j’ai immédiatement ajouté au sujet de la paix : « ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé » (cf. Jn 14, 27)”.
Chers amis, le monde nous habitue à confondre la paix avec le confort, le bien avec la tranquillité. C’est pourquoi, afin que sa paix, le shalom de Dieu, vienne parmi nous, Jésus doit nous dire : « Je suis venu apporter le feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! » (Lc 12, 49). Peut-être que nos propres familles, comme l’annonce l’Évangile, et même nos amis, seront divisés à ce sujet. Et certains nous recommanderont de ne pas prendre de risques, de nous ménager, car il est important d’être tranquilles, et les autres ne méritent pas d’être aimés. Jésus, au contraire, s’est plongé courageusement dans notre humanité. C’est le “baptême” dont il parle (v. 50) : le baptême de la croix, une immersion totale aux risques que comporte l’amour. Et lorsque, selon l’expression, “ nous communions”, nous nous nourrissons de son don audacieux. La Messe nourrit cette décision. C’est la décision de ne plus vivre pour nous-mêmes, d’apporter le feu dans le monde. Non pas le feu des armes, ni celui des paroles qui réduisent les autres en cendres. Cela non. Mais le feu de l’amour, qui s’abaisse et sert, qui oppose à l’indifférence le soin et à l’arrogance la douceur ; le feu de la bonté, qui ne coûte pas comme les armes, mais qui renouvelle gratuitement le monde. Cela peut coûter l’incompréhension, la moquerie, voire la persécution, mais il n’y a pas de plus grande paix que d’avoir en soi sa flamme.
Ne laissons pas le Seigneur hors de nos églises, de nos maisons et de notre vie. Dans les pauvres, au contraire, laissons-le entrer et alors nous ferons aussi la paix avec notre pauvreté, celle que nous craignons et que nous refusons lorsque nous recherchons à tout prix la tranquillité et la sécurité. […]
20 aout 2025 – Enseignement du Pape Léon XIV lors de l’Audience Générale
Arrêtons-nous sur l’un des gestes les plus bouleversants et lumineux de l’Evangile : le moment où Jésus, lors de la Dernière Cène, tend une bouchée à celui qui s’apprête à le trahir. Ce n’est pas seulement un geste de partage, c’est bien plus : c’est l’ultime tentative de l’amour de ne pas se rendre.
Saint Jean, avec sa profonde sensibilité spirituelle, nous décrit ainsi ce moment : «Au cours d’un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer […] Jésus, sachant que son heure était venue […] les aima jusqu’à la fin» ( Jn 13, 1-2). Aimer jusqu’au bout : telle est la clé pour comprendre le cœur du Christ. Un amour qui ne s’arrête pas face au rejet, à la déception, ni même à l’ingratitude.
Jésus connaît l’heure, mais ne la subit pas : il la choisit. C’est lui qui reconnaît le moment où son amour devra endurer la blessure la plus douloureuse, celle de la trahison. Et au lieu de se retirer, d’accuser, de se défendre… il continue d’aimer : il lave les pieds, imbibe le pain et l’offre.
«C’est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper» (Jn 13, 26). Par ce geste simple et humble, Jésus montre pleinement son amour. Non pas qu’il ignore ce qui se passe, mais précisément parce qu’il voit clairement. Il a compris que la liberté des autres, même quand on se perd dans le mal, peut encore être atteinte par la lumière d’un geste doux. Car il sait que le véritable pardon n’attend pas le repentir, mais s’offre d’abord, comme don gratuit, avant même d’être reçu.
Judas, malheureusement, ne comprend pas. Après la bouchée — dit l’Evangile — «Satan entra en lui» (v. 27). Ce passage nous frappe : comme si le mal, jusque-là caché, se manifestait après que l’amour eut montré son visage le plus désarmé. Et c’est précisément pour cela, frères et sœurs, que cette bouchée est notre salut: parce qu’elle nous dit que Dieu fait tout — absolument tout — pour aller vers nous, même à l’heure où nous le rejetons.
C’est ici que le pardon se révèle dans toute sa puissance et manifeste le visage concret de l’espérance. Il n’est ni oubli, ni faiblesse. Il est la capacité de laisser l’autre libre, tout en l’aimant jusqu’au bout. L’amour de Jésus ne nie pas la vérité de la douleur, mais il ne permet pas au mal d’avoir le dernier mot. Tel est le mystère que Jésus accomplit pour nous, auquel nous aussi, parfois, nous sommes appelés à participer.
Combien de relations se brisent, combien d’histoires se compliquent, combien de non-dits restent suspendus. Pourtant, l’Evangile nous montre qu’il y a toujours une façon de continuer à aimer, même lorsque tout semble irrémédiablement compromis. Pardonner ne signifie pas nier le mal, mais l’empêcher d’engendrer un autre mal. Il ne s’agit pas de dire qu’il ne s’est rien passé, mais de tout faire pour que le ressentiment ne décide pas de l’avenir.
Quand Judas quitte la pièce, «il faisait nuit» (v. 30). Mais aussitôt après, Jésus dit: «Maintenant, le Fils de l’homme a été glorifié» (v. 31). La nuit est encore là, mais une lumière a déjà commencé à briller. Et elle brille parce que le Christ reste fidèle jusqu’au bout, et ainsi son amour est plus fort que la haine. […]
24 août 2025 – Méditation du Pape Léon lors de la prière mariale de l’Angelus
Au cœur de l’Évangile d’aujourd’hui (Lc 13, 22-30), nous trouvons l’image de la “porte étroite”, utilisée par Jésus pour répondre à quelqu’un qui lui demande si peu de gens seront sauvés. Jésus dit : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront pas » (v. 24).
À première vue, cette image soulève quelques questions : si Dieu est le Père de l’amour et de la miséricorde, qui reste toujours les bras ouverts pour nous accueillir, pourquoi Jésus dit-Il que la porte du salut est étroite ?
Certes, le Seigneur ne veut pas nous décourager. Ses paroles servent surtout à ébranler la présomption de ceux qui pensent être déjà sauvés, de ceux qui pratiquent la religion et qui, par conséquent, se croient déjà en règle. En réalité, ils n’ont pas compris qu’il ne suffit pas d’accomplir des actes religieux si ceux-ci ne transforment pas le cœur : le Seigneur ne veut pas d’un culte séparé de la vie et n’apprécie pas les sacrifices et les prières s’ils ne nous conduisent pas à vivre l’amour envers nos frères et à pratiquer la justice. C’est pourquoi, lorsqu’ils se présenteront devant le Seigneur en se vantant d’avoir mangé et bu avec Lui et d’avoir écouté ses enseignements, ils entendront cette réponse : « Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice » (v. 27).
La provocation qui nous vient de l’Évangile d’aujourd’hui est belle : alors que nous jugeons parfois ceux qui sont éloignés de la foi, Jésus remet en question “la sécurité des croyants”. En effet, Il nous dit qu’il ne suffit pas de professer la foi avec des mots, de manger et de boire avec Lui en célébrant l’Eucharistie ou de bien connaître les enseignements chrétiens. Notre foi est authentique lorsqu’elle embrasse toute notre vie, lorsqu’elle devient un critère pour nos choix, lorsqu’elle fait de nous des femmes et des hommes qui s’engagent pour le bien et qui risquent dans l’amour, tout comme Jésus l’a fait. Il n’a pas choisi la voie facile du succès ou du pouvoir, mais, pour nous sauver, Il nous a aimés jusqu’à franchir la “porte étroite” de la Croix. Il est la mesure de notre foi, Il est la porte que nous devons franchir pour être sauvés (cf. Jn 10, 9), en vivant son amour et en devenant, par notre vie, des artisans de justice et de paix.
Parfois, cela signifie faire des choix difficiles et impopulaires, lutter contre son égoïsme et se dépenser pour les autres, persévérer dans le bien là où la logique du mal semble prévaloir, etc. Mais, une fois ce seuil franchi, nous découvrirons que la vie s’ouvre devant nous d’une manière nouvelle et, dès à présent, nous entrerons dans le cœur immense de Dieu et dans la joie de la fête éternelle qu’Il a préparée pour nous.
Invoquons la Vierge Marie afin qu’elle nous aide à franchir avec courage la “porte étroite” de l’Évangile, afin que nous puissions nous ouvrir avec joie à la largeur de l’amour de Dieu le Père.
25 août 2025 – Discours du Pape Léon XIV aux 360 Servants d’autel français venus à Rome
[…] Il y a une preuve certaine que Jésus nous aime et nous sauve : Il a donné sa vie pour nous en l’offrant sur la croix. En effet, il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime (cf. Jn 15, 13). Et voilà la chose la plus merveilleuse de notre foi catholique, une chose que personne n’aurait pu imaginer ni espérer : Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a voulu souffrir et mourir pour les créatures que nous sommes. Dieu nous a aimés à en mourir ! Pour le réaliser, Il est descendu du ciel, Il s’est abaissé jusqu’à nous en se faisant homme, et Il s’est offert sur la croix en sacrifice, l’évènement le plus important de l’histoire du monde. Qu’avons-nous à craindre d’un tel Dieu qui nous a aimés à ce point ? Que pouvions-nous espérer de plus ? Qu’attendons-nous pour l’aimer en retour comme il le mérite ? Glorieusement ressuscité, Jésus est vivant auprès du Père, il prend désormais soin de nous et nous communique sa vie impérissable.
Et l’Église, de génération en génération, garde soigneusement mémoire de la mort et de la résurrection du Seigneur dont elle est témoin, comme son trésor le plus précieux. Elle la garde et la transmet en célébrant l’Eucharistie que vous avez la joie et l’honneur de servir. L’Eucharistie est le Trésor de l’Église, le Trésor des Trésors. Dès le premier jour de son existence, et ensuite pendant des siècles, l’Église a célébré la Messe, de dimanche en dimanche, pour se souvenir de ce que son Seigneur a fait pour elle. Entre les mains du prêtre et à ses paroles, “ceci est mon Corps, ceci est mon Sang”, Jésus donne encore sa vie sur l’Autel, Il verse encore son Sang pour nous aujourd’hui. Chers Servants d’Autel, la célébration de la Messe, nous sauve aujourd’hui ! Elle sauve le monde aujourd’hui ! Elle est l’événement le plus important de la vie du chrétien et de la vie de l’Église, car elle est le rendez-vous où Dieu se donne à nous par amour, encore et encore. Le chrétien ne va pas à la Messe par devoir, mais parce qu’il en a besoin, absolument ! ; le besoin de la vie de Dieu qui se donne sans retour ! […]
27 août 2025 – Paroles du Pape Léon XIV dans la Basilique Saint Pierre, au terme de l’Audience Générale
Souvent dans la vie, nous aimerions recevoir une réponse immédiate, une solution immédiate, et pour une certaine raison, Dieu nous fait attendre, et il y a beaucoup à apprendre. Cependant, comme Jésus lui-même nous l’enseigne, nous devons avoir cette confiance qui vient uniquement du fait que nous savons que nous sommes fils et filles de Dieu, et que Dieu nous donne toujours sa grâce. Il ne nous enlève pas toujours la douleur, il n’enlève pas toujours la souffrance, mais il nous dit qu’il est près de nous. Dieu est toujours avec nous, et nous devons renouveler cette foi. Dieu est toujours avec nous, et c’est pourquoi nous sommes heureux.
3 septembre 2025 – Enseignement du Pape Léon XIV lors de l’Audience Générale
Au cœur du récit de la Passion, au moment le plus lumineux et en même temps le plus sombre de la vie de Jésus, l’Évangile de Jean nous livre deux mots qui renferment un immense mystère : « J’ai soif » (19,28), et aussitôt après : « Tout est accompli. » (19,30). Ultimes paroles, mais chargées d’une vie entière, qui révèlent le sens de toute l’existence du Fils de Dieu. Sur la croix, Jésus n’apparaît pas comme un héros victorieux, mais comme un mendiant d’amour. Il ne proclame pas, ne condamne pas, ne se défend pas. Il demande humblement ce qu’il ne peut en aucun cas se donner à lui-même.
La soif du Crucifié n’est pas seulement le besoin physiologique d’un corps meurtri. Elle est même, et surtout, l’expression d’un désir profond : celui d’amour, de relation, de communion. C’est le cri silencieux d’un Dieu qui, ayant voulu tout partager de notre condition humaine, se laisse aussi traverser par cette soif. Un Dieu qui n’a pas honte de mendier une gorgée, car dans ce geste, il nous dit que l’amour, pour être vrai, doit aussi apprendre à demander et pas seulement à donner.
J’ai soif, dit Jésus, et c’est ainsi qu’il manifeste son humanité et la nôtre. Aucun de nous ne peut se suffire à soi-même. Personne ne peut se sauver seul. La vie “s’accomplit” non pas lorsque nous sommes forts, mais lorsque nous apprenons à recevoir. Et c’est précisément à ce moment-là, après avoir reçu des mains étrangères une éponge imbibée de vinaigre, que Jésus proclame : Tout est accompli. L’amour s’est fait nécessiteux, et c’est précisément pour cela qu’il a accompli son œuvre.
C’est là le paradoxe chrétien : Dieu sauve non pas en agissant, mais en se laissant faire. Non pas en vainquant le mal par la force, mais en acceptant jusqu’au fond la faiblesse de l’amour. Sur la croix, Jésus nous enseigne que l’homme ne se réalise pas dans le pouvoir, mais dans l’ouverture confiante à l’autre, même lorsqu’il nous est hostile et ennemi. Le salut ne réside pas dans l’autonomie, mais de reconnaitre avec humilité son propre besoin et de savoir l’exprimer librement.
L’accomplissement de notre humanité dans le dessein de Dieu n’est pas un acte de puissance, mais un geste de confiance. Jésus ne sauve pas par un coup de théâtre, mais en demandant quelque chose qu’il ne peut se donner à lui-même. Et c’est là que s’ouvre une porte sur la véritable espérance : si même le Fils de Dieu a choisi de ne pas se suffire à lui-même, alors notre soif – d’amour, de sens, de justice – n’est pas un signe d’échec, mais de vérité.
Cette vérité, apparemment si simple, est difficile à accepter. Nous vivons à une époque qui récompense l’autosuffisance, l’efficacité, la performance. Pourtant, l’Évangile nous montre que la mesure de notre humanité n’est pas donnée par ce que nous pouvons conquérir, mais par notre capacité à nous laisser aimer et, quand cela est nécessaire, aussi aider.
Jésus nous sauve en nous montrant que demander n’est pas indigne, mais libérateur. C’est le moyen de sortir de la dissimulation du péché, pour retourner dans l’espace de la communion. Dès le départ, le péché a engendré la honte. Mais le pardon, le vrai, naît lorsque nous pouvons regarder en face notre besoin et ne plus craindre d’être rejetés.
La soif de Jésus sur la croix est donc aussi la nôtre. C’est le cri de l’humanité blessée qui cherche encore l’eau vive. Et cette soif ne nous éloigne pas de Dieu, elle nous unit plutôt à Lui. Si nous avons le courage de la reconnaître, nous pouvons découvrir que notre fragilité est aussi un pont vers le ciel. C’est précisément en demandant – et non en possédant – que s’ouvre une voie de liberté, car nous cessons de prétendre nous suffire à nous-mêmes.
Dans la fraternité, dans la vie simple, dans l’art de demander sans honte et de donner sans calcul, se cache une joie que le monde ne connaît pas. Une joie qui nous ramène à la vérité originelle de notre être : nous sommes des créatures faites pour donner et recevoir de l’amour.
Chers frères et sœurs, dans la soif du Christ, nous pouvons reconnaître toute notre soif. Et apprendre qu’il n’y a rien de plus humain, rien de plus divin, que de savoir dire : j’ai besoin. N’ayons pas peur de demander, surtout quand nous pensons ne pas le mériter. N’ayons pas honte de tendre la main. C’est précisément là, dans ce geste humble, que se cache le salut.
6 septembre 2025 – Enseignement du Pape Léon XIV lors de l’Audience Générale
[…] La grande « invention » d’Hélène fut de retrouver la Sainte Croix. Voici le trésor caché pour lequel tout vendre ! La Croix de Jésus est la plus grande découverte de la vie, la valeur qui modifie toutes les valeurs.
Hélène put le comprendre, peut-être, car elle avait porté sa propre croix pendant longtemps. Elle n’était pas née à la cour : on dit qu’elle était une aubergiste d’origine modeste, dont le futur empereur Constance tomba amoureux. Il l’épousa, mais pour des jeux de pouvoir, il n’hésita pas à la répudier, l’éloignant pendant des années de son fils Constantin. Devenu empereur, Constantin lui-même lui causa beaucoup de peines et de déceptions, mais Hélène resta toujours elle-même : une femme qui cherche. Elle avait décidé de devenir chrétienne et pratiquait toujours la charité, n’oubliant jamais les humbles dont elle était issue.
Une telle dignité et fidélité à la conscience, chers frères et sœurs, changent encore aujourd’hui le monde : elles rapprochent du trésor, comme le travail de l’agriculteur. Cultiver son cœur demande des efforts. C’est le plus grand travail qui soit. Mais en creusant, on trouve, en s’abaissant, on se rapproche toujours plus de ce Seigneur qui s’est dépouillé lui-même pour devenir comme nous. Sa Croix est sous la croûte de notre terre.
Nous pouvons marcher fièrement, piétinant distraitement le trésor qui se trouve sous nos pieds. Si, au contraire, nous devenons comme des enfants, nous connaîtrons un autre Royaume, une autre force. Dieu est toujours sous nos pieds, prêt à nous soulever vers les hauteurs.
10 septembre 2025 – Enseignement du Pape Léon lors de l’Audience Générale
Contemplons le sommet de la vie de Jésus dans ce monde : sa mort sur la croix. Les Évangiles attestent un détail très précieux, qui mérite d’être contemplé avec l’intelligence de la foi. Sur la croix, Jésus ne meurt pas en silence. Il ne s’éteint pas lentement, comme une lumière qui s’éteint, mais il quitte la vie avec un cri : « Jésus, poussant un grand cri, expira » (Mc 15, 37). Ce cri résume tout : la douleur, l’abandon, la foi, l’offrande. Ce n’est pas seulement la voix d’un corps qui cède, mais le signe ultime d’une vie qui se donne.
Le cri de Jésus est précédé d’une question, l’une des plus déchirantes qui puissent être prononcées : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». C’est le premier verset du Psaume 22, mais sur les lèvres de Jésus, il porte une gravité unique. Le Fils, qui a toujours vécu en communion intime avec le Père, fait maintenant l’expérience du silence, de l’absence, de l’abîme. Il ne s’agit pas d’une crise de foi, mais de la dernière étape d’un amour qui se donne jusqu’au bout. Le cri de Jésus n’est pas un cri de désespoir, mais de sincérité, de vérité poussée à l’extrême, de confiance qui résiste même lorsque tout fait silence.
À ce moment-là, le ciel s’assombrit et le voile du temple se déchire (cf. Mc 15, 33.38). C’est comme si la création elle-même participait à cette douleur et révélait en même temps quelque chose de nouveau : Dieu n’habite plus derrière un voile, son visage est désormais pleinement visible dans le Crucifié. C’est là, dans cet homme déchiré, que se manifeste le plus grand amour. C’est là que nous pouvons reconnaître un Dieu qui ne reste pas distant, mais qui traverse jusqu’au bout notre douleur.
Le centurion, un païen, le comprend. Non pas parce qu’il a écouté un discours, mais parce qu’il a vu Jésus mourir de cette manière : « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! » (Mc 15, 39). C’est la première profession de foi après la mort de Jésus. C’est le fruit d’un cri qui ne s’est pas perdu dans le vent, mais qui a touché un cœur. Parfois, ce que nous ne pouvons pas dire avec des mots, nous l’exprimons avec la voix. Quand le cœur est plein, il crie. Et ce n’est pas toujours un signe de faiblesse, cela peut être un acte profond d’humanité.
Nous avons l’habitude de considérer le cri comme quelque chose de désordonné, à réprimer. L’Évangile confère à notre cri une valeur immense, en nous rappelant qu’il peut être une invocation, une protestation, un désir, un abandon. Il peut même être la forme extrême de la prière, lorsque nous n’avons plus de mots. Dans ce cri, Jésus a mis tout ce qui lui restait : tout son amour, toute son espérance.
Oui, car il y a aussi cela dans le cri : une espérance qui ne se résigne pas. On crie quand on croit que quelqu’un peut encore entendre. On crie non par désespoir, mais par désir. Jésus n’a pas crié contre le Père, mais vers Lui. Même dans le silence, il était convaincu que le Père était là. Et ainsi, il nous a montré que notre espérance peut crier, même quand tout semble perdu.
Crier devient alors un geste spirituel. Ce n’est pas seulement le premier acte de notre naissance – lorsque nous venons au monde en pleurant – : c’est aussi une façon de rester en vie. On crie quand on souffre, mais aussi quand on aime, quand on appelle, quand on invoque. Crier, c’est dire que nous sommes là, que nous ne voulons pas nous éteindre dans le silence, que nous avons encore quelque chose à offrir.
Dans le voyage de la vie, il y a des moments où tout garder à l’intérieur peut nous consumer lentement. Jésus nous enseigne à ne pas avoir peur du cri, pourvu qu’il soit sincère, humble, orienté vers le Père. Un cri n’est jamais inutile s’il naît de l’amour. Et il n’est jamais ignoré s’il est confié à Dieu. C’est un moyen de ne pas céder au cynisme, de continuer à croire qu’un autre monde est possible.
Apprenons aussi cela du Seigneur Jésus : apprenons le cri de l’espérance lorsque vient l’heure de l’épreuve extrême. Non pas pour blesser, mais pour nous confier. Non pas pour hurler contre quelqu’un, mais pour ouvrir le cœur. Si notre cri est sincère, il peut être le seuil d’une nouvelle lumière, d’une nouvelle naissance. Comme pour Jésus : quand tout semblait fini, en réalité, le salut était sur le point de commencer. Si elle se manifeste avec la confiance et la liberté des enfants de Dieu, la voix souffrante de notre humanité, unie à la voix du Christ, peut devenir source d’espérance pour nous et pour ceux qui nous entourent.
10 septembre 2025 – Paroles du Pape Léon XIV aux pèlerins venus d’Allemagne, au terme de l’Audience Générale
Regardant la Croix, reconnaissons le Mystère de l’Amour de Dieu qui a donné sa vie pour nous. N’ayons pas peur de proclamer au monde la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu et notre Sauveur.
10 septembre 2025 – Paroles du Pape Léon XIV aux pèlerins de langue portugaise, au terme de l’Audience Générale
Il n’y a d’amour plus grand que celui de Jésus sur la Croix, s’offrant au Père pour chacun de nous. Ouvrons sans peur nos cœurs à cet amour qui est la raison de notre Espérance.
10 septembre 2025 – Paroles du Pape Léon XIV aux pèlerins de langue arabe, au terme de l’Audience Générale
Je vous invite à transformer votre cri des moments d’épreuves et de tribulations en une prière confiante, parce que Dieu écoute toujours ses enfants et répond au moment le meilleur nous nous.
14 septembre 2025 – Méditation du Pape Léon lors de la prière de l’Angelus
Aujourd’hui, l’Église célèbre la fête de l’Exaltation de la Sainte Croix, qui commémore la découverte du bois de la Croix par Sainte Hélène, à Jérusalem, au IVe siècle, et la restitution de la précieuse relique à la Ville sainte, par l’empereur Héraclius.
Mais que signifie pour nous, aujourd’hui, la célébration de cette fête ? L’Évangile que nous propose la liturgie (cf. Jn 3, 13-17) nous aide à le comprendre. La scène se déroule de nuit : Nicodème, l’un des chefs des Juifs, homme droit et ouvert d’esprit (cf. Jn 7, 50-51), vient rencontrer Jésus. Il a besoin de lumière, de conseils : il cherche Dieu et demande de l’aide au Maître de Nazareth, car il reconnaît en lui un prophète, un homme qui accomplit des signes extraordinaires.
Le Seigneur l’accueille, l’écoute et lui révèle finalement que le Fils de l’homme doit être élevé, « afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle » (Jn 3, 15), et ajoute : « Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle » (v. 16). Nicodème, qui peut-être ne comprend pas pleinement le sens de ces paroles à ce moment-là, le comprendra certainement lorsqu’après la crucifixion, il aidera à enterrer le corps du Sauveur (cf. Jn 19, 39) : il comprendra que Dieu, pour racheter les hommes, s’est fait homme et est mort sur la croix.
Jésus en parle à Nicodème, en rappelant un épisode de l’Ancien Testament (cf. Nb 21, 4-9), lorsque dans le désert, les Israélites, attaqués par des serpents venimeux, se sauvaient en regardant le serpent d’airain que Moïse, obéissant au commandement de Dieu, avait fait et placé sur une hampe.
Dieu nous a sauvés en se manifestant à nous, en s’offrant comme notre compagnon, notre maître, notre médecin, notre ami, jusqu’à devenir pour nous le Pain rompu dans l’Eucharistie. Et pour accomplir cette œuvre, il s’est servi de l’un des instruments de mort les plus cruels que l’homme ait jamais inventé : la croix.
C’est pourquoi nous célébrons aujourd’hui son “exaltation” : pour l’amour immense avec lequel Dieu, l’embrassant pour notre salut, l’a transformée d’un moyen de mort en instrument de vie, nous enseignant que rien ne peut nous séparer de Lui (cf. Rm 8, 35-39) et que sa charité est plus grande que notre péché (cf. François, Catéchèse, 30 mars 2016).
Demandons donc, par l’intercession de Marie, la Mère présente au Calvaire près de son Fils, que son amour salvateur s’enracine et grandisse en nous aussi, et que nous sachions nous donner les uns aux autres, comme Lui s’est donné tout à tous.
14 septembre 2025 – Paroles du Pape Léon XIV lors de la Commémoration des martyrs et témoins de la foi du XXème siècle, en la Basilique Saint Paul Hors les Murs
« Pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde » (Gal 6, 14). Ces paroles de l’apôtre Paul, près de la tombe duquel nous sommes réunis, nous introduisent à la commémoration des martyrs et des témoins de la foi du XXIème siècle, en cette fête de l’Exaltation de la Sainte Croix.
Aux pieds de la croix du Christ, notre salut, décrite comme “l’espérance des chrétiens” et la “gloire des martyrs” (cf. Vêpres de la Liturgie byzantine pour la Fête de l’Exaltation de la Croix), je salue les Représentants des Églises Orthodoxes, des Anciennes Églises Orientales, des Communions chrétiennes et des Organisations œcuméniques, que je remercie d’avoir accepté mon invitation à cette célébration. À vous tous ici présents, mon accolade de paix.
Nous sommes convaincus que le martyre jusqu’à la mort est « la communion la plus vraie avec le Christ qui répand son sang et qui, dans ce sacrifice, rend proches ceux qui jadis étaient loin (cf. Ep 2, 13) » (Lett. enc. Ut unum sint, n. 84). Aujourd’hui encore, nous pouvons affirmer avec Jean-Paul II que, là où la haine semblait imprégner chaque aspect de la vie, ces audacieux serviteurs de l’Évangile et martyrs de la foi ont démontré de manière évidente que « l’amour est plus fort que la mort » (Commémoration des Témoins de la foi au XXème siècle, 7 mai 2000).
Nous nous souvenons de ces frères et sœurs le regard tourné vers le Crucifié. Par sa croix Jésus nous a révélé le vrai visage de Dieu, son infinie compassion pour l’humanité ; il a pris sur lui la haine et la violence du monde, pour partager le sort de tous ceux qui sont humiliés et opprimés : « c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé » (Is 53, 4).
Aujourd’hui encore, de nombreux frères et sœurs, à cause de leur témoignage de foi dans des situations difficiles et des contextes hostiles, portent la même croix du Seigneur : comme Lui, ils sont persécutés, condamnés, tués. Jésus dit d’eux : « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi » (Mt 5, 10-11). Ce sont des femmes et des hommes, des religieuses et des religieux, des laïcs et des prêtres, qui paient de leur vie leur fidélité à l’Évangile, leur engagement pour la justice, leur lutte pour la liberté religieuse là où elle est encore violée, leur solidarité avec les plus pauvres. Selon les critères du monde, ils ont été “vaincus”. En réalité, comme nous le dit le Livre de la Sagesse : « Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l’espérance de l’immortalité les comblait » (Sa 3, 4).
Frères et sœurs, au cours de l’Année jubilaire, nous célébrons l’espérance de ces témoins courageux de la foi. C’est une espérance pleine d’immortalité, parce que leur martyre continue à diffuser l’Évangile dans un monde marqué par la haine, la violence et la guerre ; c’est une espérance pleine d’immortalité, car, bien qu’ayant été tués dans leur corps, personne ne pourra étouffer leur voix ou effacer l’amour qu’ils ont donné ; c’est une espérance pleine d’immortalité, parce que leur témoignage demeure comme une prophétie de la victoire du bien sur le mal.
Oui, leur espérance est désarmée. Ils ont témoigné de leur foi sans jamais recourir à la force et à la violence, mais en embrassant la faible et douce force de l’Évangile, selon les paroles de l’apôtre Paul : « C’est très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en mois sa demeure. […] Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2Cor 12, 9-10). […]
15 septembre 2025 – Méditation du Pape Léon XIV lors du Jubilé de la Consolation, dans la Basilique Saint-Pierre
« Consolez, consolez mon peuple » (Is 40, 1). Telle est l’invitation du prophète Isaïe, qui nous interpelle aujourd’hui de manière exigeante : elle nous appelle à partager la consolation de Dieu avec tant de frères et sœurs qui vivent des situations de faiblesse, de tristesse, de douleur. Pour ceux qui sont dans les larmes, le désespoir, la maladie et le deuil, résonne clairement, fortement, l’annonce prophétique de la volonté du Seigneur de mettre fin à la souffrance et de la transformer en joie. Toute douleur peut être transformée par la grâce de Jésus-Christ. Cette Parole compatissante, incarnée dans le Christ, est le bon Samaritain dont nous parle l’Évangile : c’est Lui qui apaise nos blessures, c’est Lui qui prend soin de nous. Dans les moments sombres, même contre toute évidence, Dieu ne nous laisse pas seuls ; au contraire, c’est précisément dans ces moments-là que nous sommes appelés plus que jamais à espérer en la proximité du Sauveur qui ne nous abandonne jamais.
Nous cherchons quelqu’un pour nous consoler et souvent nous ne le trouvons pas. Parfois, la voix de ceux qui, sincèrement, veulent partager notre souffrance nous devient même insupportable. C’est vrai. Il y a des situations où les mots ne servent à rien et deviennent presque superflus. Dans ces moments, il ne reste peut-être que les larmes, si elles ne sont pas encore épuisées.
Les larmes sont un langage qui exprime les sentiments profonds d’un cœur blessé. Les larmes sont un cri muet qui implore compassion et réconfort. Mais avant tout, elles sont libération et purification des yeux, des sentiments, des pensées. Il ne faut pas avoir honte de pleurer ; c’est une façon d’exprimer notre tristesse et notre besoin d’un monde nouveau ; c’est un langage qui parle de notre humanité faible et mise à l’épreuve, mais appelée à la joie.
Là où il y a de la souffrance, la question se pose inévitablement : pourquoi tout ce mal ? D’où vient-il ? Pourquoi cela m’est-il arrivé à moi ? Dans ses Confessions, saint Augustin écrit : « je cherchais d’où, vient le mal […] Quelle est sa racine et quel est son germe? […] D’où vient donc le mal, puisque Dieu a fait toutes ces choses bonnes, lui qui est bon? […] Telles étaient les pensées que je roulais dans un cœur misérable […] Cependant, solidement était fixée en mon cœur dans l’Église catholique, la foi de ton Christ, notre Seigneur et Sauveur; en bien des points sans doute, elle était encore vague et fluctuante » (VII, 5).
Le passage des interrogations à la foi est celui auquel nous éduque la Sainte Écriture. Il y a en effet des questions qui nous replient sur nous-mêmes et nous divisent intérieurement et par rapport à la réalité. Il y a des pensées qui ne peuvent rien engendrer. Si elles nous isolent et nous désespèrent, elles humilient aussi notre intelligence. Mieux vaut, comme dans les Psaumes, que la question soit une protestation, une plainte, une invocation de cette justice et de cette paix que Dieu nous a promises. Alors, nous jetons un pont vers le ciel, même lorsqu’il semble muet. Dans l’Église, nous recherchons le ciel ouvert, qui est Jésus, le pont de Dieu vers nous. Il existe une consolation qui nous atteint alors, lorsque cette foi qui nous semble “vague et fluctuante” comme un bateau dans la tempête reste “solide et fixé”.
Là où il y a le mal, nous devons rechercher le réconfort et la consolation qui en triomphent et ne lui laissent aucun répit. Dans l’Église, cela signifie : jamais seuls. Poser sa tête sur une épaule qui vous console, qui pleure avec vous et vous donne de la force, est un remède dont personne ne peut se priver, car c’est le signe de l’amour. Là où la douleur est profonde, l’espérance qui naît de la communion doit être encore plus forte. Et cette espérance ne déçoit pas. […]
17 septembre 2025 – Enseignement du Pape Léon XIV lors de l’Audience Générale
Dans notre cheminement de catéchèse sur Jésus, notre espérance, nous contemplons aujourd’hui le mystère du Samedi Saint. Le Fils de Dieu repose dans le tombeau. Mais cette “absence” n’est pas un vide : c’est une attente, une plénitude retenue, une promesse gardée dans l’obscurité. C’est le jour du grand silence, où le ciel semble muet et la terre immobile, mais c’est précisément là que s’accomplit le mystère le plus profond de la foi chrétienne. C’est un silence lourd de sens, comme le sein d’une mère qui garde son enfant non encore né, mais déjà vivant.
Le corps de Jésus, descendu de la croix, est soigneusement enveloppé, comme on le fait avec ce qui est précieux. L’évangéliste Jean nous dit qu’il a été enterré dans un jardin, dans « un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne » (Jn 19, 41). Rien n’est laissé au hasard. Ce jardin rappelle l’Eden perdu, le lieu où Dieu et l’homme étaient unis. Et ce tombeau jamais utilisé parle de quelque chose qui doit encore arriver : c’est un seuil, pas une fin. Au début de la création, Dieu avait planté un jardin, maintenant la nouvelle création commence aussi dans un jardin : avec un tombeau clos qui, bientôt, s’ouvrira.
Le Samedi Saint est également un jour de repos. Selon la Loi juive, on ne doit pas travailler le septième jour : en effet, après six jours de création, Dieu se reposa (cf. Gn 2, 2). Maintenant, le Fils aussi, après avoir accompli son œuvre de salut, se repose. Non pas parce qu’il est fatigué, mais parce qu’il a terminé son travail. Non pas parce qu’il a abandonné, mais parce qu’il a aimé jusqu’au bout. Il n’y a plus rien à ajouter. Ce repos est le sceau de l’œuvre accomplie, la confirmation que ce qui devait être fait a vraiment été porté à terme. C’est un repos rempli de la présence cachée du Seigneur.
Nous avons du mal à nous arrêter et à nous reposer. Nous vivons comme si la vie n’était jamais suffisante. Nous courons pour produire, pour prouver, pour ne pas perdre de terrain. Mais l’Évangile nous enseigne que savoir s’arrêter est un geste de confiance que nous devons apprendre à accomplir. Le Samedi Saint nous invite à découvrir que la vie ne dépend pas toujours de ce que nous faisons, mais aussi de la façon dont nous savons nous détacher de ce que nous avons pu faire. […]
20 septembre 2025 – Message du Pape Léon XIV à “WALK FOR LIFE”, promue par “LES TURNER ALS FOUNDATION”
Vous avez reçu un lourd fardeau à porter. Comme j’aimerais qu’il n’en soit pas ainsi. Cependant, vos souffrances vous offrent l’occasion de découvrir et d’affirmer une vérité profonde : la qualité de la vie humaine ne dépend pas des résultats obtenus. La qualité de notre vie dépend de l’amour. Dans votre souffrance, vous pouvez expérimenter une profondeur de l’amour humain qui vous était auparavant inconnue. Vous pouvez grandir dans la gratitude pour tout ce qui a été et pour les personnes qui prennent maintenant soin de vous. Vous pouvez maintenant développer un sens profond de la beauté de la création, de la vie dans ce monde et du mystère de l’amour.
Je prie pour vous. Je prie pour qu’au lieu de vous laisser submerger par la frustration, le désespoir ou le désespoir, vous vous abandonniez au mystère de l’existence humaine, à l’amour de vos soignants et à l’étreinte du Divin.
Et enfin, quelques mots à ceux qui sont en deuil. Après avoir pris soin de vos proches atteints de la SLA, vous pleurez maintenant leur disparition. Vous ne les avez pas oubliés. Et, en fait, votre amour a été purifié par votre service, puis par votre deuil. Vous avez appris, et chaque jour, vous pénétrez plus profondément dans le mystère le plus profond : la mort n’est pas la parole définitive. L’amour triomphe de la mort. L’amour triomphe de la mort. L’amour triomphe de la mort.
1er octobre 2025 – Enseignement du Pape Léon XIV lors de l’Audience Générale
Le centre de notre foi et le cœur de notre espérance sont fermement enracinés dans la résurrection du Christ. En lisant attentivement les Évangiles, nous réalisons que ce mystère est surprenant non seulement parce qu’un homme – le Fils de Dieu – est ressuscité des morts, mais aussi pour la manière choisie pour le faire. En effet, la résurrection de Jésus n’est pas un triomphe pompeux, ce n’est pas une revanche ou une vengeance contre ses ennemis. C’est le merveilleux témoignage de la capacité de l’amour à se relever après une grande défaite pour continuer son irrépressible chemin.
Lorsque nous nous relevons après un traumatisme causé par d’autres, la première réaction est souvent la colère, le désir de faire payer à quelqu’un ce que nous avons subi. Le Ressuscité ne réagit pas ainsi. Sorti des enfers de la mort, Jésus ne se venge pas. Il ne revient pas avec des gestes de puissance, mais manifeste avec douceur la joie d’un amour plus grand que toute blessure et plus fort que toute trahison.
Le Ressuscité n’éprouve aucun besoin de rétablir ou d’affirmer sa supériorité. Il apparaît à ses amis – les disciples – et il le fait avec une extrême discrétion, sans les forcer leur capacité à l’accepter. Son unique désir est d’être à nouveau en communion avec eux en les aidant à surmonter leur sentiment de culpabilité. Nous le voyons très bien au cénacle, où le Seigneur apparaît à ses amis enfermés dans la peur. C’est un moment qui exprime une force extraordinaire : Jésus, après être descendu dans les abîmes de la mort pour libérer ceux qui y étaient emprisonnés, entre dans la chambre fermée de qui est paralysé par la peur, en apportant un don que personne n’aurait osé espérer : la paix.
Sa salutation est simple, presque ordinaire : « La paix soit avec vous ! » (Jn 20,19). Mais elle s’accompagne d’un geste si beau qu’il en est presque inconvenant : Jésus montre aux disciples ses mains et son côté avec les marques de sa passion. Pourquoi dévoiler ces blessures devant qui, en ces heures dramatiques, l’a renié et abandonné ? Pourquoi ne pas cacher ces signes de douleur et éviter de rouvrir la blessure de la honte ?
Pourtant, l’Évangile dit que, voyant le Seigneur, les disciples se réjouirent (cf. Jn 20, 20). La raison en est profonde : Jésus est maintenant pleinement réconcilié avec tout ce qu’il a souffert. Il n’y a pas d’ombre de rancœur. Les blessures ne servent pas à faire des reproches, mais à confirmer un amour plus fort que toute infidélité. Elles sont la preuve qu’au moment même de notre échec, Dieu n’a pas reculé. Il ne nous a pas abandonnés.
Ainsi, le Seigneur se montre nu et désarmé. Il n’exige rien, il ne fait pas de chantage. C’est un amour qui n’humilie pas, c’est la paix de celui qui a souffert par amour et qui peut finalement affirmer que cela en valait la peine. […]
1er octobre 2025 – Message du Pape Léon XIV à l’occasion du 10ème anniversaire de la canonisation de Louis et Zélie Martin
[…] Voici donc le modèle de couple que la Sainte Église présente aux jeunes qui souhaitent – peut-être avec hésitation – se lancer dans une si belle aventure : modèle de fidélité et d’attention à l’autre, modèle de ferveur et de persévérance dans la foi, d’éducation chrétienne des enfants, de générosité dans l’exercice de la charité et de justice sociale ; modèle aussi de confiance dans l’épreuve… Mais surtout, ce couple exemplaire témoigne du bonheur ineffable et de la joie profonde que Dieu accorde, dès ici-bas et pour l’éternité, à ceux qui s’engagent sur ce chemin de fidélité et de fécondité. En ces temps troublés et désorientés, où tant de contre-modèles d’unions, souvent passagères, individualistes et égoïstes, aux fruits amers et décevants, sont présentés aux jeunes, la famille telle que le Créateur l’a voulue pourrait sembler périmée et ennuyeuse. Louis et Zélie Martin témoignent qu’il n’en est rien : ils ont été heureux – profondément heureux ! – en donnant la vie, en rayonnant et transmettant la foi, en voyant leurs filles grandir et s’épanouir sous le regard du Seigneur. Quel bonheur que celui de se réunir le dimanche après la messe, autour de la table où Jésus est le premier invité et partage les joies, les peines, les projets et les espérances de chacun ! Quel bonheur que celui de ces moments de prières en commun, de ces jours de fête, de ces événements familiaux qui marquent le temps ! Mais aussi quel réconfort d’être ensemble dans l’épreuve, unis à la Croix du Christ lorsqu’elle se présente ; et enfin quelle espérance de se retrouver un jour réunis dans la gloire du ciel !
4 octobre 2025 – Paroles du Pale Léon XIV aux jeunes, malades et nouveaux époux, au terme de l’Audience Générale
Aujourd’hui, nous célébrons la fête de Saint François d’Assise. Pour vous, jeunes, qu’il soit un modèle de vie évangélique. Pour vous, malades, un exemple d’amour de la Croix de Jésus. Pour vous, jeunes mariés, une invitation à avoir toujours confiance dans la Providence Divine.
7 octobre 2025 – Message du Pape Léon XIV pour la 40ème Journée Mondiale de la Jeunesse, solennité du Christ Roi, le 23 novembre 2025
[…] Il est vrai qu’il n’est pas toujours facile de témoigner. Dans les Évangiles, nous trouvons souvent la tension entre l’accueil et le rejet de Jésus : « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée » (Jn 1, 5). De même, le disciple-témoin fait l’expérience directe du rejet et parfois même de l’opposition violente. Le Seigneur ne cache pas cette douloureuse réalité : « Si l’on m’a persécuté, on vous persécutera, vous aussi » (Jn 15, 20). C’est précisément cela qui devient l’occasion de mettre en pratique le commandement suprême : « Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent » (Mt 5, 44). C’est ce qu’ont fait les martyrs depuis les débuts de l’Église.
Chers jeunes, cette histoire n’appartient pas seulement au passé. Aujourd’hui encore, dans de nombreux endroits du monde, les chrétiens et les personnes de bonne volonté souffrent de persécutions, de mensonges et de violences. Peut-être avez-vous vous aussi été touchés par cette expérience douloureuse et peut-être avez-vous été tentés de réagir instinctivement en vous mettant au niveau de ceux qui vous ont rejetés, en adoptant des attitudes agressives. Mais rappelons-nous le sage conseil de saint Paul : « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien » (Rm 12, 21).
Ne vous laissez donc pas décourager : comme les saints, vous êtes appelés vous aussi à persévérer avec espérance, surtout face aux difficultés et aux obstacles.
[…]
Chers jeunes, face aux souffrances et aux espérances du monde, fixons notre regard sur Jésus. Alors qu’il était sur le point de mourir sur la croix, il a confié la Vierge Marie à Jean comme mère, et lui à elle comme fils. Ce don extrême d’amour est pour chaque disciple, pour nous tous. Je vous invite donc à accueillir ce lien sacré avec Marie, Mère pleine d’affection et de compréhension, en le cultivant en particulier par la prière du Rosaire. Ainsi, dans chaque situation de la vie, nous ferons l’expérience que nous ne sommes jamais seuls, mais toujours des fils aimés, pardonnés et encouragés par Dieu. Témoignez-en avec joie !
8 octobre 2025 – Enseignement du Pape Léon XIV lors de l’Audience Générale
Je voudrais vous inviter à réfléchir sur un aspect surprenant de la Résurrection du Christ : son humilité. Si nous réexaminons les récits évangéliques, nous réalisons que le Seigneur ressuscité ne fait rien de spectaculaire pour s’imposer à la foi de ses disciples. Il ne se présente pas avec une armée d’anges, il ne fait pas de gestes d’éclat, il ne prononce pas de discours solennels pour révéler les secrets de l’univers. Au contraire, il s’approche avec discrétion, comme un simple passant, comme un homme affamé qui demande à partager un peu de pain (cf. Lc 24, 15.41).
Marie de Magdala le prend pour un jardinier (cf. Jn 20, 15). Les disciples d’Emmaüs le prennent pour un étranger (cf. Lc 24, 18). Pierre et les autres pêcheurs le prennent pour un simple passant (cf. Jn 21, 4). Nous aurions attendu des effets spéciaux, des signes de puissance, des preuves flagrantes. Mais le Seigneur ne cherche pas cela : il préfère le langage de la proximité, de la normalité, de la table partagée.
Il y a là un message précieux : la Résurrection n’est pas un coup de théâtre, c’est une transformation silencieuse qui remplit de sens chaque geste humain. Jésus ressuscité mange une portion de poisson devant ses disciples : ce n’est pas un détail marginal, c’est la confirmation que notre corps, notre histoire, nos relations ne sont pas un emballage à jeter. Ils sont destinés à la plénitude de la vie. Ressusciter ne signifie pas devenir des esprits évanescents, mais entrer dans une communion plus profonde avec Dieu et avec nos frères, dans une humanité transfigurée par l’amour.
Dans la Pâque du Christ, tout peut devenir grâce. Même les choses les plus ordinaires : manger, travailler, attendre, s’occuper de la maison, soutenir un ami. La Résurrection ne soustrait pas la vie au temps et à l’effort, mais elle en change le sens, la “saveur”. Chaque geste accompli dans la gratitude et dans la communion anticipe le Règne de Dieu. […]
[…] La prière de l’Église nous rappelle que Dieu fait justice à tous, en donnant sa vie pour tous. Ainsi, lorsque nous crions au Seigneur : “Où es-tu ?” nous transformons cette invocation en prière, et reconnaissons alors que Dieu est là où souffre l’innocent. La croix du Christ révèle la justice de Dieu. Et la justice de Dieu c’est le pardon : Il voit le mal et le rachète, en le prenant sur lui. Lorsque nous sommes crucifiés par la souffrance et la violence, par la haine et la guerre, le Christ est déjà là, sur la croix pour nous et avec nous. Il n’y a pas de pleurs que Dieu ne console ; il n’y a pas de larmes qui restent loin de son cœur. Le Seigneur nous écoute, nous étreint tels que nous sommes, pour nous transformer tel qu’il est. Ceux qui refusent la miséricorde de Dieu, en revanche, restent incapables de miséricorde envers leur prochain. Ceux qui n’accueillent pas la paix comme un don ne sauront pas donner la paix.
Chers amis, nous comprenons maintenant que les questions de Jésus sont une invitation vigoureuse à l’espérance et à l’action : quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi en la providence de Dieu ? C’est cette foi, en effet, qui soutient notre engagement pour la justice, précisément parce que nous croyons que Dieu sauve le monde par amour, nous libérant du fatalisme. Demandons-nous donc : lorsque nous entendons l’appel de ceux qui sont en difficulté, sommes-nous témoins de l’amour du Père, comme le Christ l’a été envers tous ? Il est l’humble qui appelle les tyrans à la conversion, le juste qui nous rend justes, comme en témoignent les nouveaux saints d’aujourd’hui : non pas des héros ou des chantres d’un idéal quelconque, mais des hommes et des femmes authentiques.