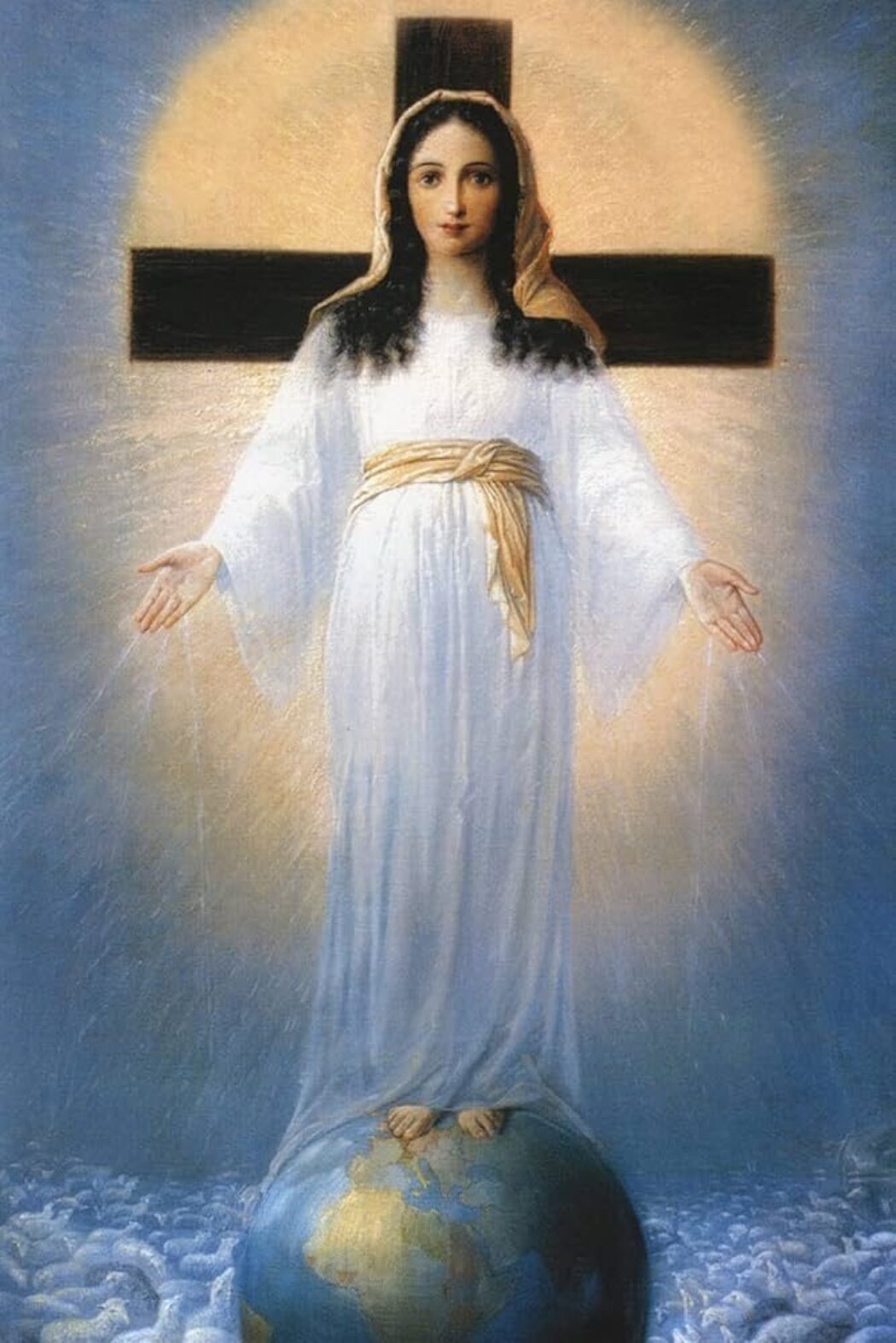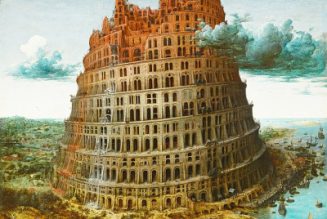Une doctrine défendue par l’abbé Claude Barthe :
Beaucoup espéraient, lorsque Jean XXIII annonça la réunion d’un second concile du Vatican, que serait incluse dans les textes de cette assemblée la doctrine de la Corédemption de Marie et de sa Médiation universelle des grâces. Il n’en fut rien, mais Paul VI proclama solennellement un nouveau titre de la Sainte Vierge, celui de Mère de l’Église, le 21 novembre 1964, sur lequel je reviendrai.
Un colloque sur la Corédemption de la Sainte Vierge va se tenir à Paris, à la Maison internationale de la Cité Universitaire, les 23 et 24 mai prochains[1], qui traitera notamment de la question mariale à Vatican II et dont les conférences tendront à relever le caractère traditionnel de cette doctrine.
En sens inverse, le 9 mars 2025, l’abbé Michel Viot a donné une émission de Radio-Courtoisie sur le thème : « Marie Corédemptrice, une explication dogmatique superflue », que l’on peut retrouver sur le site de la radio[2].
En restant comme il se doit dans une « marge de fraternité », comme disait le P. Clément Dillenschneider qui a beaucoup œuvré pour la défense de cette doctrine, je ferai ici de même, essentiellement en évoquant ses fondements et aussi ses possibles développements.
Qu’entend-on par Corédemption ?
Corédemption, Médiation : il s’agit des deux faces d’un même mystère de coopération spécifique de la Mère de Dieu à l’œuvre rédemptrice de son Fils par l’acquisition des mérites sur la terre (Corédemption) et par la distribution des grâces dans le ciel (Médiation)[3]. Les deux aspects sont liés aux échanges dans le Corps mystique du Christ entre les membres de ce Corps, qui font dire à saint Paul : « En ce moment je trouve ma joie dans les souffrances que j’endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son Corps, qui est l’Église » (Col 1, 24). Tout chrétien qui est dans la grâce du Christ adhère à l’œuvre de Rédemption et pour ainsi dire la « complète » par ses souffrances. Cela est vrai tout spécialement pour les martyrs, et de manière maximale pour la Vierge Marie, Vierge des Douleurs.
Mais lorsqu’on parle de Corédemption, on évoque plus qu’une éminence en degré : sa participation à l’œuvre rédemptrice de son Fils est spécifique car Marie est Theotokos, Mère de Dieu, comme l’a déterminé le concile d’Éphèse en 430. Toute maternité humaine s’analyse en effet comme une relation de la personne de la mère qui s’achève dans la personne de l’enfant conçu et mis au monde : celle de Marie, créature privilégiée mais restant créature, met sa personne et la Personne du Verbe en une relation ontologique singulière. « La bienheureuse Vierge est appelée la mère de Dieu, non parce qu’elle est la mère de la divinité, mais parce qu’elle est la mère selon l’humanité d’une Personne qui a la divinité et l’humanité tout ensemble » (saint Thomas, Somme Théologique, 3a, q 35, a 4, ad 2).
Si le Christ, seul Prêtre, offre le sacrifice de son Sang, la participation subordonnée de la Mère de Dieu à cette offrande rédemptrice tient à ce que son Fiat a rendu possible la Rédemption, parce qu’elle a fourni la victime du sacrifice. En outre le Christ, qui a souffert toutes les sortes de la souffrance humaine (saint Thomas, Somme théologique, 3a, q 46, a 5), assume aussi la Compassion de sa Mère qui est d’une qualité absolument unique, maternelle. Bien entendu, les mérites de la contribution de Marie à notre salut ne sont pas, comme ceux du Christ, de condigno, de plein droit. Ils ne sauraient suffire par eux-mêmes à obtenir le salut, mais ils sont de congruo, de convenance, c’est-à-dire accordés par Dieu à la prière de la Bienheureuse Vierge.
La tradition affirme, comme le relève heureusement Lumen Gentium (n. 56), à propos de saint Irénée, que la Vierge Marie, dès son Fiat, « est devenue cause du salut pour elle-même et pour tout le genre humain ». On trouve chez saint Justin dans son Dialogue avec Tryphon, puis chez saint Irénée (Contre les hérésies 3,23), chez Tertullien, saint Jérôme (l’humanité a reçu « la mort par Ève, la vie par Marie », Épître 22, 21), etc., la typologie Ève-Marie – Marie est au Nouvel Adam, ce qu’a été Ève au père de l’humanité – qui fonde ce que l’on peut dire du rôle de Marie dans notre rédemption. La participation de la nouvelle Ève à notre rédemption étant d’ailleurs plus efficace que la participation de la première Ève à notre perdition.
Les médiévaux ont usé d’un langage très fort pour exprimer cette participation. Au XIIe siècle, Arnaud de Chartres, abbé de Bonneval, en est le témoin :
« Devant le Père, le Fils et la mère partagent entre eux les offices de la miséricorde… et établissent entre eux le testament inviolable de notre réconciliation… L’affection de sa mère le touche, car il n’y avait alors qu’une volonté du Christ et de Marie, et tous deux offraient ensemble un seul holocauste, elle, dans le sang de son cœur, lui, dans le sang de sa chair[4]. »
Il est clair que si le mot de Corédemption n’était pas prononcé, la chose était affirmée, comme la transsubstantiation était crue avant que le terme ne soit forgé, et ainsi pour toutes les précisions de langage théologique.
Il d’ailleurs est intéressant de remarquer avec René Laurentin[5], sur lequel je reviendrai plus loin, que si le terme de Corédemptrice est apparu au XVe siècle c’est sous la forme d’un adoucissement de celui de Rédemptrice antérieurement utilisé comme tel ou de manière équivalente comme chez l’abbé de Bonneval. Le préfixe co explicite la subordination instrumentale de l’œuvre de Marie à celle du Christ. L’appellation n’est pas une « nouveauté » mais une précision : il n’y a pas un Rédempteur et une Rédemptrice, mais un Rédempteur et une Corédemptrice.
La Vraie Dévotion à la Sainte Vierge
L’abbé Michel Viot fait remarquer qu’il y a depuis quelques années un regain de dévotion mariale, mais que la promotion de la doctrine de la Corédemption serait nuisible à cette dévotion. On peut comparer sa critique, sans pour autant dire qu’il en dépend, à celles qui à l’époque du Concile dénonçaient l’« inflation » du discours sur la Sainte Vierge, ou au XVIIe siècle qui dénonçaient les « excès » de la littérature mariale. C’est en visant notamment ces « dévots critiques » que saint Louis-Marie Grignion de Montfort, référence de grand poids en matière de dévotion et de théologie mariales, a composé son Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge, dévotion dont le but est par essence l’attachement à Jésus-Christ par sa Mère :
« De toutes les dévotions, celle qui consacre le plus une âme à Jésus-Christ est la dévotion à la Sainte Vierge » (n. 120).
Mais Michel Viot affirme de manière étonnante que saint Louis-Marie Grignion de Montfort enseignait une dévotion en quelque sorte faible, dans la mesure où la médiation de Marie ne serait aux termes du Traité qu’une médiation d’intercession, non d’acquisition et de dispensation de grâces, et de ce fait que l’on ne trouve pas de trace de la Corédemption dans son Traité de la Vraie Dévotion. En fait, saint Louis-Marie appelle Marie ni plus ni moins que « la réparatrice du genre humain. » Il explique :
« Telle est la volonté du Très-Haut, qui exalte les humbles, que le Ciel, la terre et les enfers plient, bon gré mal gré, aux commandements de l’humble Marie, qu’il a faite souveraine du ciel et de la terre, la générale de ses armées, la trésorière de ses trésors, la dispensatrice de ses grâces, l’ouvrière de ses grandes merveilles, la réparatrice du genre humain, la médiatrice des hommes, l’exterminatrice des ennemis de Dieu et la fidèle compagne de ses grandeurs et de ses triomphes[6]. »
Il dit aussi : « Le Fils de Dieu s’est fait homme pour notre salut, mais en Marie et par Marie[7]. »Et sa prière de consécration contient cette supplication:
« Ô Mère admirable ! présentez-moi à votre cher Fils en qualité d’esclave éternel, afin que, m’ayant racheté par vous, il me reçoive par vous » (n. 29).
À propos de l’un des passages évangéliques les plus expressifs de la participation subordonnée de Marie au mystère de la rédemption, celui de la prophétie de Siméon, Michel Viot nie ainsi son lien avec la Corédemption, car selon lui les souffrances de Marie, qui s’expriment par des larmes et non du sang versé, n’ont pas de valeur propitiatoire. La critique d’« exagération » implicite vaudrait peut-être si était affirmée la parité dans le sacrifice rédempteur en prétendant que Marie a participé de condigno, comme le Christ, à la rédemption[8]. Mais saint Louis-Marie reste dans un cadre strict de Vraie dévotion et il affirme à propos de la Passion de l’un et de l’autre, qui fait qu’on parle de Compassion qu’on pourrait qualifier de Copassion :
« Voyez, à côté de Jésus-Christ, un glaive perçant qui pénètre jusqu’au fond le cœur tendre et innocent de Marie, qui n’avait jamais eu aucun péché, ni originel ni actuel. Que ne puis-je m’étendre ici sur la Passion de l’un et de l’autre, pour montrer que ce que nous souffrons n’est rien en comparaison de ce qu’ils ont souffert ![9] »
Ou encore dans son « Cantique 74 », en tout cas pour l’intensité de la douleur :
« Contemplons Marie affligée
Près de la croix du Sauveur,
Voyons sa sainte âme percée
Du tranchant d’une vive douleur.
Voyant sur un gibet infâme
L’objet de tous ses désirs,
Elle souffre plus en son âme
Que jamais n’ont fait tous les martyrs. »
À titre de parallèle adéquat, la qualité de « réparatrice du genre humain » donnée à Marie par Grignion est fortement exprimée par saint Jean Eudes, avec cette note très École française de spiritualité portant sur l’offrande du sacrifice de son Fils par Marie de manière en quelque sorte sacerdotale :
« Par l’union très étroite qu’elle avait avec son Fils, avec lequel n’ayant qu’un Cœur, qu’une âme, qu’un esprit et qu’une volonté, elle voulait tout ce qu’il voulait, elle faisait et elle souffrait en quelque façon avec lui et en lui, tout ce qu’il faisait et tout ce qu’il souffrait. De sorte que, lorsqu’il s’immolait en la croix pour notre salut, elle le sacrifiait aussi avec lui pour la même fin. […] Le Cœur de cette glorieuse Marie a contribué à l’œuvre de notre rédemption, parce que Jésus, qui est tout ensemble et l’hostie qui a été sacrifiée pour notre salut, et le prêtre qui l’a immolée, est le fruit du Cœur de cette bienheureuse Vierge, comme il a été dit ; et que ce même Cœur est aussi et le sacrificateur qui a offert cette divine hostie, et l’autel sur lequel elle a été offerte, non pas une fois seulement, mais mille et mille fois, dans le feu sacré qui brûlait sans cesse sur cet autel ; et que le sang de cette adorable victime, qui a été répandu pour le prix de notre rachat, est une partie du sang virginal de la Mère du Rédempteur, qu’elle a donné avec tant d’amour qu’elle était prête d’en donner de très bon cœur la dernière goutte pour cette fin[10]. »
Les attestations pontificales
Michel Viot ne donne pas aux paroles très nettes de Pie XI dans une allocution du 30 novembre 1933 le poids qui leur revient :
« Le Rédempteur se devait, nécessairement, d’associer sa Mère à son œuvre. C’est pour cela que nous l’invoquons sous le titre de Corédemptrice. Elle nous a donné le Sauveur. Elle l’a conduit à son œuvre de rédemption jusqu’à la Croix. Elle a partagé avec lui les souffrances de l’agonie et de la mort en lesquelles Jésus consommait le rachat de tous les hommes. »
Il ne s’agit certes pas d’une définition en forme, mais les mots sont d’une grande précision : l’association de Marie au Christ était nécessaire, d’une nécessité de congruence bien sûr ; l’invocation de Marie sous le titre de Corédemptrice est un fait établi ; le partage des souffrances rédemptrice s’explique par la donation initiale qu’elle nous a faite du Sauveur.
Auparavant, Léon XIII, dans son encyclique Adjutricem populi du 5 septembre 1895, déjà citée, où il affirmait que la réconciliation des peuples séparés de l’Église est spécialement une œuvre de Marie, écrivait, en liant coopération à la Rédemption et dispensation de grâces :
« Car de là, selon les desseins de Dieu, elle a commencé à veiller sur l’Église, à nous assister et à nous protéger comme une Mère, de sorte qu’après avoir été coopératrice de la Rédemption humaine, elle est devenue aussi, par le pouvoir presque immense qui lui a été accordé, la dispensatrice de la grâce qui découle de cette Rédemption pour tous les temps. »
Saint Pie X, dans l’encyclique Ad Diem illum du 2 février 1904 sur l’Immaculée Conception, justifie l’appellation de « réparatrice de l’humanité déchue » et de dispensatrice de toutes les grâces :
« Quand vint pour Jésus l’heure suprême, on vit la Vierge “debout auprès de la croix, saisie sans doute par l’horreur du spectacle, heureuse pourtant de ce que son Fils s’immolait pour le salut du genre humain, et, d’ailleurs, participant tellement à ses douleurs que de prendre sur elle les tourments qu’il endurait lui eût paru, si la chose eût été possible, infiniment préférable” (saint Bonaventure, I Sent., d. 48, ad Litt., dub. 4). La conséquence de cette communauté de sentiments et de souffrances entre Marie et Jésus, c’est que Marie “mérita très légitimement de devenir la réparatrice de l’humanité déchue”, et, partant, la dispensatrice de tous les trésors que Jésus nous a acquis par sa mort et par son sang. […]. Il s’en faut donc grandement, on le voit, que Nous attribuions à la Mère de Dieu une vertu productrice de la grâce, vertu qui est de Dieu seul. Néanmoins, parce que Marie l’emporte sur tous en sainteté et en union avec Jésus-Christ et qu’elle a été associée par Jésus-Christ à l’œuvre de la rédemption, elle nous mérite de congruo, comme disent les théologiens, ce que Jésus-Christ nous a mérité de condigno, et elle est le ministre suprême de la dispensation des grâces. “Lui, Jésus, siège à la droite de la majesté divine dans la sublimité des cieux” (Hébreux 1, 3). »
De même, Benoît XV, dans la Lettre apostolique, Inter sodalicia, du 22 mars 1918, parle de l’association de la Vierge Marie au rachat accompli par son Fils, association qu’on pourrait appeler co-rachat :
« Elle souffrit en effet et mourut presque avec son Fils souffrant et mourant, elle abdiqua ses droits maternels pour le salut des hommes, et autant qu’il lui appartenait, immola son Fils pour apaiser la justice de Dieu, si bien qu’on peut justement dire qu’elle a, avec le Christ, racheté le genre humain. »
Enfin, le raisonnement théologique de Pie XII, dans l’encyclique Ad cæli Reginam, du 11 octobre 1954, dans laquelle il parle de l’association de Marie à la Rédemption en s’appuyant sur la typologie Ève/Marie, est particulièrement élaboré :
« Dans l’œuvre du salut spirituel, Marie fut, par la volonté de Dieu, associée au Christ Jésus, principe de salut, et cela d’une manière semblable à celle dont Ève fut associée à Adam, principe de mort, si bien que l’on peut dire que notre rédemption s’effectua selon une certaine “récapitulation” en vertu de laquelle le genre humain assujetti à la mort par une vierge, se sauve aussi par l’intermédiaire d’une vierge ; en outre on peut dire que cette glorieuse Souveraine fut choisie comme Mère de Dieu précisément pour être associée à Lui dans la Rédemption du genre humain. »
Par ailleurs il est surprenant que l’abbé Viot voie dans les constitutions apostoliques proclamant les dogmes de l’Immaculée Conception et de l’Assomption des infirmations expresses de la doctrine de la Corédemption ? Il paraît au contraire que Pie XII, dans Munificentissimus Deus, développait le thème adjacent de l’association de Marie à l’œuvre de rachat sur le démon :
« Nous devons nous rappeler d’une manière particulière que dès le IIe siècle, les saints Pères ont désigné la Vierge Marie comme la nouvelle Ève qui, bien que soumise au nouvel Adam, est intimement associée à lui dans cette lutte contre l’Ennemi infernal et qui, comme l’avait annoncé le protévangile, a eu comme résultat final la victoire totale sur le péché et la mort. »
Le même thème adjacent se trouvait dans Ineffabilis Deus, de Pie IX, du 8 décembre 1854. Il y affirmait que le privilège de l’Immaculée Conception avait été accordé à Marie « en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain ». Affirmant que le Christ est le Rédempteur de tout le genre humain, y compris par anticipation, par prévision, de celle qui allait devenir sa Mère, il n’écartait nullement, puisqu’il disait que l’office de « réparatrice » et de « vivificatrice »– de coopératrice à la réparation et à la vivification – qui lui a été confié était contenu dans le privilège même de l’exemption du péché originel :
« [Les Pères] ont encore professé que la Très glorieuse Vierge avait été la réparatrice de ses ancêtres et qu’elle avait vivifié sa postérité ; que le Très-Haut l’avait choisie et se l’était réservée dès le commencement des siècles ; que Dieu l’avait prédite et annoncée quand il dit au serpent : “Il mettrait l’inimitié entre toi et la femme” (Gn 3, 15), et que, sans aucun doute, elle a écrasé la tête venimeuse de ce même serpent. »
La réflexion théologique sur la Corédemption
On sait que John Henry Newman (1801-1890) défendit le titre de Corédemptrice devant un prélat anglican qui lui refusait ce titre, en lui disant :
« En vous entendant l’appeler, avec les Pères, Mère de Dieu, Seconde Ève, et Mère de tous les vivants, Mère de la Vie, Étoile du Matin, Nouveau Ciel Mystique, Sceptre de l’Orthodoxie, Mère toute Immaculée de Sainteté, et ainsi de suite, [ces mêmes Pères de l’Église] auraient jugé que vous rendiez un faible hommage à de telles paroles en refusant de l’appeler Corédemptrice[11]. »
L’appellation de Corédemptrice semble en effet presque faible auprès de tant d’autres qu’accumulait saint Cyrille d’Alexandrie pour exprimer celui de Theotokos, dans la célèbre prière de son discours au concile d’Éphèse :
« Nous vous saluons, ô Marie, ô Theotokos, Trésor digne de vénération et qui appartient à l’univers entier. Lampe dont la Lumière est inextinguible. Nous vous saluons, Couronne de virginité ; Sceptre de la vraie doctrine; Temple indestructible ; Lieu de Celui qu’aucun lieu ne peut contenir ; Vierge et Mère, Il a pu grâce à vous, être nommé dans les Évangiles “Celui qui est venu au nom du Seigneur”. Et vous avez porté, dans votre Sein Virginal, l’Incompréhensible et l’Immense. C’est grâce à vous que la Sainte Trinité reçoit la gloire et l’adoration ; c’est grâce à vous que le Ciel est dans l’exultation ; que les Anges tressaillent de joie ; que les démons sont mis en fuite ; que le Tentateur est tombé des hauteurs célestes, et que la créature humaine, jadis déchue, est admise aux joies immortelles. C’est grâce à vous que toutes les créatures, après avoir connu les folies de l’idolâtrie, sont revenues à la connaissance de la Vérité. C’est grâce à vous que le Saint Baptême est donné aux fidèles, avec l’huile qui donne la force et la joie. Nous vous devons la fondation de tant d’églises sur la surface du monde, et c’est à cause de vous que nous voyons tant de nations en marche vers la Pénitence ! C’est grâce à vous (pourquoi en dire davantage ?) que le Fils unique de Dieu est apparu, comme un Être resplendissant, à la pauvre humanité qui était assise dans les ténèbres et à l’ombre de la mort. Sans vous les Prophètes n’auraient pas prononcé leurs oracles ; sans vous les Apôtres n’auraient pas prêché aux nations la doctrine du salut ; c’est grâce à vous que les morts sont rappelés à la vie et que règnent les Rois au nom de la Trinité Sainte. Mais quelles lèvres humaines pourraient dignement célébrer la Vierge Marie, qui est véritablement au-dessus de toutes les Louanges ? »
Michel Viot nous dit que parce le mystère de Marie est indicible, il faut éviter une surenchère de mots à son égard. Mais le mystère du Christ est bien plus indicible encore. Or, toute la christologie, depuis le Nouveau Testament jusqu’aux actes les plus récents du magistère n’utilise-t-elle pas des mots pour exprimer l’effet dans sa nature humaine de l’union sans confusion avec la nature divine dans la Personne du Verbe : « Premier Né », « Chef », « Tête », « Roi ». Ce dernier terme est d’ailleurs semblable aux « titres » mariaux – spécialement celui de Reine, comme j’en parlerai pour finir – et les titres utilisés pour exprimer le mystère de Marie aident en fait à parler du mystère du Christ. Le rapport entre christologie et mariologie est d’ailleurs l’équivalent du rapport entre les deux dévotions :
« C’est que, entre dévotion mariale et dévotion au Christ, il existe un lien non pas accidentel, mais essentiel[12]. »
Un courant favorable à la Corédemption avait dominé dans les années 40 et 50 du XXe siècle. Un congrès sur « Marie Corédemptrice » s’était tenu à Grenoble-La Salette en 1946, avec les interventions des théologiens spécialisés en cette doctrine, le P. Marie-Joseph Nicolas op (plus tard auteur de Theotokos, le Mystère de Marie, sur lequel je reviendrai), les PP. Rondet, Lépicier, Clément Dillenschneider (Le mystère de la corédemption mariale. Théories nouvelles, Vrin, 1951). En 1950 le P. Junipero B. Carol avait publié un monumental ouvrage historique De corredemptione beatæ Virginis Mariæ : disquisitio positiva (Polyglotte Vaticane), prodigieuse enquête sur le progrès de cette doctrine à travers les âges, à laquelle il ajoutait les résultats d’une sorte de référendum qu’il avait organisé auprès des épiscopats du monde dans le but semble-t-il de montrer que la doctrine était acquise du point de vue du magistère ordinaire et universel. Bien plus modeste, mais qui devait beaucoup au précédent, était le travail de René Laurentin, en 1951, sur Le titre de corédemptrice. Étude historique (Nouvelles Éditions latines), qui reproduisait en fait sa contribution au congrès mariologique de Rome en 1950.
La tendance s’inversa à l’approche du Concile Vatican II et par la suite. Lors du Concile, on répétait à l’envie la phrase du réformé Karl Barth : « La corédemption est une excroissance, une forme maladive de la pensée théologique. De telles excroissances doivent être amputées. Il s’agit d’un autre Évangile. » Le P. Yves Congar, op, justement par souci œcuménique, fut un des adversaires les plus virulents de ce qu’il nommait la « mariolâtrie » et qui constituait avec la « papolâtrie » un système qui, selon lui, empilait les dogmes et les condamnations et coupait le catholicisme de ses racines évangéliques : « Après l’assomption, ce sera la médiation, puis la corédemption, puis encore autre chose[13]. » Il estimait que la mariologie constituait la pierre de touche entre deux types de théologie, la sienne et celle à laquelle il s’opposait. Les cibles de son mépris : le P. Gabriele Maria Roschini, fondateur de la revue et de l’Institut Pontifical Marianum, et le P. Carlo Balić, spécialiste de Duns Scot[14].
Pie XII mort, René Laurentin devint lui-même l’un des « minimalistes », et même celui qui a combattu de la manière la plus efficace la doctrine de la médiation de toutes grâces, et par là la corédemption lors du dernier Concile[15], s’appuyant sur son ouvrage polémique, La question mariale[16], où il présentait le « maximalisme » du mouvement marial comme « un problème », qu’il qualifiait d’« excessif » et même de « pathologique »[17] dans son « exaltation inconditionnelle »[18]de la Vierge. L’abbé Laurentin lutta pour que soit retiré le titre de Mater Ecclesiæ, pour que le texte De Beata Virgine soit intégré dans Lumen Gentium et ne constitue plus un texte à part[19], et pour que soit noyé le titre de Médiatrice au milieu d’une litanie de termes analogues. Jusqu’à la fin, devenu aussi maximaliste en apparitions mariales qu’il était minimaliste en doctrine mariale, il rejeta la corédemption et la médiation des grâces[20].
Les jésuites n’ont pas été en reste. Leur théologie était parfois si avancée que la question mariale ne se posait même plus. Ainsi, le P. Joseph Moingt écrivait tranquillement :
« Nous continuerions à le croire [que Dieu est le père de Jésus], même s’il nous était raconté que Jésus est né tout normalement de Joseph et de Marie, car nous savons distinguer ce qui regarde la personne et ce qui concerne la constitution physique de l’être[21]. »
Dans un registre plus « classique », le P. Bernard Sesboüé, avec un article intitulé « Peut-on encore parler de Marie ? Pour une présentation crédible »[22], attaquait entre autres un ouvrage en deux tomes, publié aux États-Unis en 1995 et en 1997, qui avait pour titre : Marie, Corédemptrice, Médiatrice et Avocate. Fondements théologiques. Vers une définition papale ?[23], dont la moitié des contributions justifiait le titre de Corédemptrice. Bernard Sesboüé disait de ce titre « on sait combien il est ambigu, pour ne pas dire “objectivement erroné”. » Son congédiement de la Corédemption s’appuyait sur les conclusions critiques d’une commission de théologiens ayant examiné les requêtes en faveur d’une dogmatisation de cette doctrine et sur les commentaires qu’avait faits de ces conclusions l’Académie mariale internationale[24], les unes et les autres défendant « le chemin tracé par le concile Vatican II. » Pour autant, on ne saurait que souscrire à certains des principes posés par le P. Sesboüé : «Marie ne devrait jamais être isolée de l’ensemble du discours de la foi chrétienne » ; « Marie est confessée par l’Église comme “Mère de Dieu” : tout ce qui la concerne part de là et doit y revenir. » Enfin, le pape François, dans son style propre, a estimé, dans une audience du 12 décembre 2019, à propos du titre de corédemptrice qu’il n’était pas nécessaire de « perdre du temps » avec ces tonterias (absurdités, sottises, inepties).
En revanche, pour défendre la dévotion mariale se sont exprimés des auteurs comme le P. Léon Cognet, historien de la mystique, dans Les difficultés actuelles de la dévotion mariale[25], suivi par le P. Jean Stern dans son article déjà évoqué, « Marie dans le mystère de notre réconciliation », selon lequel la crise mariale pourrait être « la conséquence non pas d’un christocentrisme retrouvé, mais d’un christocentrisme déplacé de la personne aux idées, le Christ étant considéré moins comme Celui avec qui je puis avoir des relations cœur à cœur, que comme le symbole d’un idéal de justice ou autre. » Le P. Stern en concluait : « Il est clair que, dans une telle perspective, le personnage de Marie devient inutile et même gênant, en attendant que la personne du Christ devienne inutile et gênante à son tour[26]. »
Pour défendre proprement la doctrine de la Corédemption, on trouvait le P. Marie-Joseph Nicolas, dans Theotokos[27], déjà évoqué et aussi son frère, Jean-Hervé Nicolas, op, dans sa Synthèse dogmatique, où il traitait de « l’association de Marie au Christ dans la rédemption même » et du mérite de condigno de Marie dans cette participation[28]. .
Plus récemment, l’abbé Guillaume de Menthière, dans un ouvrage intitulé Marie, Mère du Salut. Marie, Corédemptrice ? Essai de fondement théologique[29], a essayé intelligemment de déminer le terrain : « Le titre de Corédemptrice, s’il convient à Marie, ne saurait être un titre de plus, il est le titre par excellence, celui qui donne sens à tous les autres. » Il notait qu’« un fort courant se dessine dans le magistère ecclésiastique en faveur d’une participation éminente de Marie à l’œuvre du salut » et aussi que « ce courant trouve par ailleurs un écho très favorable dans la piété des fidèles. » Comment ne pas y voir « le signe le plus sûr d’une tradition authentiquement valable » ? Et dans son style caractéristique, comme détaché, pesant le pour et le contre, se gardant par de nombreuses références à Vatican II, il rappelait que le terme de Corédemptrice a parcouru la littérature mariale depuis au moins le XVe siècle jusqu’à Pie X et Pie XI, et que Jean-Paul II en a usé oralement à plusieurs reprises.
Après quoi il posait une « démonstration » sous la forme d’articles de la Somme scolastique, c’est-à-dire en posant une série de questions (« Est-ce au titre de Mère de Dieu que Marie coopère à la Rédemption ? »), chacune suivie des objections tendant à répondre négativement, puis d’un sed contra, c’est-à-dire de l’argument en sens contraire d’une autorité (saint Anselme a dit : « Notre-Dame a racheté le monde alors qu’il était captif »), sur lequel s’appuie une conclusion positive argumentée (« la maternité divine est d’une certaine manière la raison d’être de tous les privilèges de Marie », dont celui de la Corédemption), laquelle permet de donner des réponses aux objections. Guillaume de Menthière allait jusqu’à justifier le titre de « Vierge-Prêtre » qu’avait donné audacieusement l’École française de spiritualité à Marie pour exprimer sa coopération à la Rédemption : Marie a offert de l’Annonciation à la Croix la Victime du sacrifice ; et s’il n’est pas question de lui attribuer un caractère sacerdotal, elle « possédait l’analogue d’un caractère dans sa qualité ontologique d’être la Mère de Dieu. »
Marie en charge de ses enfants, Marie Reine
Le Christ, qui a accompli son sacrifice rédempteur par cet acte suprême d’obéissance à son Père, a voulu le conditionner par l’acte d’obéissance de sa Mère. La participation de cette dernière à la Rédemption s’est ainsi nouée dans l’instant de l’Annonciation. L’obéissance de celle qui par son fiat devient la Mère de Dieu coopère à l’obéissance exprimée par l’Homme-Dieu conçu dans ce moment (« C’est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni oblation ; mais tu m’as façonné un corps ; tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour les péchés ; alors j’ai dit : voici, je viens, car c’est de moi qu’il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté » (Hébreux 10, 5-7).
C’est parce qu’elle est la Mère du premier né de l’humanité nouvelle que cette contribution possède une caractéristique spécifique par rapport à celle de tous les saints : elle s’applique, non au salut de telles personnes déterminées, mais au salut de tout le genre humain. Le mérite d’un juste, aussi grand qu’il soit, est particulier, mais dans son extension, le mérite de Marie est universel : tous en reçoivent le fruit.
Pie IX soulignait dans Ineffabilis Deus la sollicitude de Marie quant au salut portant sur tout le genre humain et, dans ce cadre d’application universelle, celui de l’efficacité de son intercession : elle est celle qui, « traitant elle-même l’affaire de notre salut, étend sa sollicitude sur tout le genre humain », et qui « intercède efficacement par toute la puissance des prières maternelles. » Le titre de Mère de l’Église donné par Paul VI à Marie – titre qu’évoquait le schéma préparatoire qu’il reprenait à Léon XIII dans Adjutricem populi du 5 septembre 1895, mais que les rédacteurs de Lumen Gentium omirent – n’exprime-t-il pas précisément ce droit maternel universel, sur tous les membres effectifs de l’Église, comme sur tous ses membres en puissance, appelés à l’être même si certains n’y parviendront jamais[30] ? Si bien qu’on peut dire que Marie, Mère de Dieu est Mère de tous les hommes.
Marie au pied de la Croix représentait toute l’humanité que le Christ récapitulait pour la sauver, dit Jean-Hervé Nicolas[31]. Elle devait acquiescer à cette démarche rédemptrice. C’est au nom de tous qu’elle adhérait au sacrifice de son Fils. J’ai évoqué plus haut les paroles de Pie XII dans Ad cæli Reginam, qui disait que notre rédemption s’est effectuée selon une certaine « récapitulation » par laquelle l’humanité, assujettie à la mort par la première Ève, se sauvait par l’intermédiaire de la nouvelle Ève. Et il fondait le titre de Reine qu’il lui reconnaissait sur cette « récapitulation » :
« Sans doute, seul Jésus-Christ, Dieu et homme, est Roi, au sens plein, propre et absolu du mot ; Marie, toutefois, participe aussi à sa dignité royale, bien que d’une manière limitée et analogique, parce qu’elle est la Mère du Christ Dieu et qu’elle est associée à l’œuvre du Divin Rédempteur dans sa lutte contre ses ennemis et dans son triomphe remporté sur eux tous. En effet, par cette union avec le Christ Roi, Elle atteint une gloire tellement sublime qu’elle dépasse l’excellence de toutes les choses créées : de cette même union avec le Christ, découle la puissance royale qui l’autorise à distribuer les trésors du Royaume du Divin Rédempteur ; enfin cette même union avec le Christ est source de l’efficacité inépuisable de son intercession maternelle auprès du Fils et du Père. »
N’est-il pas particulièrement opportun, en cette année où nous fêtons le centenaire de l’encyclique Quas primas de Pie XI sur la Royauté du Christ d’en rapprocher, comme le faisait Pie XII, la Royauté de Marie, liant ce pouvoir royal à son association à l’œuvre de la Rédemption et à sa dispensation des grâces sur les hommes, ses enfants ? Ne serait-il par ailleurs avantageux de développer la réflexion sur ce rapprochement de la Royauté du Christ et de la Royauté de Marie aux institutions humaines et spécialement aux nations ? Pour nous Français spécialement, dont le Christ, selon la fréquente affirmation de sainte Jeanne d’Arc est « Roi de France »[32], laquelle reconnaît la Vierge Marie comme « Reine de France » depuis qu’en 1638 Louis XIII lui consacra son royaume en lui donnant ce titre. Que la Vierge Sainte obtienne par son intercession efficace le rachat de sa fille apostate !
Abbé Claude Barthe