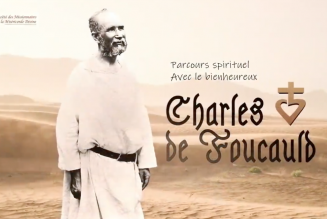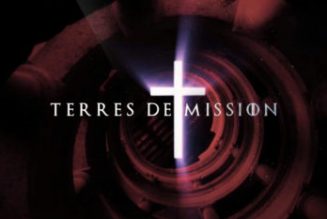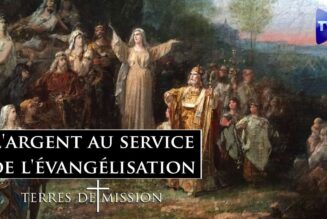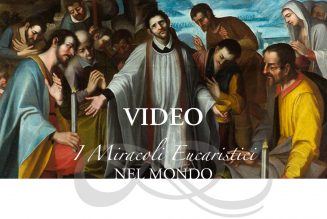L’institution du Jeudi Saint
Nous n’oublions pas que le Jeudi Saint se réfère totalement au Vendredi Saint. Toutefois, puisque c’est l’histoire et la structure des rites de la messe qui nous intéresse ici, il est normal que nous concentrions notre attention sur les rites de la toute première messe que Notre-Seigneur a célébrée au cours de la Cène, au soir du Jeudi Saint.
Les rites de l’institution de l’Eucharistie au soir du Jeudi Saint sont rapportés par quatre passages Nouveau Testament : Mt 26, 26-28 ; Mc 14, 22-24 ; Lc 22, 17-20 [ou 19-20] et 1 Co 11, 23-25].
Avec quelques variations de détail, ces quatre récits de la toute première messe qui fût célébrée nous livrent le cœur de la messe, ce que l’on peut appeler son être sacramentel : un prêtre, du pain et du vin, les paroles de la consécration : « Ceci est mon corps… Ceci est le calice de mon Sang… »
Aujourd’hui comme au soir du Jeudi Saint, lorsque le prêtre prononce sur le pain puis sur le vin les paroles de la consécration, ceux-ci sont convertis dans le Corps et le Sang du Christ et le sacrifice de Notre-Seigneur est réactualisé / renouvelé / rendu présent à l’autel : c’est le Mystère de Foi – Mysterium Fidei.
Un autre rite, qui suit la consécration, nous est révélé par les récits du Nouveau Testament. Il s’agit de la communion. : « Prenez et mangez-en tous… Prenez et buvez-en tous… » C’est le repas sacrificiel, la communion au Corps et au Sang du Christ offerts en sacrifice.
Au moment où il institua l’Eucharistie, Notre-Seigneur institua également le Sacerdoce : « Faîtes cela en mémoire de moi. » À travers les Apôtres et leurs successeurs – les évêques et les prêtres – le Mystère de la Foi que Notre-Seigneur vient de célébrer et de révéler est en quelque sorte confié à l’Église, non seulement pour qu’elle en perpétue la célébration, mais également pour qu’elle le mette en valeur.
C’est pourquoi, dès les origines le rite central de la consécration et celui de la communion furent entourés, précédés, suivis d’autres gestes, d’autres paroles, soit pour nous y préparer, soit pour manifester et expliciter ce qui se passe dans le mystère invisible.
L’Église, comme un orfèvre construira patiemment et habilement la monture magnifique que méritait la pierre précieuse confiée par Notre-Seigneur.
Les deux grandes parties de la messe
La messe a très tôt été composée de deux parties, que saint Justin indique déjà vers l’an 165 :
Le jour qu’on appelle le jour du soleil, tous, dans les villes et à la campagne, nous nous réunissons dans un même lieu : on lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes, autant que le temps le permet. Quand le lecteur a fini, celui qui préside fait un discours pour avertir et pour exhorter à l’imitation de ces beaux enseignements. Ensuite nous nous levons tous et nous prions ensemble à haute voix. Puis, comme nous l’avons déjà dit, lorsque la prière est terminée, on apporte du pain avec du vin et de l’eau. Celui qui préside fait monter au ciel les prières et les eucharisties autant qu’il peut, et tout le peuple répond par l’acclamation Amen. Puis a lieu la distribution et le partage des choses consacrées à chacun.
On distingue, dans ce témoignage antique, une partie d’enseignement et une partie eucharistique, ou mieux, sacrificielle.
La première est celle qui, aujourd’hui, suit les prières au bas de l’autel et s’étend depuis l’introït jusqu’au Credo. On l’on appelle « avant-messe » ou « messe des catéchumènes ». Elle est caractérisée par la lecture de la Parole de Dieu, accompagnée de prières, mais elle se veut être une préparation à la seconde partie, qui commence à l’Offertoire pour s’achever à la fin de la messe. Cette seconde partie, que l’on appelle « messe des fidèles », est centrée sur la consécration Corps et du Sang du Christ, suivie de la communion.
Petit à petit, cette structure antique va s’étoffer de rites particuliers, qui tendent à toujours mieux manifester la grandeur du mystère qui se déroule à la messe.
Dans les premiers siècles (jusqu’au VIe siècle)
Développement de la messe des catéchumènes
La messe des catéchumènes est un héritage partiel de la liturgie juive. Les sacrifices de l’ancienne alliance ayant été abolis par le sacrifice du Christ, l’image ayant cédé la place à la réalité, il n’était plus question d’y prendre part. En revanche, les apôtres et les premiers chrétiens convertis du judaïsme se rendaient encore à la synagogue, non seulement pour y entendre la Parole de Dieu, mais également pour annoncer que le Christ avait accompli les prophéties des Écritures. Vint cependant le moment où ils furent indésirables et, par conséquent, persécutés et chassés des synagogues. C’est alors qu’ils transposèrent, assez naturellement, le schéma de la liturgie synagogale pour le reproduire dans leurs propres assemblées et, ainsi, continuer d’enseigner les fidèles au sujet du Christ.
Un office à la synagogue comprenait, dans l’ordre, la lecture de la loi et des prophètes, le chant des psaumes, puis une homélie, et s’achevait par une bénédiction finale. À la lecture de la loi et des prophètes va rapidement s’ajouter celle des épîtres de saint Paul, puis des autres Apôtres, ainsi que la lecture des évangiles, lorsqu’ils seront écrits.
C’est ainsi qu’au IVe siècle, la messe des catéchumènes est composée de lectures, de psaumes et d’hymnes, d’une homélie et de prières litaniques.
Ainsi, la messe commençait directement par une lecture : la liturgie du Vendredi Saint a conservé cet usage. Quant aux prières litaniques finales, nous en trouvons également une trace dans les grandes oraisons du Vendredi Saint. Elles disparaîtront cependant en raison du développement des prières du Canon, qui les intégreront en partie.
Cette structure primitive va se développer :
- dès le IVe siècle le Kyrie, refrain d’une antique prière litanique grecque, est intégré à la messe romaine ;
- à partir du VIe siècle, le chant de l’Introït accompagne l’entrée solennelle du Pontife ;
- dans le contexte de la lutte contre l’hérésie arienne, on introduit l’hymne du Gloria ;
- la collecte est également introduite, et conjointement à celle-ci, l’oraison sur les oblats (notre secrète actuelle) et la post-communion ;
- on ne conserve à Rome, dès le VIe siècle, que deux lectures : l’épître et l’évangile, entre lesquelles s’intercalent le graduel et le trait ou l’alléluia.
Développement de la messe des fidèles
Tandis que la messe des catéchumènes s’est développée à partir de la liturgie synagogale, la messe des fidèles s’est développée autour des rites l’Institution du Jeudi Saint.
La partie la plus ancienne est le Canon Romain, dans lequel est enchâssée la consécration. Il est introduit par la préface – véritable chant d’action de grâce – et le chant du Sanctus – venu d’Orient. Il se conclut par une doxologie (prière à la gloire de la Sainte Trinité : Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritu Sancti, omnis honor et gloria.[2], avant la fraction de l’hostie, qui prépare la communion.
Vers 390, saint Ambroise consigne dans son ouvrage De Sacramentis le texte des prières qui accompagnent ou encadrent directement la consécration (Qui pridie…, Simili modo…, Unde et memores…, Supra quae propitio…). Il mentionne également d’autres prières, en sorte que les éléments du Canon romain attestés au IVe siècle sont les suivant :
- la Préface et le Sanctus ;
- la première prière : Te igitur… ;
- la prière Quam oblationem… qui précède le récit de l’institution ;
- l’institution proprement dite, commençant par Qui pridie… (avec la consécration) ;
- la prière d’anamnèse : Unde et memores… ;
- les deux prières suivants : Supra quae… et Supplices… ;
- la Doxologie finale.
Seront par la suite incorporés au Canon les « dyptiques », des formules d’intercession : Memento des vivants et Communicantes… avant la consécration ; Memento des défunts et Nobis quoque… après la consécration.
En amont du Canon se situe un rite d’offrande. Si les prières de l’Offertoire sont relativement récentes (fin du Ier millénaire), l’idée qu’elles expriment et l’existence d’un rite signifiant la participation des fidèles au sacrifice du Christ remontent aux origines du culte chrétien. Initialement, il consiste en une procession durant laquelle apportent les oblats – le pain et le vin – à l’autel. Saint Irénée de Lyon, au IIe siècle, connaît ce geste et en précise le sens :
Il nous faut présenter une offrande à Dieu et témoigner en tout notre reconnaissance au Créateur en lui offrant, dans des dispositions pures et une foi sans hypocrisie, dans une espérance ferme, dans une charité ardente, les prémices de ses propres créatures […] ; l’eucharistie est constituée de deux choses, l’une terrestre, l’autre céleste […].[3]
Ce geste d’offrande donne lieu à l’élément le plus ancien de notre offertoire : les prières sur les oblats – nos secrètes actuelles. Elles présentent une orientation sacrificielle très marquée, que les prières de l’offertoire développeront par la suite.
L’ensemble des rites qui suit le Canon est orienté vers la communion. Le Pater qui suit immédiatement le Canon occupe cette place depuis saint Grégoire le Grand (mort en 604). Viennent ensuite les rites de la fraction et de la commixtion, dont l’origine est très antique. Le chant de l’Agnus Dei a quant à lui été introduit par le pape Serge Ier, mort en 701.
Suite du développement de la messe
Du VIe au XIe siècle, la liturgie franque va fortement influencer la messe romaine. Elle se signale particulièrement par le goût de la splendeur des cérémonies. Apparaissent ainsi les nombreux signes de croix au cours du Canon, la procession de l’évangile, les rites d’habillement et divers éléments contribuant à la solennité de la messe pontificale.
À la fin du VIIIème siècle, alors que certaines erreurs continuaient de circuler à propos du Christ, on prit l’habitude de proclamer le texte du Credo dans la chapelle de l’empereur Charlemagne. L’usage se répandit en Europe aux IXè et Xè siècles, et fut admis progressivement dans la messe romaine.
En parallèle, à partir du VIIe siècle, le missel va s’enrichir de nombreuses prières. Ce sont d’abord des prières privées du prêtres célébrant la messe. Cependant, en raison de leur beauté formelle et leur justesse doctrinale, elles vont trouver place dans le missel lui-même. Sont ainsi introduites :
- les prières d’habillement du prêtre ;
- les prières au bas de l’autel ;
- les prières de la montée à l’autel (Aufer a nobis…, Oramus te…) ;
- les prières qui accompagnent l’encensement ;
- les prières de l’Offertoire, parmi lesquelles les plus anciennes (Suscipe sancta Trinitas…, Orate fratres…) remontent au VIIe siècle, tandis que les plus récentes datent du Xe siècle ;
- les trois prières avant la communion ;
- le Placeat…, récité en silence avant la bénédiction finale.
Ces prières ont un ton plus personnel ; le « je » y remplace souvent le « nous » ; le prêtre y confesse son indignité et implore la justification divine. Elles ont pour but de mieux préparer et accompagner le prêtre dans l’action sacrée. Elles servent également d’inspiration pour l’attitude des fidèles et tendent à expliciter l’action qui s’accomplit.
Un dernier ajout marquant intervient au XIIIe : il s’agit de l’introduction (ou de la généralisation) de l’élévation de l’hostie, puis du calice juste après la consécration.
Conclusion
Tels sont les rites que comporte intégralement le missel de la Curie Romaine au XIIIe siècle. Ce missel va se répandre dans toute l’Europe, notamment grâce à l’influence des Franciscains qui l’adoptent.
À quelques détails près, tel l’introduction du Dernier Évangile, c’est ce même missel que saint Pie V, répondant au vœu des Pères du Concile de Trente, promulgue en 1570 dans la Bulle Quo Primum Tempore. Ce missel que l’on appelle aujourd’hui « tridentin » n’a donc pas été composé à l’occasion ou à la suite du Concile de Trente. Le pape a seulement déterminé que ce missel, qui existait avant lui, qui résultait d’une longue maturation et d’un développement organique, qui jouissait déjà d’une pratique éprouvée, constituerait la référence. Il a d’ailleurs permis à tout rite qui pouvait se prévaloir de plus de 200 ans d’ancienneté de demeurer et d’exister (c’est le cas des rites de Milan – Ambrosien, Lyon, Braga… du rit dominicain ou encore du rit cartusien).
Ainsi, la liturgie tridentine n’est pas une invention, elle n’a pas été créée par décret. Elle est le fruit d’une vie et d’un développement organique, ses origines se confondent avec celles de l’Église.
Cette vie ne s’est d’ailleurs pas arrêtée à Rome en 1570. D’une part, l’on a continué d’ajouter les fêtes des nouveaux saints et d’apporter quelques modifications de détail dans les textes – comme l’introduction de saint Joseph au Canon ou d’une nouvelle préface pour les défunts – et dans les rubriques. Selon les lieux, le missel a également accueilli les fêtes des saints locaux, certaines préfaces particulières, voire des usages propres qui sont passés dans la coutume.