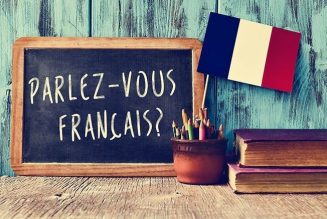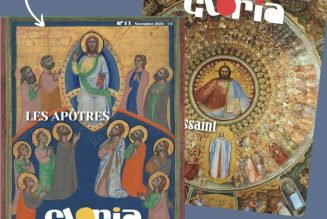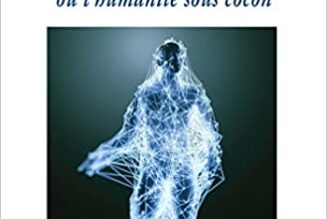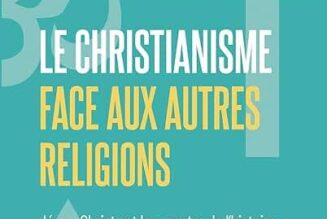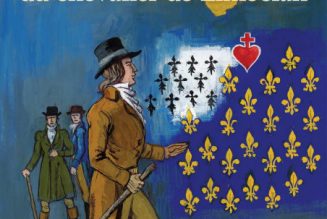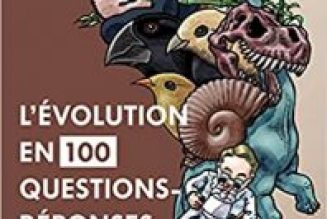Du père Danziec dans Valeurs Actuelles :
La logique qui regarde le bébé panda devrait être la même que celle qui concerne les enlumineurs sur parchemin : toute espèce en voie de disparition réclame, pour survivre, d’être protégée. Tant pour le monde animal que pour ce qui relève de notre patrimoine immatériel.
En titrant son analyse magistrale – au parfum de testament – La fin d’un monde (Albin Michel), Patrick Buisson soulignait l’ampleur du problème. Les fondements de ce qui a pu construire notre identité collective, favoriser le lien social, entretenir une mémoire commune se sont trouvés dynamités non pas seulement par une pensée unique mais par une standardisation navrante. Finis les costumes régionaux, bonjour les T-shirt Mickey pour tous. Oubliées les ritournelles de nos campagnes, bienvenue aux tubes internationaux qui résonnent dans les supermarchés.
Tel un sage délivrant ses ultimes leçons sur la vie et l’observation du monde, le pape Jean-Paul II offrait à ses lecteurs un précieux témoignage dans ce qui fut son dernier livre, publié en 2005, année de sa mort. Le titre de l’ouvrage donnait le ton : Mémoire et identité (Flammarion). Le pape polonais y faisait le constat que « Les pays d’Europe occidentale se trouvent aujourd’hui à un stade que nous pourrions qualifier de “post-identité” ». Il pressait alors ses contemporains et les générations à venir à s’interroger : comment faire en sorte que la culture – qui est un bien supérieur à l’économie, « plus grand, plus humain »– ne soit pas détruite au profit de la civilisation de l’argent, « au profit du pouvoir excessif d’un économisme unilatéral » ? Celui qui a vécu avant son accession au trône de Pierre dans une Pologne mutilée, d’abord par le nazisme puis par le communisme, sait quels furent les ressorts de la survie psychologique de son peuple. Dans un discours prononcé au début de son pontificat au siège de l’Unesco, à Paris, à l’occasion de son premier voyage en France, Jean-Paul II avertissait son auditoire : « L’avenir de l’homme dépend de la culture. » On mesure aujourd’hui, dans le grand flou identitaire qui domine, la valeur prophétique de ces paroles délivrées en 1980. L’articulation d’une telle réflexion était pourtant simple. L’athlète de Dieu était aussi philosophe et, selon lui, la culture possède cet atout de rendre plus humain l’homme. Elle le civilise. La culture, affirmait-il, est un mode spécifique de l’exister et de l’être de l’homme. « La culture est ce par quoi l’homme en tant qu’homme devient davantage homme, “est” davantage. » Sous ce regard, le concept de Nation est appréhendé comme un espace protecteur : la grande communauté des hommes qui sont unis par des liens divers, mais surtout précisément par la culture. Le Saint-Père d’insister : « La Nation existe par la culture et pour la culture ». Grande éducatrice des hommes donnant à “être davantage” dans une communauté nationale possédant une histoire qui dépasse celle de l’individu et de la famille.
La culture remonte dès son origine à deux acceptions. Du latin « cultura », ce terme correspond à la fois à la « culture de la terre » (l’agriculture) mais aussi au « culte des ancêtres » (la piété filiale). Ainsi, la matrice originelle du mot « culture » se réfère à la terre et aux morts. Faire fructifier la première, en même temps que se souvenir avec respect de ceux qui l’ont travaillée avant nous. « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? Et si tu l’as reçu, pourquoi t’en glorifies-tu comme si tu ne l’avais pas reçu ? » s’interrogeait déjà saint Paul (1 Cor 4, 7).
Notre filiation nous fait naître sans mérite de notre part dans un peuple déterminé, sur un continent déterminé, dans une nation, dans une province, dans un milieu, dans une famille, qui ont eux-mêmes un passé, des traditions, des usages, une langue, une manière de concevoir l’existence. De tout cela, nous héritons. La filiation nous fait aussi grandir sur une terre particulière, dans des paysages, dans des bruits, dans des odeurs qui vont impressionner notre sensibilité. La liste des réalités qui interviennent dans notre construction personnelle et qui nous constituent pourrait être longue. Une chose est certaine : notre âme, cultivée par l’éducation selon le mot de Cicéron, reçoit de ce labourage intérieur une conception du vrai, du beau et du bien. Cette culture de l’âme se réalise dans des conditionnements liés à notre filiation, à celle qu’ont reçue nos parents, et ainsi de suite. L’universel, qui serait inaccessible sans la culture, nous est rendu sensible à travers les médiations propres à notre environnement.
Pourquoi cette réflexion en ce dimanche des Rameaux ? Parce qu’un tout récent article du Figaro fait état de la menace de disparition qui pèse sur les fêtes traditionnelles de nos terroirs. Ces festivités issues de notre passé, de notre gastronomie, de nos traditions agricoles, de nos coutumes, de nos arts de vivre régionaux, qui animaient nombre de villages et qui constituaient des rendez-vous annuels marqueurs de sens, s’effacent peu à peu. Faute de soutien financier des collectivités et de bénévoles, 30% de ces fêtes traditionnelles ont disparu en quatre ans indique une étude menée par Infopro.
On ne peut que se réjouir de l’heureuse initiative entreprise par lesplusbellesfetesdefrance.fr, association qui entend rassembler les amoureux des traditions françaises. Son but ? Proposer de labelliser ces fêtes pour mieux défendre leur survie, grâce à un jury composé de journalistes, d’élus et de mécènes. « Plus que de simples manifestations folkloriques, ces célébrations incarnent l’âme d’un peuple, la mémoire d’une région et la transmission vivante d’un patrimoine immatériel. Leur disparition signifierait non seulement une perte irréparable pour notre identité collective, mais aussi un appauvrissement du lien social qui tisse nos communautés » explique avec enthousiasme Thibault Farrenq, architecte de ce projet.
Occasion de rappeler, avant d’entrer dans la Semaine Sainte, qu’il est un lieu, un cadre privilégié entre tous, pour tisser et créer du lien. Celui de se retrouver dans une même âme, au sein d’une même nef, tournés vers les mêmes mystères qui ont fondé l’âme du doux royaume de France : célébrer la mort et la résurrection du Christ, et se mettre à l’école de son Evangile seul en mesure de pacifier nos mœurs. Et de donner un souffle inégalé à nos traditions les plus simples.