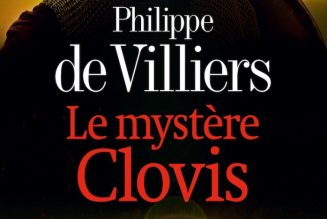Olivier Hanne, docteur et agrégé en Histoire, vient de publier Le Génie historique du catholicisme. Il a bien voulu répondre aux questions du Salon Beige.
1) Votre livre est, d'une certaine façon, un antidote à la fameuse "légende noire" du catholicisme. Y a-t-il vraiment matière à être fiers de nos aïeux dans la foi ?

Nos ancêtres ont assumé leur foi selon les conditions que la société, l'Histoire et la Providence leur avaient données. La juste mesure du passé est de jauger en fonction des critères moraux qui étaient les leurs. Ainsi, les critiques contre l’Inquisition paraissent singulièrement rares jusqu’au XVIe siècle, et il n’est pas sûr que les médiévaux aient considéré les inquisiteurs comme des brutes ignobles. Le pape Innocent III (1198-1216) souvent perçu comme un pontife de fer, déclenchant la 4e croisade et la croisade des Albigeois, a souvent été critiqué pour s’être fait duper par le roi de France.
2) La plus grosse erreur de l'historien est clairement l'anachronisme. Cette erreur n'est-elle pas, pourtant, la plus commune pour tous ceux qui se penchent sur l'histoire de l'Eglise pour la juger à l'aune de nos critères ?
Ce qui est difficile à envisager pour nos contemporains est de parvenir à regarder le passé sans les oeillères du manichéisme et du positivisme : non, l’Histoire n’est pas une marche ascendante vers un progrès, condamnant nos prédécesseurs à un état inférieur dans le développement humain et moral. Finalement, nous sommes restés cruellement linéaires et scientistes dans notre approche du temps, erreur que n’a jamais commise l’Eglise : à toute époque, péché et grâce se mêlent, et la modernité technique n’est jamais un gage de progrès spirituel.
Mais cette carence intellectuelle sur le passé se retrouve chaque jour dans notre analyse du monde et de la géopolitique, ainsi concernant le Moyen-Orient. L’anthropologie et la sociologie des années 1970-1980 ont envahi toute notre approche du passé : les faits n’existent que par le regard qu’on leur porte, et tout n’est que représentation et manipulation du pouvoir. Louis XIV n’intéresse l’historien que par l’image qu’il renvoie du pouvoir monarchique, et non pas par sa législation ou ses actes. Mais en niant ainsi le réel, l'intellectuel est vite prisonnier de ses propres fantasmes et de ses opinions, il devient lui aussi un instrument au service des médias : le siège d’Alep importe moins que ce qu’on en dit ; si l’Eglise développe l’action caritative au Moyen-Âge, ce n’est pas pour aider les pauvres, mais pour les contrôler, et tous les faits sont ainsi réinterprétés…
3) Votre livre est titré "Le génie historique du catholicisme". Comment, dans l'histoire, définiriez-vous l'apport du catholicisme à l'humanité en général et à l'Europe en particulier ?
L’aspect le plus évident est que le christianisme a apporté le Christ, mais il y a un apport plus spécifique du catholicisme, c’est la révélation du Christ à travers une double incarnation de civilisation : la foi intérieure et la culture gréco-latine. Le catholicisme a éduqué les peuples qu’il a convertis à l’intériorité, au retour sur soi, propice à la découverte de Dieu, mais aussi à moyen terme à l’éclosion de la conscience. Il a aussi fait fructifier la culture millénaire grecque et latine et l’a portée à son plein épanouissement à travers la philosophie, la théologie, le droit, les belles lettres, une pratique spécifique du pouvoir.
4) L'Eglise a beaucoup aidé la civilisation européenne à découvrir la dignité de la personne humaine. En abandonnant ses racines chrétiennes, l'Europe ne risque-t-elle pas d'abandonner ce souci de la dignité humaine qui a fait sa grandeur ?
Bien sûr. Le catholicisme a transmis à l’Europe un christianisme hellénisé, c'est-à-dire une foi indissociable d’une doctrine rationnelle, de l’amour de l’étude et de la connaissance, qui attachent la personne au contrôle de soi et de ses passions. En perdant le catholicisme, nous voyons combien nos contemporains ont du mal à argumenter leurs convictions, à justifier leur foi par une parole libre et raisonnable, ainsi qu’à maîtriser leurs pulsions. Ce n’est pas seulement le rapport au Christ qui est menacé, mais bien tout le rapport au monde et à soi-même.
5) La mission de l'Eglise est de transmettre la foi. Pourtant, de cette transformation est née une civilisation (et même plusieurs, car la civilisation européenne n'est pas la sud-américaine, ni la nord-américaine…). Est-ce une sorte de paganisation, comme la Réforme en a volontiers accusé la Chrétienté médiévale, ou simplement une irrigation de la foi dans tous les actes de la vie?
La Chrétienté médiévale est atteinte au XIIIe siècle lorsque le droit canon et les sacrements rayonnent dans toute la société, faisant de l’Eglise l’institution la plus normative, au sens où c’est elle qui génère les normes de la vie quotidienne, avant même les monarchies. Mais cet apogée ne dura pas au-delà du XIIIe siècle, puisque l’étape suivante fut la fondation des nations. On a peine à imaginer à quel point nous sommes loin de cette Chrétienté unitaire et universelle. A l’époque, l’identité nationale ne se pose pas : vous avez en pleine France des évêques qui sont d’origine italienne, allemande ou anglaise. A l’époque, la première marque identitaire des personnes est celle du baptême. Mais ce système social unique, garanti par la papauté, était trop vaste, trop contesté pour pouvoir durer.
6) Il est d'usage d'opposer l'Eglise et la science. Vous affirmez qu'au contraire, la science moderne doit beaucoup au catholicisme. N'est-ce pas pousser un peu loin le goût du paradoxe et de la provocation ?
Nullement, puisque l’écrasante majorité des hommes de science entre le XIe et le XVIIe siècle sont des religieux ou des clercs ; leurs recherches sont permises par leur éducation catholique, elle aussi religieuse, assurée par les congrégations ou les jésuites. Leur capacité à énoncer, critiquer et synthétiser est une compétence puisée dans l’école catholique. Le goût de l’expérimentation leur venait de la redécouverte d’Aristote et de son officialisation à travers le thomisme. Si le réel est porteur d’idées divines, alors l’observation de ce réel devient une découverte de Dieu. De la même façon, lorsque les mouvements mendiants, comme les franciscains, renoncent au couvent ou au monastère pour une vie d’itinérance, de pauvreté et de souffrance, ils expriment combien le quotidien le plus trivial est porteur de sainteté. Le XIIIe siècle est le grand siècle du réel, qui ouvre la porte sur l’expérience, et donc sur les sciences modernes.