Intéressant rappel historique d’Alain Sanders :
En octobre 1944, les Japonais comprennent que la victoire des Alliés n’est désormais qu’une question de mois. C’est donc à partir de cette période que le gouvernement impérial, qui ne veut pas perdre la face, prend la décision de ne pas lâcher l’Indochine où ses troupes sont installées depuis 1940. Avec un mot d’ordre qu’il veut croire rassembleur : l’Asie aux Asiatiques.
Dans une étude qui fait autorité, La Désinformation autour de la fin de l’Indochine française (1), Paul Rignac écrit : « Or, c’est au moment où l’Indochine court le plus grand danger depuis le début du conflit, au moment où le jeu devient de plus en plus serré pour le gouvernement colonial, que la Métropole réduit ce gouvernement à néant ».
La dyarchie imbécile, imposée par François de Langlade, prive l’amiral Decoux de toute autorité. Dans le même temps, des gaullistes, aussi frénétiques qu’irresponsables, répandent la rumeur d’une possible résistance armée et d’un tout aussi probable débarquement allié.
La résistance armée – déjà faudrait-il avoir des armes – est une chimère. Un débarquement ? Les Anglo-Saxons ne l’ont jamais envisagé. Ce n’est pas le sauvetage de quarante mille Français d’Indochine, ou ce qui en restait, qui pouvait justifier le sacrifice de milliers de GI’s dans une telle opération.
A la veille du 9 mars 1945, le général Mordant, patron occulte, mais effectif de l’Indochine, et son adjoint, le général Aymé, commandant supérieur, sont (malgré de nombreux signes avant-coureurs relevés par nos services) formels : il n’ y a pas à craindre un coup de force nippon ! Même le passage en Chine, du jour au lendemain, de tous les patrons de maisons de jeu chinoises, ne suffit pas à les sortir de leur autisme politique.
De leur côté, les Japonais montent une intox qui va fonctionner pleinement : ils laissent filtrer que le coup de force est prévu pour le 8 mars. Du coup, Mordant s’affole. Le 8, il consigne les troupes dans leurs casernes. Et rien ne se passe. Aussi, quand les services de renseignement se réveillent enfin et annoncent : « C’est pour demain, c’est pour le 9 », Mordant et Aymé refusent-ils de les croire…
Face à la légèreté, pour ne pas dire plus, de ces deux hommes, le général Sabattier et son adjoint, le général Alessandri, prennent des mesures. Ils mettent leurs hommes en état d’alerte, puis leur ordonnent de quitter leurs casernements et de prendre le maquis. Sabattier regagne son PC de campagne à Phu Doan et Alessandri organise l’évacuation du Tuong et emmène ses troupes vers Son La et la Haute Région.
Le 9 mars, l’amiral Decoux reçoit l’ambassadeur japonais, Matsumoto. A 19 heures, Matsumoto remet à Decoux un ultimatum exigeant que les troupes françaises passent dans l’heure sous commandement japonais. Un ultimatum pour la frime : à 18 heures 30, dans la baie d’Along, les Japonais ont déjà attaqué le 19e RIC et capturé au passage le résident Georges Pisier.
L’amiral Decoux rejette l’ultimatum. A 21 heures 15, il est arrêté au palais Norodom avec ses adjoints.
Et le général Mordant ? Rien de bien glorieux : « Il se trouvait à Hanoi et gagna, en civil, ses bureaux de la Citadelle au début de l’attaque. Alors que les troupes françaises (notamment les hommes du 9e RIC, du 1er RTT, du 4e RAC et de la Légion) se sacrifiaient dans une défense acharnée contre les Japonais, Mordant abandonne la place. Il s’enfuit par les égouts, se blesse à une jambe en sautant un parapet et va se réfugier à proximité de la Citadelle, dans la villa du médecin général inspecteur Botteau-Roussel » (Paul Rignac, op. cité).
L’Opération Mei, selon le nom de code donné par les Japonais à leur coup de force, se déroule brutalement. Plusieurs officiers administrateurs sont exécutés sur le champ. A Lang Son, le colonel Robert, le résident Auphelle, le général Lemonnier, sont décapités. A Takheh, l’administrateur Colin et l’inspecteur Grethen sont assassinés.
A Dong Dang, le commandant Soulié est tué après avoir repoussé, avec des moyens dérisoires, trois assauts. Le capitaine Anosse le remplace. Trois jours et trois nuits de résistance héroïque. A court de munitions, la garnison est décimée. Les Japonais massacrent Anosse et 400 prisonniers. A Hanoi, la Citadelle va tenir vingt heures – à un contre dix – avant d’être submergée par l’ennemi. Le capitaine Regnier, qui a refusé de se rendre, est capturé, torturé et assassiné.
Les actions héroïques – pour l’honneur – sont nombreuses. Toujours à Hanoi, le lieutenant Damez résiste quatre-vingt-six heures et réussit à décrocher avec quelques hommes en forçant le passage. Au quartier Balny, le lieutenant Roudier tient jusqu’à l’aube. A Hué, retranchés dans la Légation, le capitaine Bernard, le lieutenant Hamel et une vingtaine d’hommes résistent toute la nuit à trois compagnies nippones équipées de blindés et d’artillerie. Etc.
Le bilan est lourd. En moins de quarante-huit heures, sur les 34 000 Français présents dans la région et les 12 000 militaires métropolitains, plus de 3000 ont été tués. Les autres ont été emprisonnés dans des camps de la mort. Toute l’Indochine, Annam, Tonkin, Cochinchine, Cambodge, Laos, est aux mains des Japonais.
Au Tonkin, Sabattier et Alessandri, à la tête de quelques milliers de combattants, ne lâchent rien. Une grande partie d’entre eux sont tués. D’autres se réfugient dans la brousse. Avec quelques centaines d’hommes – la « colonne Alessandri » – le général Alessandri réussit à passer en Chine.
Le Japon décrète la fin de l’administration française et incite fortement à la formation de régimes indépendants (à sa botte évidemment). Bâo Dai obtempère et proclame, sous le nom d’Empire du Vietnam, l’indépendance de l’Annam et du Tonkin. Norodom Sihanouk, jamais en retard d’une trahison, proclame l’indépendance du Cambodge.
Les Laotiens sauvent l’honneur. A Luang Prabang, le roi Sisavang Vong appelle son peuple à aider les Français et à combattre l’envahisseur nippon. Le 4 avril, les Japonais viennent l’arrêter et confient le pouvoir au prince collaborationniste Phatsarah Rattanavonga.
Sous la direction de Ho Chi Minh et de Vo Nguyen Giap, le Vietminh profite de la confusion et installe des « comités révolutionnaires populaires ». A part des escarmouches sans conséquences avec les Japonais (comme à Tan Doa), les Viets ont d’autres priorités : l’élimination physique des trotskistes vietnamiens.
Au Laos, avec peu d’armes et encore moins de munitions, la guérilla franco-lao harcèle héroïquement les troupes japonaises.
Après Hiroshima et Nagasaki, le 15 août, la capitulation japonaise est acquise. Jamais en retard d’une félonie, De Gaulle écarte le général Sabattier et nomme un de ses zélotes, Thierry d’Argenlieu, haut-commissaire pour l’Indochine.
Le 2 septembre, Ho Chi Minh proclame l’indépendance du pays au nom du « gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam ». Une déclaration suivie d’attaques sanglantes contre les Européens, les Eurasiens et les Vietnamiens pro-français. Des massacres sans nombre, dans des conditions de sauvagerie indescriptibles, des centaines de morts, hommes, femmes et enfants (à la cité Hérault de Saigon, par exemple).
Il faudra attendre octobre (Leclerc a débarqué le 5 du mois) pour commencer à désarmer les Japonais. Decoux est rapatrié en France. Pour y être jugé… Sur place, on épure sauvagement des fonctionnaires et des militaires français à peine libérés des camps de concentration japonais.
La situation de 1945 est le prologue de la guerre d’Indochine. L’épuration viendra opportunément servir une occultation des faits et une manipulation de la mémoire collective. L’Indochine française n’est morte ni à Dien-Bien-Phu ni à Genève. Elle a cessé d’exister le 9 mars 1945. Avec la légende noire gaulliste qui s’est imposée, en un habituel compagnonnage, avec une désinformation communiste tous azimuts.
Alain Sanders


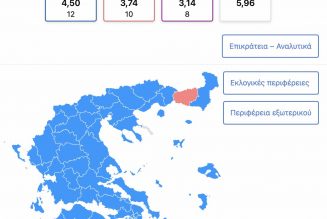

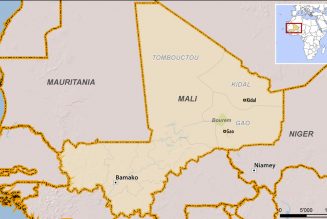

Giacomo
Un fait d’armes occulté et ignoré (parce que non gaulliste…) bien avant le coup de force nippon, fut la destruction de la marine de la Thaïlande, alliée du Japon, par les maigres forces navales françaises d’Indochine (Le “Lamotte-Picquet”, un vieux croiseur, et quelques avisos coloniaux, quelques hydravions de reconnaissance…) en un raid audacieux et très bien préparé le 17 janvier 1941 sur la baie de Koh-Chang où elle était mouillée.
Cette victoire improbable incita les japonais à la prudence dans les visées qu’ils avaient sur l’Indochine, surestimant le nombre et la valeur de nos forces.
C’est à ma connaissance l’une des dernières batailles navales livrées victorieusement dans l’histoire de la “Royale”.
Le “Lamotte Picquet” fut détruit ultérieurement par les bombes américaines en 1945.