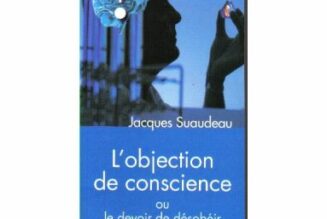Mgr Vigano réagit à Traditionis Custodes. Extrait :
Vous qui vous permettez d’interdire la Sainte Messe apostolique, l’avez-vous jamais célébrée ? Vous qui, du haut de vos chaires liturgiques, prononcez des jugements péremptoires sur la « vieille Messe », avez-vous jamais médité sur ses prières, ses rites, ses gestes anciens et sacrés ? Je me suis posé cette question à plusieurs reprises ces dernières années ; parce que moi-même, qui connais cette Messe depuis mon enfance, qui, lorsque je portais encore des pantalons courts, avais appris à la servir et à répondre au célébrant, je l’avais presque oubliée et perdue. Introibo ad altare Dei. A genoux sur les marches glacées de l’autel avant d’aller à l’école en hiver ; transpirant sous ma robe d’enfant de chœur dans la canicule de certains jours d’été. Je l’avais oubliée, cette Messe, bien qu’elle fût celle de mon Ordination, le 24 mars 1968 : une époque où l’on percevait déjà les signes de cette révolution qui sous peu allait priver l’Église de son trésor le plus précieux pour imposer un rite contrefait.
Eh bien, cette Messe, que la réforme conciliaire a effacée et interdite dans mes premières années de Sacerdoce, demeurait comme un souvenir lointain, comme le sourire d’un être cher éloigné, le regard d’un parent disparu, le son d’un dimanche avec ses cloches, ses voix amicales. Mais c’était quelque chose qui relevait de la nostalgie, de la jeunesse, de l’enthousiasme d’une époque où les engagements ecclésiastiques étaient encore à venir, où nous voulions tous croire que le monde pouvait se relever de l’après-guerre et de la menace du Communisme avec un élan spirituel renouvelé. Nous voulions croire que la prospérité économique pouvait en quelque sorte s’accompagner d’une renaissance morale et religieuse du Pays. Malgré les soixante-huitards, les occupations [d’usines ou d’universités], le terrorisme, les Brigades Rouges, la crise du Moyen-Orient. Ainsi, parmi les nombreux engagements ecclésiastiques et diplomatiques, s’était cristallisé dans ma mémoire le souvenir de quelque chose qui était resté en fait non résolu, mis « temporairement » de côté, pendant des décennies. Quelque chose qui attendait patiemment, avec l’indulgence que seul Dieu utilise à notre égard.
Ma décision de dénoncer les scandales des Prélats américains et de la Curie Romaine a été l’occasion qui m’a amené à considérer, sous un jour différent, non seulement mon rôle d’Archevêque et de Nonce Apostolique, mais aussi l’âme de ce Sacerdoce que mon service au Vatican d’abord et plus récemment aux États-Unis avait en quelque sorte laissé incomplet : plus pour mon être de prêtre que pour le ministère. Et ce que je n’avais pas compris jusqu’alors m’est apparu clairement à travers une circonstance apparemment inattendue, lorsque ma sécurité personnelle semblait menacée et que je me suis retrouvé, malgré moi, à devoir vivre presque caché, loin des palais de la Curie. Ce fut alors que cette ségrégation bénie, que je considère maintenant comme une sorte de choix monastique, m’a amené à redécouvrir la Sainte Messe tridentine. Je me souviens bien du jour où, au lieu de la chasuble moderne, j’ai revêtu les ornements traditionnels, avec le cappino ambrosien et le manipule : je me souviens de la crainte que j’ai ressentie en prononçant, après presque cinquante ans, ces prières du Missel qui ressurgissaient dans ma bouche comme si je les avais récitées peu de temps auparavant. Confitemini Domino, quoniam bonus, au lieu du psaume Judica me, Deus du rite romain. Munda cor meum ac labia mea. Ces paroles n’étaient plus celles de l’enfant de chœur ou du jeune séminariste, mais celles du célébrant, celles que je prononçais moi-même, qui, de nouveau, j’oserais dire pour la première fois, célébrais devant la Très Sainte Trinité. Car il est bien vrai que le prêtre est une personne qui vit essentiellement pour les autres – pour Dieu et pour le prochain – mais il est également vrai que s’il n’est pas conscient de sa propre identité et ne cultive pas sa propre sainteté, son apostolat est aussi stérile que le tintement d’une cymbale.
Je sais que ces réflexions peuvent laisser impassible, voire susciter la pitié, chez ceux qui n’ont jamais eu la grâce de célébrer la Messe de toujours. Mais la même chose arrive, j’imagine, à ceux qui n’ont jamais été amoureux et ne comprennent pas l’enthousiasme et le chaste transport du bien-aimé vers sa bien-aimée, pour ceux qui ne connaissent pas la joie de se perdre dans ses yeux. Le morne liturgiste romain, le Prélat avec son clergyman taillé sur mesure et sa croix pectorale dans sa poche de poitrine, le consulteur de Congrégation avec le dernier exemplaire de Concilium ou de la Civiltà Cattolica bien en vue, regardent la Messe de saint Pie V avec les yeux de l’entomologiste (la science de l’étude des insectes), scrutant ce Missel comme un botaniste observe les nervures d’une feuille ou les ailes d’un papillon. Je me demande parfois s’ils ne le font pas avec l’insensibilité du chirurgien qui découpe avec son bistouri un corps vivant. Mais si un prêtre doté d’un minimum de vie intérieure s’approche de l’ancienne Messe, qu’il l’ait toujours connue ou qu’il la découvre pour la première fois, il est profondément secoué par l’ineffable majesté du rite, comme s’il sortait du temps pour entrer dans l’éternité de Dieu.
Ce que je voudrais que mes Frères dans l’Épiscopat et dans le Sacerdoce comprennent, c’est que cette Messe est intrinsèquement divine, car on y perçoit le sacré de manière viscérale : on est littéralement ravi au ciel, en présence de la Très Sainte Trinité et de la Cour céleste, loin du bruit du monde. C’est un chant d’amour, dans lequel la répétition des signes, des révérences, des mots sacrés n’a rien d’inutile, tout comme la mère ne se lasse pas d’embrasser son enfant, la mariée de répéter « Je t’aime » à son époux. Tout est oublié, car tout ce qui y est dit et chanté est éternel, tous les gestes qui y sont posés sont pérennes, hors de l’histoire, et pourtant immergés dans un continuum qui unit le Cénacle, le Calvaire et l’autel sur lequel on célèbre. Le célébrant ne s’adresse pas à l’assemblée, avec le souci d’être compréhensible ou de se rendre sympathique ou de paraître à la page, mais à Dieu : et devant Dieu, il n’y a que le sentiment d’une infinie gratitude pour le privilège de pouvoir porter avec soi les prières du peuple chrétien, les joies et les peines de tant d’âmes, les péchés et les manquements de ceux qui implorent le pardon et la miséricorde, la reconnaissance pour les grâces reçues, les suffrages pour nos chers défunts. Nous sommes seuls, et en même temps nous nous sentons intimement unis à une foule innombrable d’âmes traversant le temps et l’espace.