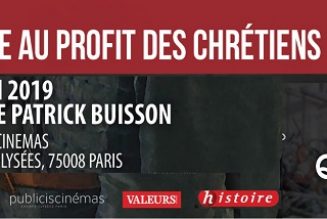D’Aurelio Porfiri, éditeur et écrivain catholique italien, pour le Salon beige:
Pendant le temps pascal, il existe un chant particulièrement familier à tous les fidèles catholiques : le Regina caeli. Il s’agit de l’une des quatre antiennes mariales traditionnellement chantées à la fin de la messe selon les temps liturgiques, avec l’Alma Redemptoris Mater, l’Ave Regina Caelorum et le Salve Regina. Aujourd’hui, seules cette dernière et le Regina caeli sont encore chantées en de nombreux lieux. Malheureusement, l’abandon de ces antiennes est un autre des fruits amers de la période difficile que traverse actuellement la liturgie catholique.
Ces antiennes existent en deux versions : une en ton solennel et une version plus simple. C’est évidemment cette dernière qui est la plus populaire, car elle peut être exécutée par de simples fidèles. Le ton solennel, quant à lui, est très élaboré, mélismatique, adapté à un groupe de chantres professionnels ou à des moines formés au chant grégorien. Ces mélodies sont magnifiques, riches en mélismes, ce qui donne au chant un caractère festif.
La version simple permet à tous de participer à l’exécution de cette belle antienne :
« Cette prière joyeuse est adressée à Marie, mère du Ressuscité, et depuis 1742, elle est traditionnellement chantée ou récitée durant le temps pascal, c’est-à-dire du dimanche de Pâques jusqu’au jour de la Pentecôte, en remplacement de l’Angelus. Sa composition remonte au Xe siècle, mais son auteur demeure inconnu. Selon la tradition, le pape Grégoire le Grand, un matin de Pâques à Rome, aurait entendu des anges chanter les trois premières lignes du Regina caeli, auxquelles il aurait ajouté la quatrième. Une autre théorie attribue l’antienne au pape Grégoire V. La mélodie en usage remonte au XIIe siècle, mais a été simplifiée au XVIIe. » (gregorianum.org)
La popularité du Regina caeli tient aussi à sa structure très simple : il se compose de quatre phrases, toutes conclues par un alleluia. En plus de sa brièveté, cela rend le chant facile à mémoriser. L’ouverture est particulièrement bien pensée : elle invite la Reine du Ciel, la Bienheureuse Vierge Marie, à se réjouir. C’est nous qui l’exhortons à la joie, car Celui qu’elle a porté en son sein est maintenant ressuscité. Dans la dernière phrase, nous recourons à son intercession en lui demandant de prier pour nous auprès de Dieu. La succession des alleluia crée une atmosphère joyeuse qui justifie pleinement la renommée de ce chant.
Le pape Benoît XVI, dans son homélie du Samedi Saint en 2006, nous montre le lien entre l’événement de Pâques et notre baptême :
« Il est clair que cet événement n’est pas un quelconque miracle du passé, dont l’existence pourrait nous être, en définitive, indifférente. Il s’agit d’un saut qualitatif dans l’histoire de l’évolution et de la vie en général, vers une vie future nouvelle, vers un monde nouveau qui, en partant du Christ, pénètre déjà continuellement dans notre monde, le transforme et l’attire à lui. Mais comment cela se produit-il ? Comment cet événement peut-il effectivement m’arriver et attirer ma vie vers lui et vers le haut ? Dans un premier temps, la réponse pourrait sembler surprenante, mais elle est tout à fait réelle: un tel événement me rejoint à travers la foi et le Baptême. C’est pourquoi le Baptême fait partie de la Veillée pascale, comme le souligne aussi, au cours de cette célébration, le fait que soient conférés les Sacrements de l’Initiation chrétienne à quelques adultes provenant de différents pays. Le Baptême signifie précisément ceci, qu’il ne s’agit pas d’un événement du passé, mais qu’un saut qualitatif de l’histoire universelle vient à moi, me saisissant pour m’attirer. Le Baptême est quelque chose de bien différent qu’un acte de socialisation ecclésiale, qu’un rite un peu démodé et compliqué pour accueillir les personnes dans l’Église. Il est encore bien plus que le simple fait d’être lavé, qu’une sorte de purification et d’embellissement de l’âme. Il est vraiment mort et résurrection, renaissance, transformation en une vie nouvelle. »
Par le chant du Regina caeli, nous cherchons toujours à nous rappeler cette vie nouvelle qui nous est promise.
Pour ma part, le Regina caeli est lié à un souvenir particulier qui remonte à au moins trente ans. Comme beaucoup, j’ai grandi dans l’atmosphère musicale ecclésiale postconciliaire — une atmosphère qui, malheureusement, continue encore aujourd’hui de nous étouffer. Non qu’il n’existe pas de chants bien écrits, mais la majorité de ce qui est proposé est une production musicale médiocre. À l’époque, encore jeune, je m’étais passionné pour l’orgue, que j’avais appris à connaître, même si ma connaissance de la musique sacrée restait très lacunaire. Je fréquentais une paroisse dans un quartier central de Rome. Je me souviens que, l’après-midi du jour de Pâques, avec quelques amis de cette paroisse, nous avons décidé de visiter la basilique Saint-Pierre au Vatican. Je me rappelle aussi qu’en entrant dans cette immense basilique, nous nous sommes dirigés vers l’autel de la Chaire, où les vêpres touchaient à leur fin. Nous avons dû attendre que la procession des chanoines et des chantres retourne à la sacristie.
Deux choses m’ont profondément marqué : les habits de chœur des chanoines et chantres, et le chant du Regina caeli interprété par tous — chanoines, chantres et fidèles. Je ne sais pas pourquoi j’ai été autant bouleversé par tout cela, mais je me souviens être allé à la sacristie pour demander au maître de chapelle — à l’époque celle que l’on appelait encore la Cappella Giulia — si je pouvais me joindre à eux. Il accepta ma demande, et à partir de ce moment-là commença mon aventure avec la basilique Saint-Pierre du Vatican, qui se terminera en 2008, environ dix-huit ans plus tard, au moment de mon départ pour Macao, où je suis allé enseigner.
Ce Regina caeli fut comme une porte qui me montra qu’il existait dans la liturgie quelque chose de plus que ce à quoi j’avais malheureusement été habitué. Je me suis rendu compte, par la suite, que l’horrible “infection” qui avait ravagé la liturgie et la musique sacrée avait également atteint ces lieux où l’on aurait pourtant pu espérer trouver une dignité du culte rendue à Dieu à la hauteur de leur histoire et de leur tradition. Et pourtant non — au fil des décennies, j’ai compris que la maladie progressait inexorablement dans les veines de l’Église, et qu’aujourd’hui, Rome elle-même, qui devrait être la gloire du monde catholique, n’est plus qu’un pâle reflet de ce qu’elle était autrefois.
Et pourtant, je ne peux pas oublier comment la Bienheureuse Vierge Marie, d’une certaine manière, m’a parlé et m’a permis de percevoir une étincelle de cette beauté dont l’origine est en Dieu — une beauté que, malheureusement, je n’ai pu contempler par la suite presque uniquement dans sa terrible décadence.