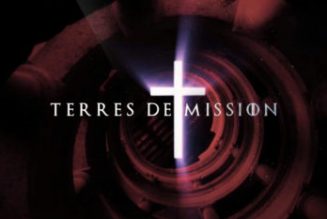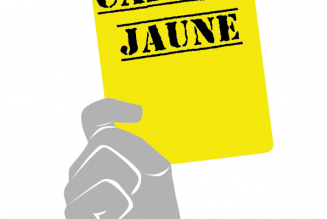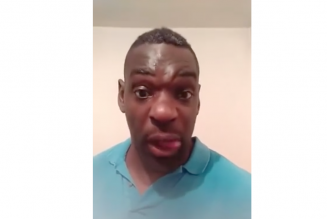Les dimanches et aux jours des fêtes les plus importantes, l’évangile est suivi du Credo. Bien souvent, la prédication intervient entre les deux, mais Saint Thomas d’Aquin nous invite à voir le Credo comme une réponse faite à l’évangile :
Nous avons deux sortes de maîtres dans les choses divines : des maîtres dispositifs qui nous préparent : apôtres, prophètes, tous ceux qui ont écrit sous l’inspiration divine, – et un seul Maître parfait qui est le Christ. Ce sont les premiers de ces maîtres que nous entendons dans l’épitre. Notre-Seigneur, lui, se fait entendre dans l’évangile, et alors, il n’y a plus qu’une seule réponse possible, c’est le Credo, la foi pure et simple[1].
1. Origine du texte et histoire de son insertion dans la messe
Le Credo n’a pas été composé pour la messe. C’est une profession de foi qui apparaît dans les actes du concile de Chalcédoine (451), mais on l’appelle « Symbole de Nicée-Constantinople » car il est considéré comme le résumé de la foi proclamée aux conciles précédents de Nicée (325) et de Constantinople (381).
[Le] Credo de la messe avait primitivement la même destination que celle qu’a conservée [le] “Symbole des Apôtres”, celui de profession de foi avant le baptême ; et voilà pourquoi, comme lui, il se formule au singulier : credo [je crois][2].
Quant au nom de « Symbole » donné à ces professions de foi, le Catéchisme de l’Église catholique en explique l’origine :
Le mot grec symbolon signifiait la moitié d’un objet brisé (par exemple un sceau) que l’on présentait comme un signe de reconnaissance. Les parties brisées étaient mises ensemble pour vérifier l’identité du porteur. Le “symbole de la foi” est donc un signe de reconnaissance et de communion entre les croyants. Symbolon signifie ensuite recueil, collection ou sommaire. Le “symbole de la foi” est le recueil des principales vérités de la foi[3].
C’est à Charlemagne que l’on doit vraisemblablement l’insertion du Symbole de Nicée-Constantinople dans la messe en Occident[4], à la place qu’il occupe aujourd’hui. En effet, dans les dernières années du VIIIe siècle, certaines erreurs continuent de circuler à propos de la filiation divine de Notre-Seigneur Jésus-Christ. C’est dans ce contexte qu’à la chapelle palatine [impériale] d’Aix (Aix-la-Chapelle), on prit l’habitude de chanter le Symbole après l’évangile.
Cet usage se répandit dans le nord de l’Europe aux IXe et Xe siècles. Toutefois, Rome fit de la résistance, en sorte qu’en 1014, l’empereur Henri II fut stupéfait d’y entendre une messe sans Credo.
« Les clercs de Rome expliquèrent que l’Église romaine, qui n’avait jamais été atteinte par l’hérésie, n’avait pas besoin de confesser sa foi si souvent[5]. »
À la suite de cet épisode, cependant, le Credo fut progressivement admis dans la messe à Rome, mais son usage fut en même temps restreint aux occasions les plus solennelles.
2. Erreurs combattues
La profession de foi du Symbole de Nicée-Constantinople est plus développée que celle du Symbole des Apôtres [celui que nous récitons au début du chapelet]. Elle est « théologique et polémique »[6] au sens où s’y exprime une orthodoxie à l’encontre de certaines erreurs, en particulier :
– L’erreur d’Arius, qui niait la divinité du Fils. Le Symbole lui barre la route en proclamant :
« Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero. Génitum, non factum, consubstantiálem Patri. Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père. »
– L’erreur des Macédoniens, qui niaient la divinité du Saint-Esprit. Le Symbole proclame quant à lui que le Saint-Esprit est :
« Dóminum et vivificántem : qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre, et Filio simul adorátur et conglorificátur. Seigneur et qui donne la vie, [qu’il] procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils [qu’il] reçoit même adoration et même gloire. »
3. Insistance sur l’unité
Toutefois, on ne peut réduire les développements du Symbole de Nicée-Constantinople à cet aspect polémique. Son « remarquable luxe d’exposition » vise également « à déployer, dans l’esprit de l’Écriture et la fierté de croire, tous les trésors de la foi »[7].
Parmi ces derniers, on remarquera une insistance particulière, « manifeste et perpétuelle »[8], sur l’unité :
Credo in unum Deum… in unum Dominum… in unam […] Ecclesiam… confiteor in unum baptisma.
Je crois en un seul Dieu… en un seul Seigneur… à l’Église une… je reconnais un seul baptême.
Une telle insistance n’est pas sans rappeler l’hymne à l’unité de l’épître aux Éphésiens :
« Un seul corps et un seul esprit, … un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous[9]. »
Ainsi, « avec une certaine fierté, on oppose à la désagrégation qu’entraîne l’erreur, l’unité de Dieu et l’unité de sa révélation dans le Christ, l’Église et les Sacrements »[10].
4. Structure du texte
Dans le Symbole, « l’objet de la foi est divisé en trois parties : le Dieu créateur, le Christ notre Seigneur, et les biens de la grâce ». Cette structure est également trinitaire, puisque « chacun des trois paragraphes se rattache au nom d’une des trois personnes divines »[11].
Il est possible de rattacher à cette structure les trois inclinations de tête du prêtre – à Deum, Jesum Christum, et simul adoratur – pour honorer les trois Personnes de la Sainte Trinité.
5. 1re partie : le Père
Le premier paragraphe est relativement court, mais il est déjà représentatif du style tout à la fois développé et précis de l’ensemble du Symbole, puisque, « dès la profession de foi en “Dieu le Créateur du ciel et de la terre”, la création est décrite par un second diptyque : “de toutes les choses, visibles et invisibles”.[12] »
6. 2e partie : le Fils
Le deuxième paragraphe est le plus développé, par l’introduction d’une profession de foi au Christ plus détaillée, qui s’attarde tout d’abord sur le mystère de la Personne et de l’Incarnation du Fils de Dieu, avant d’aborder son œuvre rédemptrice.
On notera également que « le second membre est [le] plus développé par l’introduction d’une profession de foi au Christ plus détaillée »[13].
Le mystère de la personne de l’Homme-Dieu
En premier lieu, « un point s’affirme avec une particulière insistance : la confession de la divinité du Christ »[14].
Puis, c’est l’Incarnation, avec la mise en valeur, dès l’abord, de son motif : c’est « pour nous les hommes et pour notre salut… propter nos homines et propter nostram salutem » que Dieu s’est fait homme. L’Incarnation est voulue par Dieu en vue du salut des hommes.
Lorsque l’article suivant est récité, on s’agenouille : « Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Virgine : et homo factus est. Il a pris chair de la Vierge Marie par l’action du Saint-Esprit et il s’est fait homme. » Il s’agit ici d’honorer le mystère de l’Incarnation et de s’humilier en face de celui-ci en considérant l’humiliation qui fut celle du Sauveur dans celle-ci.
« Cet article constitue à juste titre le sommet et le centre de toute la profession de foi… Aussi tombons-nous à genoux devant le mystère, aux mots : Et incarnatus est. »[15]
Son œuvre
Le mystère de la personne de l’Homme-Dieu ayant ainsi été retracé, le Symbole se tourne vers son œuvre, qu’il dessine en deux étapes :
– d’abord l’abaissement jusqu’à la croix, à la Passion et à la tombe, avec une nouvelle mise en valeur du motif de cet abaissement : « pro nobis… pour nous » ;
– ensuite l’exaltation : la résurrection, l’ascension, la session à la droite du Père, le retour dans la gloire et jugement dernier.
7. 3e partie : l’Esprit et l’Église
Le Saint-Esprit
« La troisième section passe en revue le fruit qui nous est revenu de la Rédemption »[16], mais elle s’ouvre par une profession de la foi en la divinité du Saint-Esprit, en sorte que c’est à lui qu’est d’une certaine manière appropriée l’œuvre de sanctification
Les notes de l’Église
Le Symbole énumère les quatre qualités de l’Église, que les théologiens appellent ses « notes » : une, sainte, catholique et apostolique.
Les sacrements
Il est remarquable que l’article suivant, à travers le baptême, évoque les sacrements, non seulement parce que l’Église « transmet sa vie à ses enfants par les sacrements »[17], mais également parce que, selon l’expression de saint Thomas, l’Église est « fabriquée » par les sacrements :
Les Apôtres et leurs successeurs sont les vicaires de Dieu pour le gouvernement de cette Église qui est constituée par la foi et les sacrements de la foi. Aussi, de même qu’ils ne peuvent constituer une autre Église, ils ne peuvent transmettre une autre foi, ni instituer d’autres sacrements ; c’est par les sacrements qui coulèrent du côté du Christ crucifié que l’Église du Christ a été fabriquée[18].
Les fins dernières
« La profession de foi s’achève sur la vision de notre “conformation” finale au Ressuscité à la résurrection des morts et dans la vie du siècle à venir. »[19]
8. Conclusion
Réponse aux lectures et, en particulier à l’évangile, le Credo constitue, pour les grandes occasions, la conclusion fortement accentuée de la messe des catéchumènes, l’adhésion joyeuse au message reçu. La profession de foi est en même temps la porte d’entrée solennelle de la messe des fidèles[20].