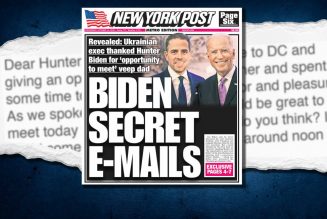Extrait d’une analyse de Jean-Robert Raviot, docteur en science politique, professeur des universités en études russes contemporaines à l’Université Paris Nanterre, suite à la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska :
[…] Je ne sais pas comment le choix de l’Alaska a été fait, mais il semble clair qu’il donnait d’emblée et avant toute négociation un avantage symbolique éclatant à Vladimir Poutine. La localisation même de ce sommet sert la rhétorique officielle russe. Quelques explications.
La nouvelle guerre froide imite la guerre froide, mais elle ne la reproduit pas. Anchorage est assez maussade, mais ce n’est ni Genève, ni Helsinki. Le rideau de fer n’existe plus et le partage de l’Europe n’est plus à l’ordre du jour. L’Europe elle-même, d’ailleurs, n’est plus trop à l’ordre du jour, ayant quitté la scène des grands acteurs politique de l’Histoire. Sa vassalité politico-stratégique et, de plus en plus, sa soumission économique et énergétique à l’égard des Etats-Unis semble être tenue pour un fait. Le président russe et le président américain l’ont d’ailleurs dit ouvertement et sans trop de précaution oratoire, chacun à sa manière, au cours de ces derniers mois.
Anchorage est la capitale d’un état américain qui a ceci de particulier qu’il fut le territoire de l’Empire de Russie pendant une petite centaine d’années, entre la fin du XVIIIe siècle et 1867, date à laquelle ce territoire assez faiblement colonisé par les Russes – il est établi que la population russe de cette « Amérique russe » a atteint son maximum vers 1825, avec environ… 700 habitants ! – a été vendu aux Etats-Unis pour 7,2 millions de dollars de l’époque. La Russie entretenait déjà d’excellentes relations d’affaires avec les Etats-Unis au sein de la Russian-American Company, fondée par Paul Ier en 1799. Cette entente russo-américaine avait permis de repousser les velléités des concurrents britanniques d’investir un territoire très riche en or et en minerais. Pendant tout le dix-neuvième siècle, la Russie – faute d’avoir les moyens de le contrôler durablement – s’ingénie à attiser les rivalités américano-britanniques autour de ce territoire, par le jeu des concessions en matière de droits d’exploitation des ressources… Outre la mainmise sur les ressources naturelles, l’acquisition de l’Alaska permet aux Etats-Unis de poursuivre l’expansion territoriale de la Ruée vers l’or, donnant à Washington un accès direct au littoral arctique, dominé jusqu’ici par la Russie et la Grande-Bretagne. Le Canada est alors un dominion britannique et la maîtrise de la côte Nord-Pacifique de l’Amérique, encore peu développée, est un enjeu stratégique majeur. Le rattachement de l’Alaska aux Etats-Unis permet à ces derniers de mieux circonscrire la puissance britannique, de sécuriser leur voisinage du Nord-Ouest et de réaffirmer leur volonté de domination de tout l’hémisphère occidental (à savoir la totalité du continent américain), exprimée dès 1823 dans la célèbre doctrine Monroe, que l’on peut résumer ainsi : les Etats-Unis ne tolèrent aucune présence européenne sur le continent américain.
Quel symbole que d’opter pour un territoire dont l’histoire même symbolise la vision politique russe portée par Vladimir Poutine, qui constitue une sorte de « doctrine Monroe » à la russe, que l’on peut résumer ainsi : les grandes puissances sont légitimes à faire valoir, dans leur voisinage, un droit à la sécurité qui exclut le déploiement militaire et l’ingérence politique d’autres grandes puissances ; que les puissances moyennes et « petits Etats » voisins s’en accommodent et ajustent leurs politiques à la réalité géopolitique des rapports de force!… Dans la vision russe, assez brutalement réaliste, un nouvel ordre international doit être reconstruit par un dialogue et des négociations entre « grands », un nouvel ordre international fondé non plus sur des règles dictées imposées par le plus puissant des « grands », comme par les Etats-Unis après leur victoire sur l’URSS dans la guerre froide, mais sur un jeu d’équilibre de grandes puissances régionales qui s’abstiennent d’ingérence mutuelle dans leurs voisinages respectifs.
Trump avait-il conscience, en proposant l’Alaska, de servir aussi bien les desseins de la diplomatie russe ? Il a voulu se poser « en voisin » afin de mieux engager le dialogue. En mesurait-il toutes les implications ?