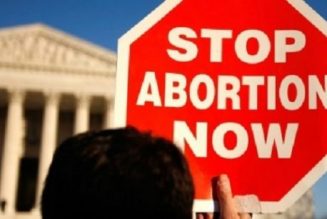Depuis douze ans maintenant, cet ordre catholique de religieuses, dont le seul but est de prendre soin des personnes âgées démunies, est traîné devant les tribunaux américains par une série d’idéologues.
Quel est le crime des religieuses ? S’opposer à une disposition de l’Obamacare qui obligeait les organisations à but non lucratif à fournir des contraceptifs, directement ou indirectement, dans le cadre de leurs régimes d’assurance maladie approuvés par le gouvernement fédéral.
La position des religieuses était que toute participation à la distribution de contraceptifs constituait une grave violation de leurs croyances religieuses et que, en vertu de la loi de 1993 sur le rétablissement de la liberté religieuse, le gouvernement fédéral était tenu de trouver un autre moyen d’atteindre le même objectif.
En fin de compte, l’administration Obama a perdu son procès, même s’il a fallu attendre la fin du premier mandat de Donald Trump pour que les religieuses obtiennent gain de cause. À ce moment-là, le litige était en cours depuis 2013 et avait été examiné à plusieurs reprises par la Cour suprême, qui l’avait renvoyé devant les tribunaux inférieurs ; et par une multitude d’États — dont certains, de manière honteuse, ont choisi de s’inspirer de l’intolérance du président Obama et ont continué à faire pression sur cette question.
Heureusement, en juillet 2020, la Cour suprême a finalement autorisé l’administration Trump à mettre en œuvre son exemption. L’affaire a été tranchée par 7 voix contre 2.
En toute logique, cela aurait dû mettre fin à l’affaire. Et pourtant, aucun des États qui avaient perdu devant la Cour suprême – la Pennsylvanie et le New Jersey – n’était disposé à abandonner. Pire encore, ils ont été rejoints dans leur démarche par la Californie, New York, le Massachusetts et d’autres États. S’accrochant à un argument tendancieux que la Cour suprême n’avait pas examiné au fond, ces États ont insisté sur le fait que les modifications apportées par l’administration Trump étaient « arbitraires et capricieuses » au regard de la loi sur la procédure administrative. Ce mois-ci, un juge de district de Pennsylvanie a donné raison à ces États et a annulé la règle. Une fois de plus, douze ans après l’ouverture de leur procès, les Petites Sœurs des Pauvres ont été informées qu’elles devaient choisir entre leur conscience et la loi.
Que ce litige dure aussi longtemps est un problème. Mais ce qui est infiniment pire, c’est le nombre de politiciens américains qui se sont réjouis de voir cette affaire se poursuivre. Les affaires judiciaires dans lesquelles les Petites Sœurs des Pauvres ont été impliquées ne sont pas apparues spontanément. Elles ne sont pas non plus une caractéristique permanente ou inévitable du paysage. Elles sont le fruit d’un choix. Le président Obama a choisi d’exiger que les religieuses américaines subordonnent leurs croyances religieuses à ses préférences sociales. Les dirigeants de Pennsylvanie, du New Jersey et d’autres États démocrates ont choisi d’attaquer le compromis de l’administration Trump, longtemps après le départ de Barack Obama, puis de poursuivre leurs efforts malgré une défaite cuisante devant la Cour suprême. C’est du fanatisme et, bien compris, c’est contraire au fonctionnement d’une société pluraliste. Les Américains sont en désaccord, ont été en désaccord et devraient souvent être en désaccord sur des questions politiques importantes. Mais il y a une différence entre chercher à gagner la bataille des idées et poignarder gratuitement les blessés. Compte tenu des instincts de l’actuelle Cour suprême, il semble probable que la dernière défaite des Petites Sœurs des Pauvres sera finalement annulée.