Nous avons le plaisir de publier ici un article du P.Edouard-Marie Gallez csj – dont il faut souhaiter qu’il suscite un sérieux débat sur les présupposés des “études religieuses”:
Passer du comparatisme « entre religions » à leur compréhension réelle historique
Depuis notre enfance, nous sommes conditionnés à penser que tout se vaut puisque « il y a de la vérité partout » et que « il y a des braves gens partout » – et on croit avoir découvert la lune avec des affirmations pareilles. Si l’on s’élève un peu au-dessus de ce niveau 0 de l’intelligence, on remarquera que de telles affirmations conduisent vite à penser qu’il n’y a jamais de vrai ou de faux, ni de bien ni de mal, et qu’il faut toujours partager la culpabilité entre la victime et son bourreau. Sauf si la victime appartient au mauvais parti ou a des idées qui déplaisent aux médias du pouvoir : dans ce cas, elle est nécessairement coupable. Ce niveau 0, c’est celui de la répétition des slogans dénoncés par Orwell dans 1984.
Il en est de même pour « les religions » : qu’elles se valent toutes plus ou moins est la conviction aujourd’hui obligatoire sous peine de mort sociale (sauf si on est musulman dans un quartier musulman, auquel cas c’est l’inverse) ; cette conviction est entretenue par le comparatisme pratiqué dans tous les départements d’études religieuses du monde.
Le problème, c’est le postulat de départ : comparer, donc commencer par placer les objets à comparer sur un même plateau. Certes, on peut comparer des pommes, des poires et d’autres fruits, par exemple au point de vue du goût – il n’existe pas de lien historique à mettre en lumière entre les fruits, sauf quant aux fruits OGM. Néanmoins, deux objections peuvent être soulevées :
- si le but est de retirer de chaque fruit ce qu’il a de meilleur en vue de mélanger ce « meilleur » propre à chacun pour obtenir le fruit idéal universel et imposer celui-ci à la place des autres, on est devant une monstruosité ;
- on a choisi de comparer des fruits comestibles, en omettant l’existence de fruits toxiques.
A l’image de ce projet utopique de fruit universel unique, le projet de « religion universelle » a quelque chose d’une monstruosité. Or, tel est bien l’objectif des « conseils mondiaux des religions » qui existent depuis le XIXe siècle, objectif auquel doit mener le pluralisme religieux et les « dialogues » (tels qu’ils sont pensés depuis plus longtemps encore, depuis Nicolas de Cuse, voire bien avant lui). Ce n’est pas une question de goût malsain, car justement une telle religion universelle serait du goût de la domination mondialiste qui a besoin d’un tel « opium du peuple » – pour reprendre la définition que Karl Marx donnait de la religion (une définition qui convient très bien ici). C’est une question de tromperie.
Comme pour les fruits, certaines « religions » peuvent en effet être toxiques, au même titre que les idéologies dont, en réalité, elles ne se distinguent que par l’apparence du discours. En fait, ces « religions » ont un lien historique avec le christianisme, au sens où elles sont toutes apparues après lui… à la manière de contrefaçons. C’est ici que se place l’effort de l’intelligence ; le livre Le christianisme face aux autres religions. Le Christ est le centre de l’histoire a été écrit pour aider ceux qui ne veulent pas en rester au niveau 0.
Précisément, ce livre explique comment se sont faites ces contrefaçons, ainsi que pourquoi, autant qu’on puisse le dire. Cette connaissance de l’histoire réelle est indispensable pour éviter le grand fourre-tout « des religions », mêlant des réalités aussi étrangères entre elles que les innombrables cultes antiques (préchrétiens, qui sont des cultes à rites) et les phénomènes religieux qui sont apparus après le christianisme et qui font tous appel à des sortes de foi (ils ne sont plus essentiellement des rites). Les idéologies font également appel à une « foi » – Raymond Aron les appelait des « religions séculières » au sens où elles ne se distinguent pas réellement des « religions » post-chrétiennes (= apparues à la suite du christianisme et d’une première évangélisation).*
Nier la différence radicale qui existe entre les premiers, les cultes anciens, et les seconds, les phénomènes post-chrétiens, c’est tomber dans le piège du mot « religions » au pluriel, qui est précisément un faux concept (très différent du sens de « religion » au singulier, laquelle est une vertu morale). Dans ce piège (dénoncé par Benoît XVI), beaucoup d’intellectuels sont tombés, y compris dans l’Église. Un mot-piège est un mot inventé pour tromper – ici « religions » au pluriel, pour occulter la différence radicale qui existe entre ce qu’il y avait avant Jésus-Christ et ce qui s’est passé après Lui : de la sorte, le tournant que représente l’apparition du christianisme dans l’Histoire humaine est gommé.
Un tel effacement du christianisme dans la culture n’est évidemment pas fortuit, que ce soit au nom du « pluralisme » ou des « dialogues » … ou même au nom de la charité. « Il ne faut pas parler de Jésus, cela dérange » entend-on dire (éventuellement avec amendes et prison à la clef). Et il est interdit de juger l’arbre à ses fruits comme lui-même le recommandait. Car que sont donc ces « religions » qui se sont substituées ou veulent se substituer à la foi chrétienne, sinon des entreprises de détournement spirituel en vue de soumettre l’humanité ? Ces soumissions n’entraînent-elles pas de terribles conséquences sociales, familiales, et personnelles ? La vraie charité, loin de celle derrière laquelle se dissimule la compromission, la lâcheté ou pire encore, est de s’opposer à ces post-christianismes en aidant les gens à s’en libérer. Le dialogue ouvert et charitable, qui prend l’histoire en compte, est celui-là.
De même que Jésus est le tournant dans l’histoire de tous ceux qui l’ont découvert (ou « rencontré » comme ils disent), de même est-il le tournant dans l’histoire globale de toute l’humanité dès le 1er siècle, la liberté humaine étant totalement respectée. Et ce tournant se manifestera pleinement lors de sa Venue glorieuse. La crise de l’Église suite à Vatican II tient pour beaucoup au fait d’avoir oublié cela.
_____________________
* Il convient de s’intéresser à l’histoire religieuse si méconnue de l’Asie aux premiers siècles, cf. Historiographie du bouddhisme, www.academia.edu/39988461/Le_bouddhisme_aux_oubliettes,
Le bouddhisme des Bouddhistes.

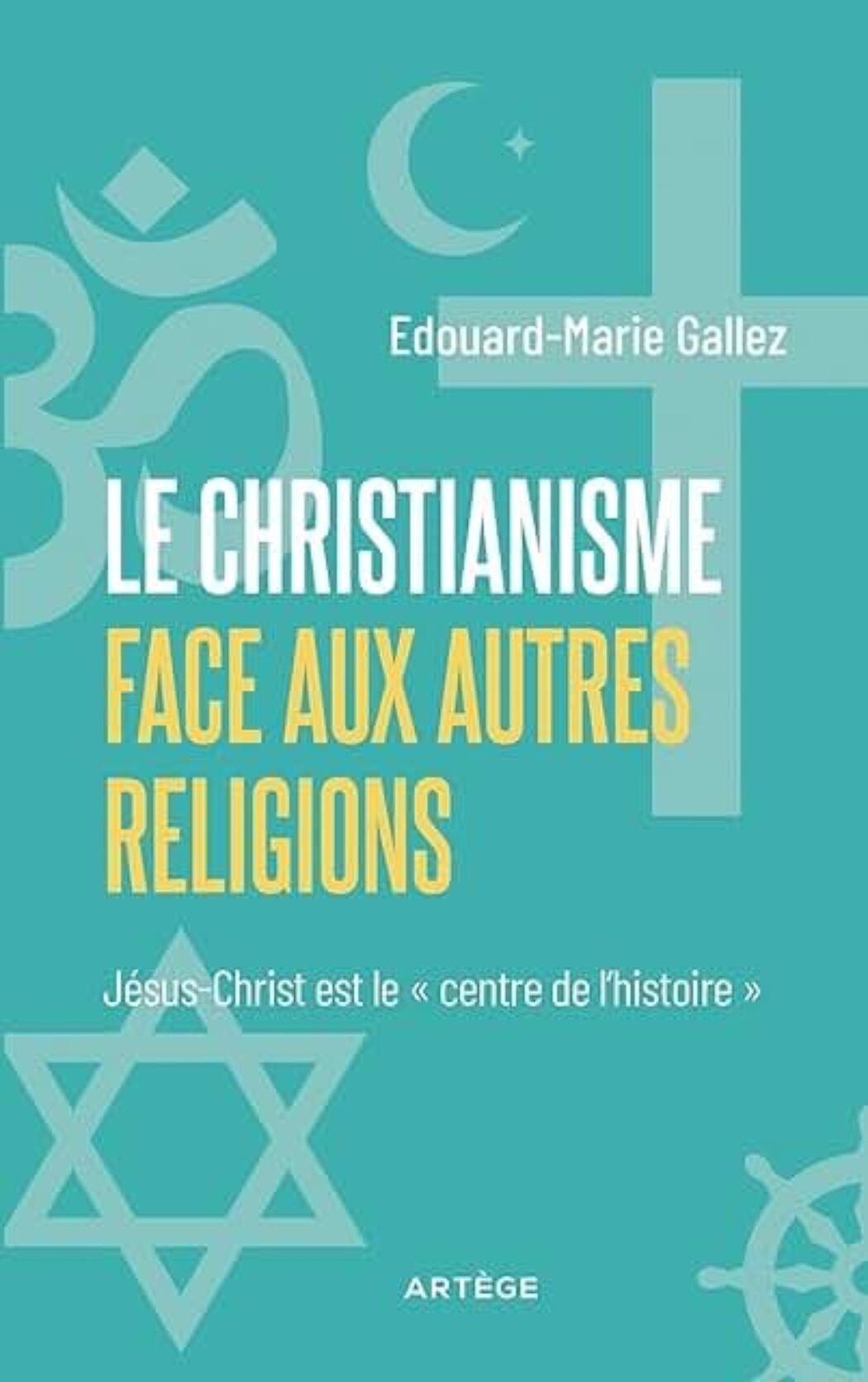
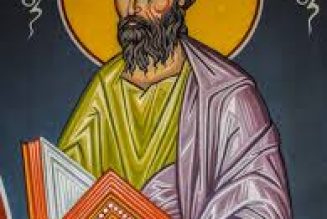

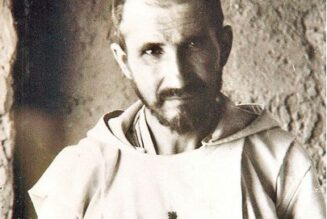

PascaleBrebis
Quelle limpidité! Une véritable exégèse des paroles du Christ : «Juger un arbre à ses fruits» parfois toxiques. Très agréable à lire, édifiant, manifestement inspiré. L’Église au milieu du village et Jésus-Christ au centre de l’histoire.
Il y a dans certaines religions préchrétiennes des connaissances éternelles présente forcément dans le christianisme. Des fruits comparables comme le Pardon et la Compassion. Mais après le Christ, il n’y a plus de prophète, car tout a été accompli. Après, ce sont les fruits du péché.