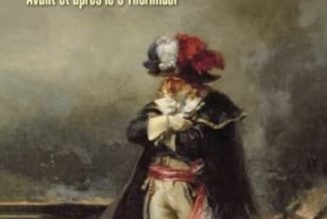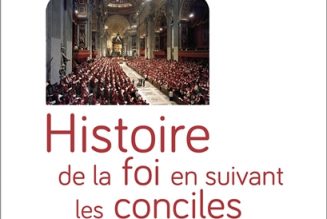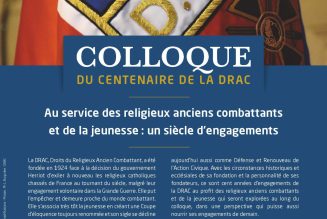Extrait de la Petite chronique historique de l’Anjou chrétien consacrée aux prêtres confesseurs de la foi sous la Révolution :
Lors de la Révolution, les membres du clergé, premier ordre du royaume de France, vont, en l’espace de trois ans, être assujettis à un serment envers la Constitution civile du clergé et, pour les réfractaires, être destitués, pourchassés, persécutés, exilés et finalement mis à mort. Les prêtres constitutionnels eux-mêmes sont contraints d’abandonner l’exercice du culte à partir du 7 novembre 1793.
Le clergé angevin face à la Constitution civile du clergé
Dans le diocèse d’Angers, les trois quarts des mille cinq cents prêtres refusent de prêter serment à la Constitution civile du clergé. Mais le clergé régulier est beaucoup moins résistant : les deux tiers abandonnent la vie religieuse, minée depuis longtemps par la commende, le jansénisme et sa répression, la philosophie et surtout l’œuvre de la Commission des réguliers (1766-1780). À Angers, à l’abbaye Saint-Aubin, quatorze religieux sur seize prêtent le serment, à Bellefontaine, trois sur quatre, à Fontevrault et Notre-Dame des Gardes, la totalité. Dans les Mauges, la quasi-totalité des prêtres séculiers refuse le serment. Ils sont soutenus par la grande majorité des fidèles qui s’oppose à leur remplacement par les « intrus », élus par les nouvelles autorités. Le pape Pie VI, dans son bref du 13 avril 1791, recommande aux fidèles de n’avoir avec eux aucune communication dans les choses sacrées ! Aussi sont-ils souvent, dès le printemps de 1791, installés par la force armée. Dans le département du Maine-et-Loire, le 3 septembre 1791, les administrateurs demandent à la nouvelle Assemblée législative une loi pour écarter les prêtres réfractaires. Après l’acceptation par Louis XVI de la Constitution civile du Clergé, ils reviennent sur leur décision et, le 16 septembre 1791, ils libèrent les détenus de la rue Courte, à Angers. Mais le 4 novembre, ils dénoncent des rassemblements de trois ou quatre mille hommes armés qu’ils attribuent aux prêtres réfractaires, traités de fanatiques. Le 21 novembre, un décret de l’Assemblée législative considère tous les prêtres insermentés comme des révoltés passibles de la prison. Par un arrêt du 1er février 1792, leur rassemblement et leur enregistrement quotidien à Angers est exigé. Logés au début chez l’habitant, ils sont, à partir du dimanche 17 juin, enfermés au nombre de trois-cents-soixante-dix au petit séminaire. Cent trente réussissent à échapper à cet enfermement, tel Élie Beurrier, vicaire à Chanzeaux. Les mêmes administrateurs réclament ensuite une loi de déportation. […]