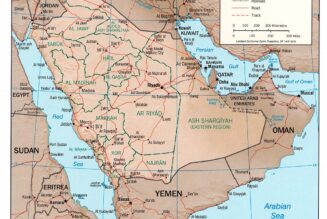La Nef consacre son dossier d’été sur la guerre juste, avec notamment un rappel sur le Magistère de l’Eglise, le cas de la dissuasion nucléaire, la nouveauté qu’est la robotisation, l’éthique dans l’Armée française, et une analyse du concept de la guerre juste par Pierre de Lauzun, avec un décryptage de cas pratiques, en Ukraine et à Gaza. Voici ce qu’il écrit sur l’Ukraine :
L’histoire des relations entre Russes et Ukrainiens est longue; le dernier épisode est la guerre menée depuis février 2022. Est-elle juste? La partie russe qui est à l’origine met en avant divers arguments (outre certains peu crédibles): la menace de l’Otan; le sort des russophones depuis 2014; l’histoire. Ils ne sont pas sans valeur: il y a eu une réelle poussée de l’Otan en Europe orientale, et le basculement de l’Ukraine peut être vu côté russe comme une menace grave. Mais ces arguments ne suffisent pas à justifier l’invasion. La recherche de solutions alternatives est restée très insuffisante; et le moyen utilisé est disproportionné.
En revanche, la défense ukrainienne paraît relever au départ de la guerre juste, même si de graves erreurs ont été commises (déclassement de la langue russe, bombardements de sa propre population dans le Donetsk, etc.). De même, les Occidentaux ont pris parti pour l’Ukraine et décidé de l’aider et de sanctionner l’agression, tout en évitant une guerre directe. Cela paraît justifié dans son principe. Mais cette guerre s’est prolongée, avec beaucoup de morts et de destructions. Or une fois enclenchée, la guerre a sa logique. C’est le choc de deux volontés contraires, dont la solution est recherchée dans la violence.
La sortie est dans le résultat sur le terrain: en général, la victoire d’une partie. Sinon la guerre se poursuit jusqu’à épuisement. C’est la logique à l’œuvre en Ukraine. La Russie contrôle 20 % de l’Ukraine; elle a une supériorité matérielle ; les sanctions ne l’ont pas mise à genoux : elle n’a pas de raison de s’arrêter. L’Ukraine vise à récupérer son territoire antérieur; elle a bien résisté; elle reçoit une aide conséquente: elle continue. Leurs buts de guerre sont incompatibles. Tant que ces facteurs seront à l’œuvre, la guerre continuera. Mais plus elle dure, plus les adversaires en subissent les effets, notamment l’Ukraine dont les infrastructures et l’économie sortiront dévastées (sans parler des victimes).
Les Américains ont eu bien des raisons d’aider les Ukrainiens, notamment donner un coup d’arrêt à la Russie. Cela renforçait leur hégémonie, avec un impact économique positif. Mais ces buts sont atteints, et ils peuvent dès lors vouloir une sortie. C’est a fortiori le cas avec Trump, désireux de se montrer homme de paix et de desserrer la proximité entre Russes et Chinois. Mais pour le moment il piétine.
La situation des Européens est différente: le coût de la guerre et des sanctions est élevé pour eux ; leur capacité à aider les Ukrainiens est limitée. Les sanctions les ont conduits à démanteler leurs entreprises en Russie, avec une perte de plus de 100 milliards. Or l’effet principal de ces mesures a été de conduire la Russie à réorienter son activité vers plus d’autonomie, à ressusciter un complexe militaro-industriel à la soviétique, et à se lier encore plus à la Chine. Le bilan n’est donc pas convaincant.
En outre, une victoire ukrainienne, avec la reconquête de tout son territoire, est désormais très improbable. Dans cette perspective, il faudrait négocier pour limiter les dégâts. Mais les Européens se placent dans une éthique de conviction. Il s’agit de punir la partie mauvaise: les Russes ont tort; ils ne doivent pas gagner. Et on inscrit cette guerre dans un grand récit de lutte des démocraties contre les régimes autoritaires. L’idée est alors que la Russie est dangereuse et qu’il faut l’arrêter dès que possible. Pourtant, piétinant devant la seule Ukraine, elle ne donne pas l’impression d’une puissance comparable à l’URSS. Mais les Européens sont désormais pris dans la logique de leur position. Ce faisant, ils risquent de reporter l’arrêt des hostilités à un niveau encore plus défavorable pour l’Ukraine. Si donc la réaction européenne initiale était justifiée, le jugement à porter n’est plus le même. Le souci de la paix devrait revenir au premier plan, une paix qui supposera des compromis – avant que l’Ukraine ne lâche complètement.