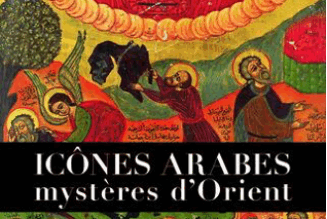Bertrand Saint-Germain est docteur en droit et universitaire. Il enseigne ou a enseigné la théorie de l’Etat et le droit des libertés à Paris et dans plusieurs universités ou écoles de province. Elu local, il connaît également de l’intérieur les rouages du fonctionnement des collectivités territoriales. Praticien, il collabore régulièrement avec des avocats et exerce des fonctions de conseil en stratégie juridique. L’ampleur du phénomène woke, spécialement au sein de l’Université française, le contraint au pseudonymat. Son expérience tant théorique que pratique lui a permis d’acquérir un regard lucide et critique sur l’utilisation politique du droit dans les débats publics.
Ainsi il publie Juridiquement correct, comment ils détournent le droit, pour dénoncer la pensée unique dans le domaine juridique. Mal interprété, le droit regorge d’idées fausses, parfois sciemment entretenues par nos législateurs à des fins politiques. L’auteur aborde ainsi, sur le plan juridique, trente questions qui ne font plus débat – ou rarement – dans le milieu politico-médiatique :
- Les hommes naissent-ils réellement libres et égaux en droit ?
- La naissance d’un étranger en France le rend-elle nécessairement français ?
- Le droit européen est-il vraiment supérieur au droit national ?
- Le pouvoir du roi était-il vraiment arbitraire ?
- La loi est-elle encore vraiment l’expression de la volonté générale ?
- Pourquoi serait-il si dangereux pour une Démocratie que les juges y soient élus ?
- Est-il possible de retirer la nationalité d’un Français si cela le rendait apatride?
- Peut-on réellement parler de l’existence d’un droit à l’avortement, en France ?
-
La protection de la santé justifie-t-elle la remise en cause des libertés ?
-
La liberté de l’enseignement est-elle respectée en France ?
-
Est-il exact de dire que l’islam serait compatible avec la laïcité ?
- …
A l’heure de la prééminence de la cancel culture, du political correctness et de l’essor du phénomène woke, l’auteur souhaite, par cet ouvrage, contribuer à la prise de conscience que le droit, loin de constituer un domaine neutre par nature, constitue également un champ de bataille dont il importe de connaître et de maîtriser les règles. Nous l’avons interrogé :
Après le politiquement correct, l’historiquement correct… Voici le juridiquement correct. Est-ce du marketing ou considérez-vous qu’il y a réellement un souci avec le Droit en France ?
Depuis qu’il y a vingt-cinq ans, en 1996, Philippe de Villiers prit la plume pour écrire son Dictionnaire du politiquement correct à la française, il est vrai que de nombreux ouvrages se sont inscrits dans le fil de cet approche.
Si vos lecteurs sont souvent également familiers de Jean Sévillia qui aborda les thèmes de l’Historiquement correct (2003), puis du Moralement correct (2007), plusieurs autres, parfois moins connus, se sont attachés à dénoncer la tendance contemporaine à ériger les modes en valeur absolue et ce dans quasiment tous les domaines : Islamiquement correct (Alexandre Del Valle, L’Artilleur, 2018), Economiquement correct (Michaël Lainé, 2002), Médiatiquement correct (François Brune, 2010), Académiquement correct, Alain Bonnafous et Laurence Roulleau-Berger, 2011), Pédagogiquement correct (Elisabeth Altschull, 2011), Géopolitiquement correct (Harold Hyman, 2014) et même Ripostes au charliement correct ! (Christophe Lacroix, 2015) ; sans oublier Mathieu Bock-Côté (L’empire du politiquement correct, Cerf, 2018). Le Droit restait encore à l’écart du mouvement ; il l’a désormais rejoint.
Pour répondre plus directement à votre question, il s’agit, hélas, de beaucoup plus qu’une simple approche marketing qui viserait à combler une lacune de l’offre marchande. La réalité c’est que chacun peut constater l’essor dans nos sociétés de la présence de ces anglicismes désormais familiers que sont le political correctness, le woke ou la cancel culture.
Or, quantité de questions faisant l’objet de débats de société (bioéthique, avortement, politiques migratoires, droit d’asile…) reposent sur des éléments juridiques dont la réalité technique est méconnue par beaucoup. Et dans ces débats, le Droit fait aujourd’hui plus que jamais l’objet d’une utilisation politique et sociale particulièrement (des)orientée.
Ainsi, lorsque l’attention de l’opinion publique est attirée sur des questions possédant une dimension juridique, les « spécialistes » du droit interrogés, profitant de la méconnaissance de la majorité de nos concitoyens sur ces questions, en présentent les principaux éléments, mais de manière souvent troquée et toujours orientée. Avocats, juristes ou magistrats, adoptent fréquemment un discours politiquement militant ; discours dont les mots, revêtus de la caution scientifique du « sachant », cherchent à camoufler, derrière la pseudo neutralité de leur analyse technique, le prisme politique et les partis-pris idéologiques.
Leurs complices, politiciens ou journalistes, s’appuient ensuite sur leurs analyses réputées neutres afin de justifier leurs positions. De même, le discours de ces experts permet de déconsidérer toute opinion antagoniste, celle-ci étant considérée comme la position simpliste de celui qui ne sait pas et donc ne saurait avoir la moindre voix au chapitre.
Bref, dans les mains de ceux qui cherchent à disqualifier les acquis de l’expérience, le Droit se révèle une arme redoutable. Il importait de revenir aux textes afin de montrer qu’à l’encontre de la pensée du Juridiquement correct, le Droit se montre bien plus nuancé que cela n’est ordinairement présenté.
Ce mouvement se retrouve-t-il également du côté des prétoires ? Considérez-vous qu’il y a un souci avec la justice française ?
Le monde de la Justice n’est pas un monde étanche ! Il possède naturellement des liens avec la société.
D’abord car tous les litiges survenant peuvent être amenés à y être tranchés et parfois de manière bien plus rapide et concrète qu’au prisme de la loi. Souvenez-vous : le premier enfant au monde né d’une FIV ce fut Louisa Brown en 1979, alors que la loi française interdisant les contrats de mères porteuses n’intervint qu’à l’été 1993 ! Entre-temps et en absence de toute loi spécifique à cette question, ce fut le juge qui dut le premier trancher le point de savoir si le contrat de mère porteuse était nul ou pas.
Par ailleurs, il est fréquent que les prétoires se voient instrumentalisés à l’appui de toutes les revendications sociales (certains ont inventé le terme « sociétales ») ; il s’agit alors de forcer le juge à traiter d’une question (avant-hier l’avortement ou hier le mariage homosexuel ; aujourd’hui la demande d’accéder au droit à mourir…). L’important alors n’est pas tant que la demande soit rejetée ou validée, mais bel et bien de mobiliser l’opinion publique au prisme de la souffrance et de l’empathie, afin de permettre des évolutions politiques et législatives.
Dans le monde de la Justice, le Juridiquement correct se constate dans la démarche qui conduit à s’éloigner du texte même des lois et règlements pour en donner une interprétation tronquée. Ce mouvement est d’autant plus facile que les préceptes gouvernant le Droit sont à l’opposé même de ceux gouvernant le temps médiatique qui est aujourd’hui le nôtre. Le monde où règnent vitesse, rapidité et simplification, ne peut souffrir celui que modèlent nuances, précision et casuistique. Or, on n’accède pas aux règles juridiques de manière spontanée, il y faut du recul et de l’attention.
Réceptacle de l’ensemble des revendications sociales, la Justice connaît également celles s’appuyant sur le Juridiquement correct. Rendus par des hommes, il n’est pas rare que de nombreux jugements et arrêts portent la trace de leur sensibles à l’esprit du monde …
Mais justement ces hommes, ils sont souvent politisés ! Aux élections professionnelles de décembre 2022, le Syndicat de la magistrature vient même de recueillir 33,3 % des suffrages ! Alors que faire ?
Effectivement, il y a une forte prégnance de la sensibilité d’extrême-gauche chez les magistrats. Ce résultat du Syndicat de la magistrature est même en hausse de 3 points par rapport aux élections précédentes de 2018 (il s’agit de sa meilleure performance depuis 2010, mais notons que depuis 2002, ce syndicat n’a jamais remporté moins du ¼ des suffrages…). Peut-être d’ailleurs ce résultat est-il à rapprocher du fait que le tiers des admis au concours 2022 de l’École nationale de la magistrature est issu d’un cursus en Institut d’Études Politiques ; filière dont on sait la porosité avec le phénomène woke (aux élections d’octobre 2022, les étudiants se réclamant de l’arc-en-ciel idéologique correspondant à la NUPES ont obtenu 10 des 11 sièges d’élus étudiants à ScPo Paris…). Face à ce phénomène, une solution pourrait d’ailleurs peut-être résider dans l’élection des juges…
L’élection des juges ? Encore une manie d’outre-Atlantique ?
Effectivement, chaque fois que l’on aborde cette question, nous avons bien cette réaction typique du Juridiquement correct ! D’ailleurs, regardez bien ce qu’en dit justement le Syndicat de la magistrature dont nous parlions à l’instant : « L’élection des juges est une espèce de fantasme de justice à l’américaine qui ne correspond pas au système français. Elle repose sur l’hypothèse que le juge serait laxiste et le peuple répressif. C’est une idée fausse » (Mathieu Bonduelle, alors secrétaire général du Syndicat de la magistrature, Libération, 17 sept. 2010 ; relevons d’ailleurs que sur ce point, quasiment tous les magistrats français expriment leurs réticences). Combattons donc les idées reçues en la matière !
D’abord l’idée d’une élection des juges n’est pas une lubie américaine. On omet souvent de rappeler qu’au cours de la Révolution française, les Constituants s’attachèrent méthodiquement à briser la caste judiciaire : l’organisation de la Justice fut repensée, la patrimonialité supprimée et surtout il fut décidé par la loi des 16-24 août 1790 que les juges seraient à l’avenir élus et leur mandat temporaire : « les juges seront élus par les justiciables » (art. 3). L’année suivante, la première Constitution écrite de la France confirmera ce choix : « Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple » (Art. 5, titre III de la Constitution du 3 sept. 1791). Cette réforme se heurtera aux troubles accompagnants la Révolution, tandis que l’arrivée de Napoléon au pouvoir en sonnera le glas.
Ensuite chacun constatera que cette réticence à l’égard de l’élection des juges n’est pas absolue, elle vise pour l’essentiel les juges pénal et civil ; on ne pense d’ailleurs le plus souvent qu’à eux lorsqu’il est question d’élection des juges. Or c’est regrettable car ce faisant on oublie que la France connaît, encore aujourd’hui quantité de juges élus et il est rare que l’on demande qu’il soit mis fin à leur élection. C’est encore en effet le cas, depuis la Révolution, des magistrats chargés de trancher les litiges du commerce et du travail ; or, ils sont tout de même plus de 14 000 au sein des Tribunaux de commerce et Conseils de prud’hommes. On les oublie fréquemment.
Et l’élection des juges en France ne se limite pas à ceux-ci ! Il ne faut pas oublier que l’on connaît encore des milliers d’autres juges élus : c’est en effet le cas des juridictions disciplinaires de tous les ordres professionnels : infirmières, médecins, avocats, notaires, huissiers… Il faudrait encore leur ajouter les juridictions disciplinaires des fédérations sportives.
L’élection des juges serait alors la panacée ?
Certes non ! Et d’ailleurs toutes ces juridictions ne sont pas nécessairement exemplaires du seul fait de leur élection (d’ailleurs lesquelles le sont ?). Il convient simplement de relever qu’elles sont constituées par l’élection et que des juges élus y rendent la justice sans que cela ne suscite de violentes critiques…
Enfin, il est amusant de relever que tout le monde agite l’épouvantail américain en matière d’élection des juges, sans même connaître la réalité technique de ce système ! D’abord, les États-Unis sont un État fédéral et les juges fédéraux, jusqu’à la Cour suprême, ne sont pas élus, mais nommés par le président chef de l’État ; l’élection n’y concerne donc que les seuls juges des États fédérés. Qui plus est, elle varie nettement de l’un à l’autre : si 39 États y recourent à l’élection de leurs juges, celle-ci n’induit pas forcément une investiture par les partis, elle peut aussi être strictement individuelle. On y observe encore des élections dites de « rétention » ou de « maintien en poste » : les électeurs se prononcent sur le maintien d’un juge à l’issue de son mandat (il doit le plus souvent recueillir une majorité simple pour rester en place).
Surtout, l’objectif et l’intérêt principal de l’élection des juges réside dans le fait de les rendre politiquement indépendants des autorités publiques, afin de permettre que la Justice soit rendue dans des conditions de neutralité plus certaine… Pour autant, ce système n’est certes pas parfait, notamment eu égard au coût croissant des campagnes électorales (qui posent la question de l’indépendance de ces juges élus à l’égard des contributeurs à leurs campagnes électorales). En fait, beaucoup de choses dépendent de la droiture morale du juge élu ; « il n’est de richesse que d’homme » écrivait Jean Bodin au XVIe siècle, nihil nove sub sole… D’ailleurs, il est intéressant de relever qu’en Amérique également, la plupart des juges des États-Unis et des organisations de réforme des tribunaux considèrent les élections comme une mauvaise méthode de sélection des juges ! Etonnant, non ?
Au regard de tous ces éléments et compte-tenu de la politisation de nombreux juges français, leur élection, sans être parfaite, aurait nécessairement pour effet de les mettre en face de ceux au nom desquels ils jugent. Cette seule raison devrait suffire à la rendre incontestable.
À l’heure où les décisions de la CEDH semblent s’imposer, peut-on encore parler de souveraineté juridique en France ?
Lorsque l’on parle de l’Europe, il existe deux système juridique distincts, celui de l’Union européenne et celui du Conseil de l’Europe, chacun fonctionnant selon des règles spécifiques.
En ce qui concerne l’UE, il existe bien une supériorité technique du droit européen sur le droit national ; pour autant, cette réponse n’est pas satisfaisante car en réalité, le problème -et sa solution- ne sont pas de simples points de technique juridique, ils sont de légitimité politique. Or, la démocratie, c’est le droit politique inaliénable d’un peuple de décider sous quelles règles il veut vivre, fût-ce au détriment du respect technique du droit de l’Union.
En ce qui concerne le droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH), adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe, la situation est substantiellement différente. Si la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH), dont le siège est à Strasbourg, est bien chargée de trancher les litiges relatifs à l’application de la Convention, il convient de garder en mémoire que c’est d’abord le juge national qui se voit saisi du point de savoir si une règle issue du droit national respecte ou pas la Convention. Ce n’est qu’une fois tous les recours internes épuisés que la Cour EDH peut se voir saisie. Or, à ce moment-là, c’est au Gouvernement qu’il appartient de défendre le bien-fondé de la réglementation contestée devant la Cour EDH. Et plusieurs points peuvent être relevés.
D’abord, il arrive que le Gouvernement ne développe pas une grande ardeur à défendre une position contestée devant la Justice. Cela à un point tel qu’il a pu arriver à certains de se demander si le Gouvernement ne souhaitait pas voir sa réglementation condamnée par la Cour EDH afin de pouvoir s’appuyer sur cette condamnation pour modifier ladite réglementation… Cela lui permet alors de présenter son changement de règles ou de pratiques comme rendu nécessaire, non de sa propre volonté, mais bien pour respecter une décision de la Cour européenne des droits de l’homme.
Ensuite, il importe de relever que si les juges de la Cour EDH sont bien des juges, ils n’en restent pas moins des juges nationaux et que lorsque les affaires sont amenées à être tranchées en Grande Chambre (laquelle rassemble l’ensemble des juges de l’ensemble des États, pour trancher des affaires les plus sensibles, après un premier jugement en chambre de trois juges), ces mêmes juges savent assez souvent se montrer sensibles et attentifs aux arguments développés par les États. Pour ne prendre qu’un exemple, rappelons l’affaire des crucifix dans les salles de classe en Italie. Alors qu’en Chambre, la présence de ces crucifix avait été jugée comme portant atteinte à la liberté religieuse des requérants, il n’en avait pas été de même devant la Grande Chambre. Celle-ci avait alors jugé que la présence desdits crucifix relevait d’une dimension culturelle et non d’un prosélytisme de nature religieuse. Il est vrai également que l’Italie et plusieurs autres États du Conseil de l’Europe avaient alors su procéder à un lobbying tout aussi discret qu’efficace auprès de la Cour EDH…
Ces éléments sont importants à prendre en compte si l’on souhaite obtenir de la Cour des jugements respectant les valeurs et traditions juridiques nationales (telles qu’elles s’incarnent dans les différentes réglementations nationales) et d’autant plus au regard des liens longtemps entretenus entre la Fondation Soros et nombre de ces juges européens (mis en lumière par Grégor Puppinck et l’ECLJ).
Tous ces éléments permettent de considérer qu’il existe bien une souveraineté juridique de la France face à l’interprétation de la Convention EDH par la Cour EDH ; pour autant que nous gouvernants souhaitent réellement la faire prévaloir. Ce qui n’est pas toujours certain.