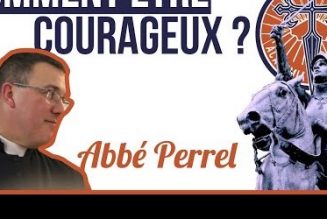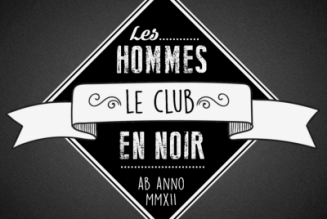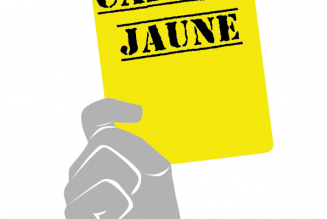À la fin du chant de l’introït, c’est-à-dire à peu près lorsque commence l’encensement de l’autel, la chorale entonne le Kyrie. Le prêtre, quant à lui, le récite alternativement avec ses assistants après avoir lu l’introït. Cette prière de supplication participe du mouvement de componction, de purification et de contrition manifesté depuis les prières au bas de l’autel. De telles manifestations seront fréquemment réitérées pendant le saint-sacrifice, comme pour attester la grande conscience de notre pauvreté, à commencer par celle du célébrant.
1. Langue
Remarquons tout d’abord que cette prière est en grec. Or, la messe comporte également quelques mots d’hébreu : Alleluia, Sabaoth, Hosanna, Amen. Par conséquent les trois langues dans lesquelles fut rédigé le titulus – l’inscription que Ponce Pilate fit placer sur la croix de Notre-Seigneur : « Jésus de Nazareth, Roi des Juifs »[1] – sont employées dans la messe.
2. Origine éloignée
L’invocation κύριε ἐλέησον [kyrie eleison, « seigneur, ayez pitié »], adressée à une divinité, est attesté à l’époque païenne, par exemple chez Épictète[2] et sa répétition un nombre de fois déterminé n’était pas inconnue dans l’antiquité. Mais, la Sainte Écriture nous livre également de nombreux exemple de cette supplication ἐλέησον [eleison, « ayez pitié »], adressée à Dieu, dans la version grecque de l’Ancien Testament, ou à Jésus dans les évangiles[3].
Ainsi, dans les psaumes, c’est le cri spontané du pécheur implorant la miséricorde de Dieu :
« Ayez pitié de moi, Seigneur [ἐλέησον με κύριε, eleison me kyrie], car je suis sans force ; guérissez-moi, Seigneur, car mes os sont ébranlés. » (Ps 6, 3)
« J’ai dit : Seigneur, ayez pitié de moi [Κύριε ἐλέησον με, kyrie eleison me] ; guérissez mon âme, car j’ai péché contre Vous. » (Ps 40, 5)
« Ayez pitié de moi, ô Dieu [ἐλέησον με ὁ θεος, eleison me ho theos], selon Votre grande miséricorde ; et selon la multitude de Vos bontés, * effacez mon iniquité. » (Ps 50, 3)
Et, dans l’évangile, ce sont les mots par lesquels les aveugles, les lépreux ou encore la Cananéenne s’adressent à Notre-Seigneur :
« Jésus, Fils de David, ayez pitié de moi [ἐλέησον με, eleison me]. » (Mc 10, 47 : l’aveugle Bartimée.)
« Jésus, Maître, ayez pitié [ἐλέησον, eleison] de nous. » (Lc 17, 13 : les dix lépreux)
« Ayez pitié de moi, Seigneur [ἐλέησον με κύριε, eleison me kyrie], Fils de David. » (Mt 15, 22 : la Cananéenne)
3. Origine prochaine
Aussi, cette supplication qui correspond bien à l’attitude de l’homme à la messe a fait son entrée dans la liturgie. On la retrouve d’abord en Orient, à Jérusalem[4], dans le cadre de prières litaniques, qui seront importées en Occident vers le Ve siècle.
À Rome, dans le cadre de la liturgie stationnale, c’est-à-dire de la liturgie solennelle que célébrait le pape en personne dans les grandes occasions, on se réunissait tout d’abord dans une première église, dite église de la collecte, d’où l’on partait en procession vers une autre église, dite église de la station, pour y célébrer la messe. Le chant litanies accompagnait la procession, avec pour refrain le Kyrie eleison. Lorsque l’usage se perdit de faire ces processions, l’on conserva néanmoins le refrain des litanies, c’est-à-dire le Kyrie eleison.
La Vigile pascale conserve une trace de cette origine litanique du Kyrie eleison de la messe, puisqu’il n’y a pas d’Introït et que le Kyrie qui conclut les litanies est en même temps celui de la messe.
4. Structure
Depuis saint Grégoire le Grand au moins (VIesiècle), le Kyrie est composé de neuf invocations récitées alternativement par le prêtre et ses assistants, où bien chantées alternativement par la chorale et l’assistance :
– trois Kyrie eleison : « Seigneur, ayez pitié » ;
– trois Christe eleison : « Christ, ayez pitié » ;
– trois Kyrie eleison : « Seigneur, ayez pitié. »
« Cette ordonnance fondée sur le nombre trois [trois fois trois] répond à un usage sacré extrêmement ancien, tel qu’il apparaît de façon impressionnante dans les cultes antérieurs au christianisme, en particulier dans le Rome antique. »[5]
Dans le cadre de la lutte contre l’arianisme, cette structure ternaire a également revêtu une signification trinitaire, qui nous paraît plus évidente : on invoque trois fois Dieu le Père, trois fois le Fils, trois fois le Saint-Esprit.
On peut aussi référer les neuf invocations aux neufs chœurs angéliques :
« Les trois cris différents répétés par trois fois, ainsi que le veut actuellement la liturgie, nous montrent le rapport qui existe ici-bas avec les neuf chœurs qui chantent dans le ciel la gloire du Très-Haut. Cette union avec les anges prépare au Gloria qui va suivre : cantique angélique apporté sur la terre par ces esprits bienheureux. »[6]
5. Position du prêtre
À la messe solennelle [ou chantée], le Kyrie est récité au coin de l’épître : c’est la logique « ancienne », qui veut que le prêtre se tienne au coin de l’épître de l’introït à l’épître. À la messe basse, cependant, le prêtre vient au centre de l’autel pour réciter le Kyrie :
« On peut présumer que le déplacement vers le milieu de l’autel est né du désir d’accentuer le caractère de prière [au sens de supplication, supplicatio/deprecatio] en plaçant le prêtre face à l’image du Crucifié, à qui il adresse son appel. »[7]