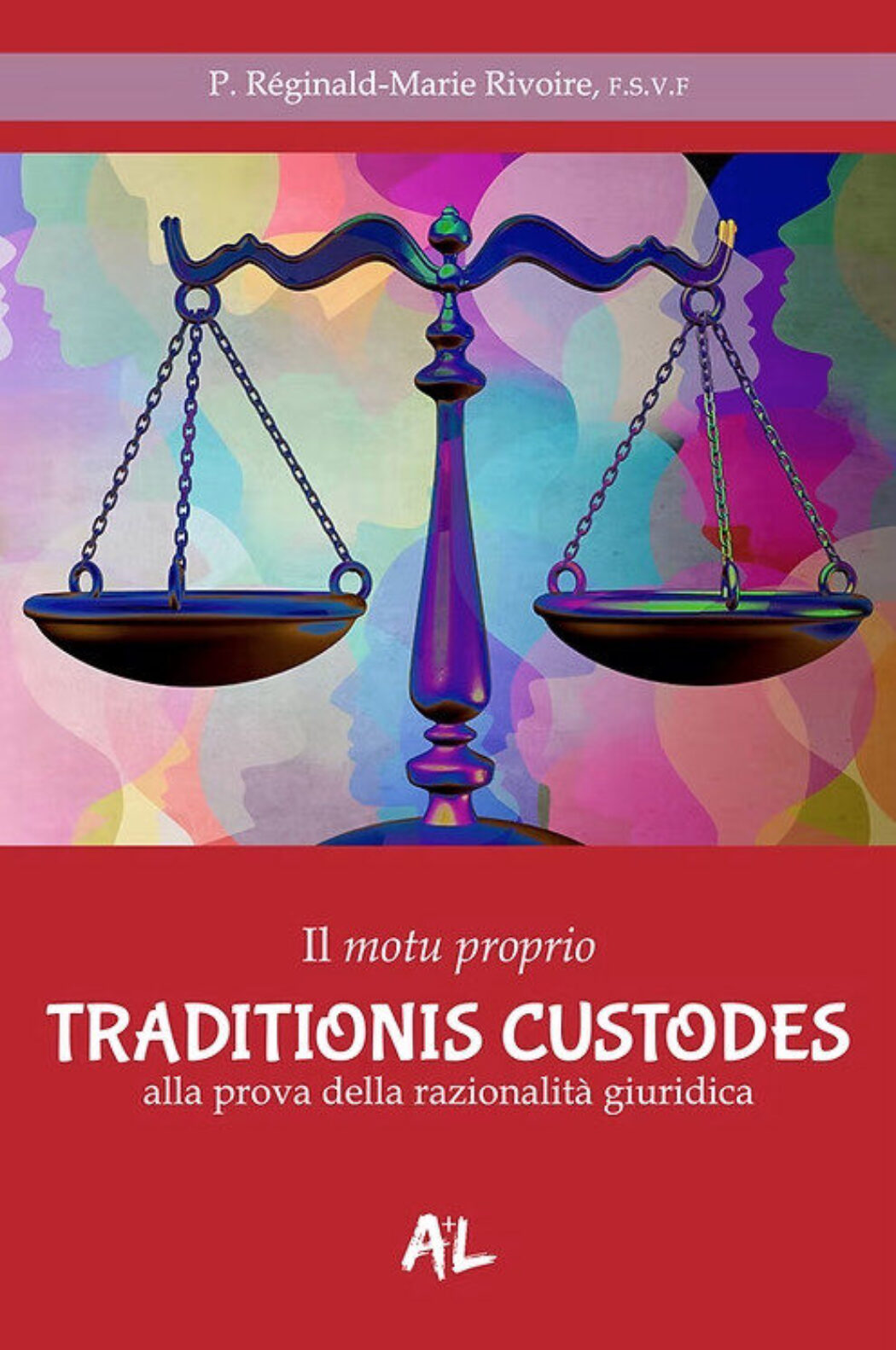Deux ans après sa publication en français, l’important travail d’analyse du motu proprio Traditionis Custodes par le Père Réginald-Marie Rivoire, prêtre de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier, docteur en droit canonique et promoteur de justice au tribunal ecclésiastique de Rennes, est désormais traduit en italien. Le motu proprio Traditionis Custodes à l’épreuve de la rationalité juridique, a le grand mérite de mettre en évidence, preuves à l’appui, le positivisme et le volontarisme juridiques de ce pontificat, ce qui est particulièrement pertinent au regard de la manière dont le pape François – et le Dicastère pour le culte divin et la discipline des sacrements – a entendu intervenir à l’égard du rite ancien.
La comparaison entre Summorum Pontificum (SP) de Benoît XVI et Traditionis Custodes (TC) de François montre non seulement les résultats opposés trop évidents des deux mesures, mais aussi l’approche juridique inconciliable qui les sous-tend. L’auteur écrit :
« Le contraste est vraiment remarquable entre les deux manières de légiférer, l’une marquée par le réalisme juridique, l’autre par le positivisme volontariste. Là où Benoît XVI reconnaît, par un acte déclaratif, deux réalités rituelles qui, de fait, existent aujourd’hui dans l’Église latine […], et entend leur donner un cadre juridique, François décide, par un acte performatif, qu’il n’y a qu’une seule de ces réalités dans l’Église »
La manière de gouverner de François est plus celle d’un monarque « dont la pensée et la volonté font loi », que celle d’un garant « de l’obéissance au Christ et à sa Parole » (Benoît XVI, Homélie à l’occasion de son installation sur la Cathedra Romana, 7 mai 2005). Il a ainsi subverti les principes du droit selon la perspective réaliste et catholique, selon laquelle la loi oblige en tant qu’ordinatio rationis et non pas simplement en vertu de l’obéissance à une autorité pourtant légitime. La volonté du législateur dissociée de l’ordre rationnel conduit directement à la dangereuse violation de la loi et à la négation encore plus pernicieuse de la réalité. Car la rationalité dont nous parlons n’est pas celle, réductrice, de la logique formelle, qui se traduit dans le domaine juridique par un simple légalisme, mais elle est plus largement l’adaptation à la réalité. Dans la saine conception du droit, loin du machiavélisme et du jésuitisme, c’est cette rationalité qui normalise la norme ; si la norme ne recevait pas sa mesure de l’ordinatio rationis, on aboutirait à l’arbitraire total de l’autorité.
Qu’a fait Benoît XVI avec SP ? Il est parti du constat de l’existence de deux formes rituelles dans l’Église latine (d’où l’affirmation de la non-abrogation des anciens livres liturgiques), dont l’une était séculaire, et a cherché à les encadrer juridiquement, afin de poursuivre le bien commun. On peut se demander si cela a été fait de la meilleure façon, mais on ne peut pas nier que le pape Benoît a appliqué la raison prudentielle pour harmoniser deux réalités rituelles dont il avait pris note. Qu’a fait le pape François ? Il a décidé d’utiliser le droit contre la réalité, en inventant que la seule forme du rite romain serait celle issue de la réforme voulue par Paul VI, reléguant ainsi le rite romain séculaire dans le monde des rêves… Encore une fois, dans l’article 1 de TC, François prétend que les livres liturgiques issus de la réforme seraient conformes aux décrets du Concile Vatican II ; une affirmation qui, comme nous le verrons, est tout simplement fausse.
Avec concision et précision, le Père Rivoire montre tout d’abord que le rite issu de la réforme n’est tout simplement pas le rite romain ; il comporte certes des éléments du rite romain, mais il l’a en fait si profondément modifié et déformé qu’il ne peut prétendre à une continuité effective de la forme. La réforme, dans ce cas, n’était pas la récupération de la forme, mais l’octroi d’une nouvelle forme. Or, une nouvelle forme indique précisément quelque chose de nouveau. L’auteur cite les mêmes défenseurs enthousiastes de la réforme liturgique, comme le père Joseph Gélinau et le père Annibale Bugnini, qui parlaient précisément du rite romain « détruit », d’un véritable « remake », et non d’un développement. Il faut être honnête et regarder la réalité, qui ne peut être changée par des décrets : un article important de Matthew Hazell a montré que seulement 13% des prières présentes dans l’ancien rite ont été conservées intactes et inchangées dans le nouveau et que 52% ont été complètement omises ; le lectionnaire a également été radicalement déformé ; dans le calendrier liturgique, la Septuagésime, l’Octave de la Pentecôte, les Rogations et en fait les Quatre Temps (maintenus comme facultatifs, mais privés de leur propre et maintenant en désuétude) ont été supprimés. Dans l’Ordinaire, nous avons assisté à la suppression des rites d’entrée, à la refonte complète de l’Offertoire, à l’ajout de prières eucharistiques fabriquées de toutes pièces, à une mutilation des gestes liturgiques. Et l’on pourrait continuer. Il s’agit bien d’un nouveau rite.
Et c’est toujours en regardant la réalité que l’on peut affirmer sereinement que le Missel promulgué par Paul VI n’est pas conforme aux exigences des Pères du Concile, telles que nous les trouvons dans Sacrosanctum Concilium (SC). Nulle part la constitution liturgique de Vatican II n’envisage « la suppression de l’offertoire traditionnel, ni la composition de nouvelles prières eucharistiques, ni la suppression ou la modification de presque toutes les prières, ni la célébration face au peuple, ni la récitation du canon à haute voix, ni encore moins la communion dans la main » (p. 21). Sans parler des indications positives concernant le maintien de la langue latine et du chant grégorien, qui ont été complètement ignorées. SC n’avait pas non plus à l’esprit un « rite protéiforme » (p. 23), c’est-à-dire un rite qui n’en est plus un dans la mesure où les éléments de la ritualité ont été sérieusement altérés, et où l’on se trouve à chaque instant confronté à des rubriques facultatives. Il n’est pas faux de penser que c’est précisément l’ancien rite qui est plus conforme aux souhaits des Pères du Concile que le nouveau…
Le volontarisme juridique qui anime TC a conduit à plusieurs reprises à piétiner le droit canonique et à accumuler les maladresses juridiques, comme l’auteur le montre. Derrière la question liturgique se cache la relation la plus fondamentale entre le Pape et la Révélation de Dieu, dans l’Ecriture et la tradition, dont l’Ancien Rite Romain est l’expression première.
« Ce qui est déconcertant, ce n’est pas tant que François contredise son prédécesseur, mais qu’il traite un rite liturgique multiséculaire comme s’il s’agissait d’une question purement disciplinaire »