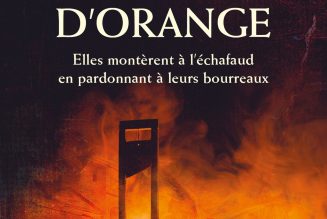Benoît Schmitz, normalien, agrégé d’histoire et ancien membre de l’École française de Rome, évoque dans Le Figaro la problématique de l’autorisation du culte public. Extraits :
[…] Les arguments qui ont été avancés mais aussi ceux qui ont été passés sous silence ne laissent toutefois pas de surprendre l’historien qui étudie, dans la longue durée, les relations entre l’Église et l’État. En premier lieu, la communication officielle des instances ecclésiales a mis l’accent sur la blessure que le mépris du gouvernement aurait infligée aux croyants. Selon une pente propre au catholicisme contemporain, enclin au sentimentalisme, les décisions du pouvoir n’ont pas été considérées politiquement et juridiquement, mais affectivement, comme si l’Église devait, comme d’autres groupes et minorités, voir d’abord en l’État une sorte de mère dont il faudrait rechercher désespérément la reconnaissance et l’approbation. De surcroît, une bonne part des réactions épiscopales semble avoir été dictée par le refus de tout conflit avec le pouvoir civil. Aucune condamnation formelle de l’atteinte portée à la liberté de l’Église n’a été prononcée, ce qui pouvait se faire même sans appeler les fidèles à la désobéissance civile. Les voies de recours qu’autorise le droit positif et que viennent de suivre avec succès certaines associations de prêtres ou de citoyens, ainsi qu’un parti politique, n’ont pas même été tentées par les évêques. Enfin, si on a rappelé, à juste titre, la tradition chrétienne de soumission aux pouvoirs publics, on a mis sous le boisseau la doctrine tout aussi chrétienne qui fixe de justes limites au pouvoir de l’État et distingue le pouvoir spirituel du pouvoir temporel. […]
Face aux formes contemporaines de tyrannie, il serait périlleux de ne compter, pour sauvegarder les libertés publiques, que sur les garanties constitutionnelles et les décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, même s’il est heureux pour notre République que ces juridictions aient rendu, en ce temps de déconfinement, plusieurs décisions au rebours des mesures abusives du gouvernement. La résistance aux velléités totalitaires de l’État et de la société dépend d’abord du courage civique et de l’intelligence politique de chaque citoyen. C’est là que nous retrouvons le pouvoir spirituel et ce qu’il peut représenter pour chacun de nous, croyant ou non. Le dualisme propre à la tradition occidentale établit que le pouvoir temporel n’est pas le seul pouvoir. La faculté de dire non, de refuser son consentement et sa participation, à un État dévoyé peut trouver un puissant renfort dans le pouvoir de l’Église. En 1978, le futur Benoît XVI avait exposé l’alternative fondamentale: «ou bien […] on attribue à l’État le pouvoir séculier unique et tout-puissant, ou bien, selon la solution romaine, on érige la papauté en vis-à-vis, à la fois impuissant et puissant, du pouvoir séculier» . Dans la seconde hypothèse, le pouvoir pontifical est un signe de contradiction, «une opposition explicite au pouvoir du monde comme pouvoir unique».
Sans doute vivons-nous un moment d’éclipse du pouvoir spirituel. Mais le propre d’une éclipse est de ne pas durer. Déjà, des pasteurs se sont élevés pour défendre la liberté de culte et, avec elle, les autres libertés publiques. Monseigneur Bernard Ginoux, évêque de Montauban, a par exemple publié le 11 mai 2020 une lettre pastorale où il dénonce «l’atteinte aux droits des fidèles catholiques de participer librement à la messe» , rappelle que la loi civile injuste n’oblige pas, s’inquiète «d’une atteinte aux droits humains fondamentaux qui pourrait entraîner d’autres dérives» et invite ses diocésains à «vivre librement [leur] foi». Encouragés par l’ordonnance du Conseil d’État, d’autres suivront. Et, qui sait? Peut-être l’Église pourrait-elle regagner, en servant ainsi le vrai bien commun, le crédit qu’elle semble avoir perdu auprès des peuples d’Occident.