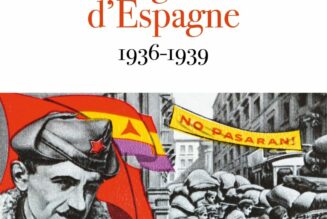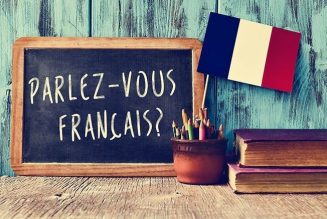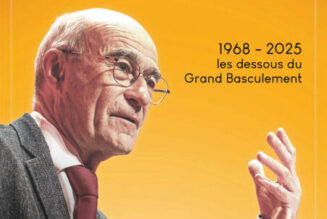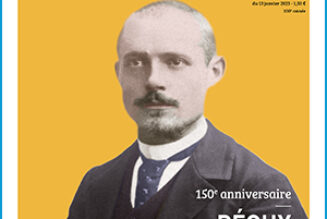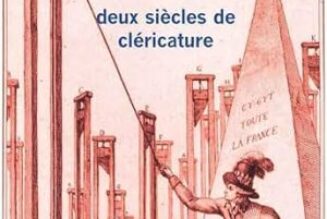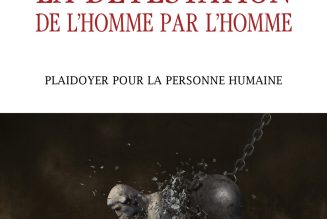Un correspondant de The Economist rend compte de sa récente visite au Thomas Aquinas College, en Californie :
Par une matinée pluvieuse d’été, huit étudiants et un professeur étaient assis autour d’une table au Thomas Aquinas College, un établissement catholique situé au nord-ouest de Los Angeles. Ils étaient tous vêtus de façon formelle – les hommes portaient une cravate – et s’adressaient les uns aux autres en les appelant « Monsieur » et « Madame ». Pendant des heures, le groupe a débattu de « L’Ours », le récit de William Faulkner racontant l’histoire d’un jeune chasseur désabusé par les efforts de l’humanité pour soumettre la terre et ses créatures. La scène aurait ravi quiconque désespère de voir les étudiants universitaires ne pas lire, ne pas vouloir lire et ne pas savoir lire.
Cette discussion aurait particulièrement plu aux Américains de droite, et pas seulement parce que l’université Thomas Aquinas compte le corps étudiant le plus conservateur des États-Unis. Car il ne s’agissait pas d’une conversation sur les politiques identitaires déguisée en théorie littéraire : au contraire, les étudiants se sont concentrés sur le texte et ont parlé de peur, de courage, de bonté et d’autres vertus. Ces dernières années, certains conservateurs américains ont consacré beaucoup de temps et d’énergie à interdire les livres qu’ils détestent. D’autres, en revanche, s’efforcent de promouvoir ceux qu’ils aiment. Quels types de romans correspondent à cette vision, et pourquoi ?
Inévitablement, la réponse dépend du conservateur interrogé. George H.W. Bush appréciait « Guerre et Paix » : il affirmait que le vaste roman philosophique de Léon Tolstoï lui avait appris « beaucoup de choses sur la vie ». (Il l’avait sans doute lu avant d’entrer en fonction : un président qui se plonge dans une épopée gargantuesque sur les guerres napoléoniennes pendant son mandat a tendance à déléguer un peu trop facilement.) Greg Abbott, le gouverneur du Texas, a deux livres de prédilection : « La Grève », l’ode à l’individualisme d’Ayn Rand, adorée par une grande partie de la droite ; et « Le Meilleur des mondes », la fable dystopique d’Aldous Huxley qui se déroule dans un futur sans Dieu, sans famille et régi par une planification centralisée (soit le genre de monde que les Républicains aiment à accuser les Démocrates de vouloir créer).
JD Vance, le vice-président, se décrit comme un grand fan du « Seigneur des Anneaux ». La trilogie de J.R.R. Tolkien raconte l’histoire de quatre hobbits – incarnations de la vie rurale anglaise traditionnelle, alors en pleine industrialisation – qui, à contrecœur, se lancent dans une mission pour sauver le monde de Sauron, un sorcier maléfique. Les mémoires de M. Vance, « Hillbilly Elegy » , relatent également la destruction de sa petite ville rurale par des forces qui la dépassaient, dont, ironiquement, la désindustrialisation. Nul doute que M. Vance se perçoive comme un hobbit vertueux prenant les armes à contrecœur pour défendre le mode de vie de son peuple.
Le roman le plus souvent cité lors du sondage informel mené par votre correspondant à Thomas Aquinas était « My Ántonia » de Willa Cather. Publié en 1918, ce livre raconte l’histoire de familles pionnières de fermiers du Nebraska. Son personnage principal est Ántonia Shimerda, à travers le regard de son ami d’enfance, Jim Burden, un orphelin envoyé vivre chez ses grands-parents. C’est un récit sobre et poignant sur le passage à l’âge adulte et les occasions manquées en amour.
L’œuvre de Cather fait l’objet d’un chapitre entier dans un nouvel ouvrage intitulé « Treize romans que les conservateurs adoreront (mais qu’ils n’ont probablement pas lus) ». Christopher Scalia, ancien professeur de littérature et fils du regretté Antonin Scalia, juge à la Cour suprême, y analyse les romans et les leçons qu’ils véhiculent selon lui. Il loue le talent de Cather pour la description et sa capacité à valoriser le travail, le stoïcisme et la vie domestique. Ántonia est pauvre, et sa situation s’aggrave encore après le suicide de son père ; harcelée et trahie par les hommes, elle conquiert son indépendance à force de labeur. Son histoire, explique M. Scalia, illustre « la complexité du rêve américain, la réalité de l’autonomie individuelle et les fruits du travail et du sacrifice ».
M. Scalia est un lecteur trop perspicace pour réduire les romans à des paraboles : il comprend que la bonne fiction procure autant de plaisir que d’instruction, et il examine chacun des treize ouvrages qu’il a sélectionnés séparément. Trois qualités principales se dégagent néanmoins de son analyse.
La première est la foi. Mais plutôt que de choisir une œuvre évidente comme, par exemple, « Le Monde de Narnia », ou une autre œuvre du même genre où les pieux sont récompensés et les impies damnés, il comprend qu’il y a quelque chose d’étrange et de mystérieux dans la croyance religieuse.
Muriel Spark, qui a abandonné son fils, ne semble pas être le choix évident d’un critique littéraire conservateur, censé défendre les valeurs familiales. Pourtant, M. Scalia inclut sa nouvelle de 1963, « Les Filles aux moyens modestes », dans sa sélection, car elle montre que des conversions religieuses profondes et sincères peuvent être suscitées par des expériences autres que des visions célestes ou des statues en pleurs. L’un des personnages de Spark, Nicholas, intellectuel aux penchants anarchistes, est tellement horrifié par l’égoïsme et le vide moral des femmes qu’il rencontre dans le Londres en guerre qu’il part pour Haïti afin de devenir missionnaire. Ceux qui n’apprécient pas la compagnie de leurs compatriotes américains, suggère-t-on, préféreront peut-être celle du Christ.
friction littéraire
La seconde vertu se situe entre la résilience et le refus du victimisme. M. Scalia loue « Leurs yeux regardaient Dieu » (1937) de Zora Neale Hurston pour la ténacité et l’esprit d’entreprise de son héroïne, Janie, déterminée à construire sa vie selon ses propres conditions. De même, il admire le magnifique « Un tournant dans le fleuve » de V.S. Naipaul , publié en 1979. Se déroulant dans un pays africain non identifié, l’histoire suit Salim, un marchand indien musulman, témoin de l’accession de ce pays à l’indépendance. Le roman réfute l’idée simpliste et répandue selon laquelle tous les Africains seraient vertueux parce qu’ils sont opprimés, et tous les Européens ayant vécu en Afrique étaient mauvais et rapaces. Ce livre, affirme M. Scalia, « contribue à contrer la pensée unique qui tend à minimiser les réalisations de la culture occidentale ».
Troisièmement, et enfin, M. Scalia recommande les romans traitant de l’art de vivre en société. (Rand, auteur d’ouvrages didactiques et insipides, n’est pas mentionné ici.) « The Blithedale Romance » (1852) de Nathaniel Hawthorne oppose les idéaux utopiques d’une communauté agricole à l’égoïsme inhérent à la nature humaine. « Evelina » (1778) de Frances Burney illustre l’importance des bonnes manières : pour l’héroïne, fille illégitime d’un noble, la politesse n’est pas une simple convention sociale, mais témoigne d’une « maturité sociale et d’un bon jugement ». La compréhension des codes de la haute société britannique est essentielle à la réussite d’Evelina, qui doit notamment conclure ce mariage si important.
Nombreux sont les lecteurs qui ne partageront pas l’interprétation de M. Scalia — Hurston est elle aussi une figure emblématique du féminisme, et Tolkien compte de nombreux admirateurs à gauche — mais les bons romans se doivent de susciter des débats et des interprétations divergentes. Les conservateurs comme M. Scalia comprennent que la littérature peut encore influencer la société. Comme l’a dit le dramaturge Bertolt Brecht : « L’art n’est pas un miroir tendu à la réalité, mais un marteau pour la façonner. »
Si vous souhaitez également en savoir plus sur une université où les étudiants lisent, veulent lire et peuvent lire, et où ils étudient et discutent des grandes œuvres dans la quête de la sagesse, et non d’un soutien idéologique, alors vous aussi, vous voudrez peut-être visiter le Thomas Aquinas College.