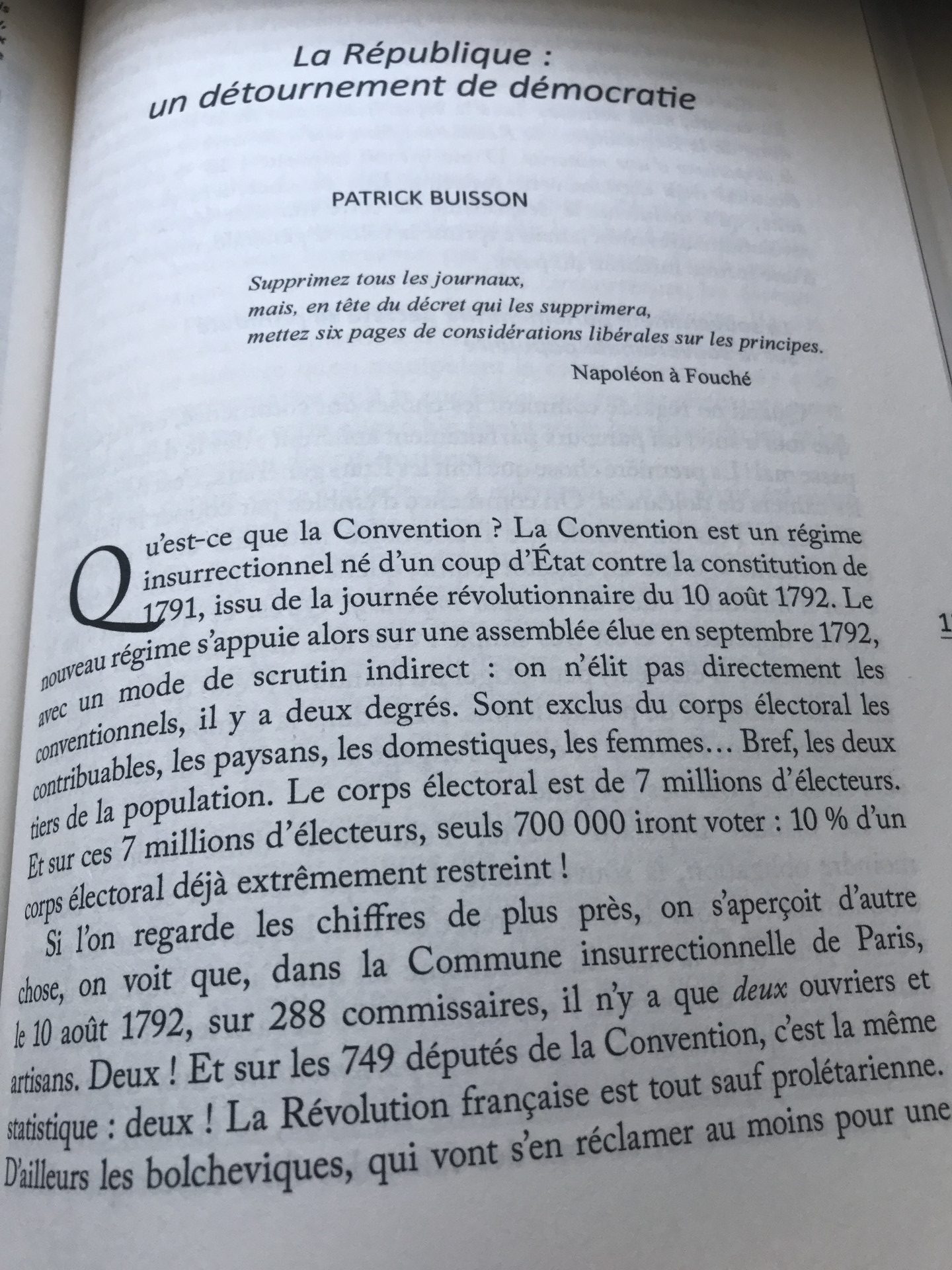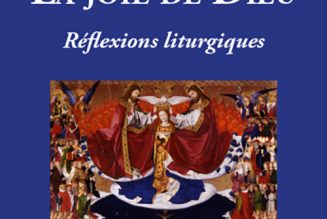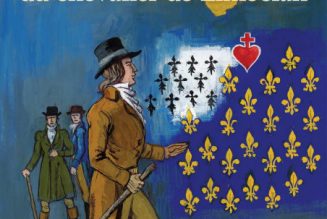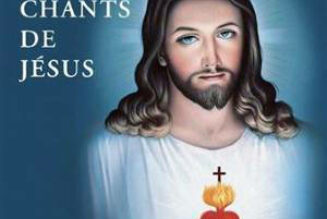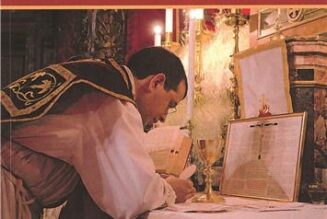Voici une contribution de Patrick Buisson (+) publiée dans le numéro 72 de La Nouvelle revue universelle parue au 2e trimestre 2023.
Supprimez tous les journaux, mais, en tête du décret qui les supprimera, mettez six pages de considérations libérales sur les principes. Napoléon à Fouché
Qu’est-ce que la Convention ? La Convention est un régime insurrectionnel né d’un coup d’État contre la constitution de 1791, issu de la journée révolutionnaire du 10 août 1792.
Le nouveau régime s’appuie alors sur une assemblée élue en septembre 1792, avec un mode de scrutin indirect : on n’élit pas directement les conventionnels, il y a deux degrés. Sont exclus du corps électoral les contribuables, les paysans, les domestiques, les femmes… Bref, les deux tiers de la population. Le corps électoral est de 7 millions d’électeurs. Et sur ces 7 millions d’électeurs, seuls 700 000 iront voter : 10 % d’un corps électoral déjà extrêmement restreint !
Si l’on regarde les chiffres de plus près, on s’aperçoit d’autre chose, on voit que, dans la Commune insurrectionnelle de Paris, le 10 août 1792, sur 288 commissaires, il n’y a que deux ouvriers et artisans. Deux ! Et sur les 749 députés de la Convention, c’est la même statistique : deux ! La Révolution française est tout sauf prolétarienne.
D’ailleurs les bolcheviques qui vont s’en réclamer au moins pour une part, diront toujours que l’esprit de la Révolution fut petite-bourgeoise. Au moins, ils ne sont pas dupes !
Même si pour eux, nous le savons, la Convention reste une référence, nous verrons pourquoi. Marx lui-même ne s’y est jamais trompé, il a toujours désigné la bourgeoisie comme la caste évolutionnaire par excellence, il l’affirme à de multiples reprises.
La conclusion, très simple, que l’on peut en tirer est indiscutable. Là encore, nous sommes dans la leçon inaugurale de la Révolution et donc de la République : la Révolution française a été créée et imposée par le despotisme d’une minorité. D’une infime minorité ! 10% d’un corps électoral déjà extrêmement restreint. Elle ne cherchera plus, par la suite, qu’à maintenir le despotisme de cette minorité légale. Les lois révolutionnaires n’ont jamais exprimé la volonté générale, mais la volonté d’une infime minorité du pays.
La souveraineté parlementaire décrète sa primauté sur la souveraineté populaire
Quand on regarde comment les choses ont commencé, on s’aperçoit que tout a suivi un parcours parfaitement cohérent : dès le début tout se passe mal. ! La première chose que font les Etats Généraux, c’est de répudier les cahiers de doléances. On commence d’emblée par couper le lien avec le peuple. Puis on transforme l’Assemblée nationale en « assemblée constituante ».
Celle-ci, aussitôt réunie, quelle est sa première décision ? C’est d’interdire l’idée de mandat impératif. Qu’est-ce que c’est que le mandat impératif ?
C’est très simple : c’est une disposition par laquelle le mandataire (l’électeur) peut exiger du mandant (l’élu) de s’engager sur un certain nombre de points définis. Mais dans la démocratie française, c’est exactement l’inverse : l’élu ne s’engage à rien. Et la décision qu’il en sera ainsi est prise dès l’origine.
Le mandat impératif écarté, l’élu étant donc exonéré de la moindre obligation, la souveraineté du corps électoral se sera exercée uniquement… le jour du vote. Après, c’est fini, la souveraineté du peuple n’existe plus. C’est la base du libéralisme tel que l’abbé Sieyès le décria dans son fameux discours du 7 septembre 1789 devant les États généraux, un discours qui établit la souveraineté parlementaire aux dépens de la souveraineté populaire. Aussitôt, entre les deux, le cordon est rompu. Ce point est indiscuté, ce sont des faits, des faits historiques. Donc cette souveraineté parlementaire établie au détriment de la souveraineté populaire signifie que, dès le départ, l’on congédie le peuple : on le suspecte de se comporter de façon immature, d’être incapable de jugement objectif, de céder à ses passions, etc. Depuis ce moment-là, notre démocratie représentative n’a plus pour souci que de « protéger » le peuple tantôt contre son immaturité, tantôt contre sa dangereuse prétention à exercer lui-même sa souveraineté. Jacques Julliard parle à ce propos de « démocratie substitutive ». J’ajouterai qu’il s’agit de la démocratie des démolatres qui n’a rien à voir avec la démocratie des démophiles, ce qui est facile à prouver.
Toute l’histoire de la République s’inscrit finalement dans un combat contre la démocratie des démophiles, Notre République ne s’est jamais souciée, à aucun moment, d’accomplir la volonté générale, mais plutôt d’en restreindre l’expression par des procédures d’exclusion ou neutralisation. En frappant, au gré des circonstances, les diverses catégories de population, la plupart du temps les plus modestes. Il y a là une constante, comme si, victime d’un suprême paradoxe, la démocratie pouvait se survivre qu’en manipulant le corps électoral. Il n’y a de démocratie représentative qu’à la condition que ces représentants aient confisqué le pouvoir, cette oligarchie fixant seule les règles du jeu et les modifiant en fonction des circonstances.
En fait, depuis cette période, le « souverain » n’a jamais été autre que captif, pour mot d’un politique de l’avant-guerre, André Tardieu, auteur d’un livre très intéressant, précisément intitulé « Le Souverain Captif » (1). A tous les stades de l’histoire, la République n’a jamais été autre chose qu’un cratos sans démos, un pouvoir sans le peuple. En 1795, par exemple, qu’est-ce qu’impose la constitution de l’an III, qui est à l’origine du Directoire? Le suffrage censitaire, qui va prévaloir pendant tout le XIX siècle, et qui revient à exclure de l’expression de la volonté générale les ouvriers, les artisans et les paysans – autrement dit ce que l’historien Jacques Chevalier appelait les classes laborieuses, considérées par le pouvoir comme des classes dangereuses.
A cela s’est ajoutée pendant longtemps l’exclusion des femmes, jusqu’à l’assemblée d’Alger en 1944. Alors que toutes les monarchies européennes leur avaient octroyé le droit de vote, nous étions le dernier régime à ne pas l’avoir fait. La République s’y refusait, au prétexte que les femmes étaient supposées être aliénées, dominées par le cléricalisme et sujettes à des influences qui auraient nui aux intérêts de la République. Le parti radical a en effet été le dernier bastion du machisme parlementaire.
La Révolution contre les femmes
À propos des femmes, je voudrais introduire ici une incise d’actualité. On parle aujourd’hui beaucoup du féminisme, et aussi des valeurs républicaines. Je voudrais rappeler des réalités peut-être un peu oubliées mais qui permeettent de commencer un inventaire de ces valeurs républicaines. Car il faut bien savoir de quoi l’on parle. Personne ne veut plus s’en souvenir, mais la Révolution française s’est faite contre les femmes. La République, c’est la revanche virile des hommes sur le monde des femmes, identifiées à l’Ancien régime, et rejetées notamment parce qu’on les considérait comme saturées de libertinage C’est la revanche des mâles sur le pouvoir des femmes, pouvoir qu’elles exerçaient sur la langue, sur le goût, sur la politique, sur la littérature, et que dénonçait déjà Jean-Jacques Rousseau dans sa Lettre à d’Alembert sur les spectacles. Il y a là une constante: l’Ancien régime, que l’on présente aujourd’hui comme un régime de patriarcat, s’accommodait volontiers d’un pouvoir féminin qui n’est en rien l’apanage de la modernité. Ce que les sans-culottes reprochaient aux femmes, en fait, c’est à la fois d’avoir pris la place des hommes et d’avoir exercé un pouvoir. C’est cela qui va être le fil rouge de tous les procès faits à des femmes durant cette période : celui de Marie-Antoinette, celui de Charlotte Corday, celui de madame Roland, celui d’Olympe de Gouges…
Ce sont toujours les mêmes griefs qui leur sont faits. Pour la Convention, qui cherche à imposer un nouveau modèle politique placé sous le signe de la vertu, la femme c’est, je cite, le « dérèglement des mœurs » et, partant, du régime politique. A tel point que l’un des premiers actes, l’un des premiers décrets adoptés par les conventionnels, proposé par le citoyen Amard, a été de faire fermer des sociétés et des clubs de femmes. Et avec des motivations que j’ose à peine rapporter ici: « La constitution des femmes est mortelle pour les affaires publiques… La femme, c’est l’erreur et le désordre… » Voilà ce que dit la Convention qui fonde notre République. Il n’y avait donc rien de plus urgent, pour les conventionnels, que de renvoyer les femmes à leurs foyers.
Je ne miserais pas un liard aujourd’hui sur la pérennité de l’historiographie républicaine quand Mme Caroline De Haas et autres féministes se mêleront de la revisiter. Car la prochaine secousse à venir, elle est là ! Et c’en sera, croyez-moi, fini de la République des Jules ! Notamment du premier d’entre eux, peut-être le moins mauvais, le plus doué en tout cas, je veux parler de Jules Michelet. Il faut lire son livre Histoire de la Révolution Française. Il est évident que nos féministes ne l’ont pas ouvert, Vont-elles le découvrir? Michelet parle de « l’ennemi de la République ». Qui est-ce ? Qui fomente l’œuvre des ténèbres ? Les femmes ! Les femmes alliées au parti-prêtre ! Je ne résiste pas au plaisir de vous lire une de ces pages de Michelet, qui vous permettra de mesurer la gravité de son cas, et peut-être, à l’issue de mon intervention, d’appeler un numéro vert pour signaler ce cas de maltraitance littéraire.
Je cite Michelet: « La femme, qu’est-ce encore ? Le lit. L’influence toute puissante des habitudes conjugales. La force invisible des soupirs et des pleurs sur l’oreiller. Ainsi dans chaque famille, dans chaque maison, la Contre-Revolution avait un prédicateur ardent, zélé, infatigable. Nullement suspect, sincère, naïvement passionné, qui pleurait, souffrait, ne disait pas une parole qui ne fût ou ne parut un éclat du cœur brisé. Force immense, vraiment invincible ; à mesure que la Révolution, provoquée par les résistances, était obligée de frapper un coup, elle en recevait un autre : la réaction des pleurs, le soupir, les sanglots, le cri de la femme, plus perçant que le poignard. Peu à peu, le malheur immense commença à révéler ce cruel divorce : la femme devenait l’obstacle et la contradiction du progrès révolutionnaire que demandait le mari. »Voilà ce qu’a écrit Michelet !
À ceux qui penseraient que ces événements sont bien lointains, je voudrais rappeler, puisque nous faisons toujours cet inventaire des valeurs républicaines, qu’il m’a été donné de consacrer deux gros livres à l’histoire des mœurs sous l’Occupation – 1940-1945, années érotiques (2) – qui m’a demandé quatre années de recherches. On y voit que 1944, grand moment de restauration républicaine, n’a rien à envier à 1793 ! Cette restauration républicaine s’est accompagnée d’une révolution masculine, destinée à renationaliser symboliquement le corps des femmes qui ont fauté : par la tonte, ou le marquage du corps. Symboliquement, la République réaffirme sa propriété du corps féminin. C’est-à-dire le rétablissement du contrôle social des hommes, père, frère, mari, sur la sexualité des femmes, – les estimations les plus sérieuses parlent de cinquante mille femmes tondues – coupables d’avoir, avec trente ans d’avance, appliqué le slogan du MLF: « Mon corps m’appartient ». Certes, elles en ont fait profiter, avec une grande libéralité, l’armée d’occupation, mais enfin, c’est exactement ce que nous proposent les Lumières. Il y a là un sujet beaucoup plus profond auquel il faudrait consacrer une étude sérieuse : depuis que l’homme est propriétaire de sa vie et de son corps, on a assisté à une désacralisation, une destitution de la vie et du corps. De là ont découlé les génocides, l’avortement et aujourd’hui l’euthanasie.
Les relations entre les femmes et la République ont connu, il est vrai, des périodes diverses et contrastées. Mais jusqu’à cette période, elles étaient ce que je viens de décrire. C’est pour cela que, sans m’appesantir sur le sujet, je veux faire remarquer qu’en 1944, l’attribution du droit de vote aux femmes n’a été que l’arbre qui cache la forêt : au même moment, près de 100 000 femmes ont été traduites devant les Chambres civiques pour des faits de natures très diverses-mais, en gros, le seul reproche qui leur était fait, c’était d’être les épouses de gens accusés à tort ou à raison de collaboration. C’est à ce seul titre qu’elles se voyaient traduites devant les chambres civiques. Au moment même où on leur accordait le droit de vote ! Il y a là une contradiction qui n’a jamais été résolue, dont on n’a même jamais perçu la profondeur et la gravité.
La démocratie Potemkine ou le triomphe du petit nombre
Cette parenthèse fermée, est-ce que la République se montre plus inclusive aujourd’hui qu’elle ne l’a été dans le passé? On vient de voir ce qu’elle fut: suffrage censitaire, exclusion des pauvres, des ouvriers, des femmes… Le juriste allemand Carl Schmitt disait que « le mythe de la représentation du peuple supprime le peuple, comme l’individualisme supprime l’individu. » Nous y sommes. C’est exactement la situation que nous vivons. C’est ce à quoi nous assistons avec la combinaison du scrutin majoritaire et de l’explosion de l’abstention depuis une vingtaine d’années. La participation électorale ne cesse de décroître et cela aboutit à quoi ? Si l’on excepte la seule élection présidentielle, où le taux de participation reste supérieur à 80%, toutes les autres élections sont l’objet d’une désaffection croissante. Plus de 60% aux européennes, près de 60 % aux législatives. Même les municipales, qui résistent mieux, sont sujettes à ce reflux. Pour ces élections intermédiaires, ne vont voter, en réalité, que les « inclus », », les « insiders », les « bobos », les fonctionnaires, les retraités, ceux qui, à un titre ou à un autre, sont solidaires du système, soit qu’ils en profitent, soit que leur intérêt les y conduise. Autrement dit, on assiste au rétablissement de facto d’un suffrage censitaire, sans qu’il soit besoin de l’inscrire dans la loi. C’est ainsi que les choses se passent.
Rappelons les chiffres des élections présidentielle et législatives de 2017, qui sont à l’origine du phénomène Macron. Celui-ci, au premier tour, mobilise 23% des votants, soit 15% des inscrits. Avec quoi il va être élu et obtenir la majorité absolue aux élections législatives qui suivent. A la présidentielle, Mélenchon, Marine Le Pen et Dupont-Aignan représentaient 45 % des voix. Et aux législatives, les trois additionnés obtenaient 27 députés, soit 4% de la représentation nationale : 45 % des voix à la présidentielle et 4% de la représentation additionnés nationale à l’Assemblée ! (3)
Notre démocratie ne consacre plus la loi du nombre, elle consacre la loi du petit nombre. Ce n’est plus qu’un décor. Une démocratie Potemkine. Un rituel qu’utilise la classe dirigeante pour asseoir son pouvoir et lui donner une apparence légale. Notre démocratie consacre l’avènement de ce que le politologue Georges Burdeau appelait la « démocratie gouvernée », c’est-à-dire un régime fondé sur la délégation de souveraineté à une petite minorité (les minorités sont toujours petites !), à une assemblée qui n’est « représentative » que nominalement. A l’opposé de ce que pourrait être démocratie gouvernante, c’est-à-dire une démocratie qui associerait le peuple à la décision politique, par le référendum ou d’autres moyens.
Cette dénaturation de la démocratie correspond tout à fait à la définition qu’en donnait Paul Valéry : « l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde »! N’importe quel autre mode de scrutin, y compris le tirage au sort, c’est-à-dire le retour aux origines de la démocratie athénienne, permettrait de redonner au peuple le sentiment qu’il participe, ou est, pour le moins, associé au gouvernement de la Cité. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. On comprend que l’usage abusif qui est fait actuellement du mot « démocratie » aboutit à ce qu’il recouvre très exactement le contraire de ce qu’il énonce. Par une extraordinaire antiphrase, il désigne la privatisation des instruments de gouvernement par une minorité résolue à imposer sa loi au plus grand nombre, en excluant le peuple du processus de décision.
Ils ont si bien assimilé Tocqueville que, pour eux, laisser s’exprimer la volonté populaire ne peut qu’aboutir à maltraiter les minorités. Mais il y a minorités et minorités, et on sait ce que recouvre, aujourd’hui, la réalité sociologique des minorités es privilégiées.
C’est la raison pour laquelle la classe dirigeante n’obéit qu’à un seul impératif, un impératif sacré : se protéger de la volonté de la majorité en organisant le suffrage universel d’une manière qui permette de manipuler le corps électoral. Napoléon disait à Fouché : « Supprimez tous les journaux, mais, en tête du décret qui les supprimera, mettez six pages de considérations libérales sur les principes. » C’est ça, la post-démocratie. On n’affirme les principes que pour mieux les fouler aux pieds. On les proclame d’autant plus sacrés qu’on a la ferme résolution de ne pas les mettre en œuvre. Se voit ainsi aboli l’antique principe né au temps de la cité grecque qui voulait que la politique soit déterminée par l’accord de la majorité.
La majorité n’est plus une réalité arithmétique, c’est un concept politique résultant de l’application truquée et tronquée du scrutin majoritaire. Du principe majoritaire. Le poète anglais Coleridge disait que le vote est « une suspension provisoire de l’incrédulité ». C’est exactement cela. Il y a de la naïveté dans l’acte de voter : « Peut-être que ça va servir à quelque chose ? » Coleridge ajoutait : « Voter, d’une certaine manière, c’est croire au miracle ». S’il y a de moins en moins de Français pour voter, c’est bien qu’il y a de moins en moins de Français pour croire au miracle, pour croire à l’avènement d’un bon gouvernement, au seul service du bien commun.
Mais, paradoxe, la raréfaction des électeurs rejoint l’intérêt des élites dirigeantes : elles préfèrent voir le peuple rester chez lui le jour du vote, son mécontentement risquant de le pousser à « mal » voter… C’est ainsi que le slogan de mai 68 « Élections, piège à cons » est aujourd’hui la chose du monde la mieux partagée, à la fois par la France d’en bas qui sait que cela ne sert à rien, et par celle d’en haut qui ne veut pas risquer de voir remis en cause ses privilèges, ses prérogatives et la politique qu’elle entend mener.
Soutenir que la République n’a pas accouché de la démocratie, mais l’a détournée, empêchée d’éclore, ne relève nullement de la polémique. C’est un constat imposé par l’histoire
Que recouvre aujourd’hui le mot République ?
A ce stade, la question qui vient naturellement à l’esprit est : « Qu’est-ce que la République aujourd’hui ? » On vient de voir ce qu’elle été, mais qu’est-elle devenue ? Depuis la vague terroriste, il est d’usage commun, dans les médias et dans les décisions publiques, d’exalter les « valeurs de la République ». Et de présenter lesdites valeurs républicaines comme l’antithèse absolue du fanatisme islamiste, son unique antidote possible.
Comme si le promoteur du rasoir national en 1793, comme si les organisateurs de la Terreur révolutionnaire avaient obéi à des motivations radicalement différentes de celles des sectateurs de Daesh et autres adeptes de la décollation ! Comme si l’implacable machine de terrorisme d’Etat qui s’est mise en place en 1793 n’avait pas servi de matrice et de modèle à toutes les entreprises totalitaires des siècles suivants, Lénine se référant abondamment à Robespierre dans ses discours. Comme s’il avait fallu attendre l’été 2016 et l’assassinat du Père Hamel, en France, pour voir des prêtres innocents égorgés devant leur autel. Et il fallut que le sectarisme le dispute à l’ignorance à un niveau rarement atteint pour que celui qui nous a tenu lieu de Président de la République durant cinq ans, j’ai nommé François Hollande, ait osé dire, après l’égorgement de ce prêtre, dans un mélange de bassesse et de médiocrité inédit : « Attaquer une église, tuer un prêtre, c’est profaner la République ! » Dans ce cas, M. Hollande, dès les trois premières années son existence, n’a cessé de s’auto-profaner, en expulsant, déportant, guillotinant des prêtres par milliers dans l’objectif assumé, revendiqué même, d’asseoir son emprise sur les esprits.
Car tel était bien l’enjeu : créer une religion séculière. Une religion d’Etat qui réponde à ce besoin de croire qui n’est en rien une étape dans l’histoire de l’homme, mais un élément structurant de la conscience humaine. En deux siècles, on a eu droit à peu près à tout : le culte de l’Etre suprême, la théophilanthropie, Auguste Comte voulant ériger une statue de l’Humanité au maître-autel de Notre-Dame, Victor Hugo, adepte de l’occultisme, qui faisait tourner les tables pour convoquer les esprits… Chacun illustrait à sa manière et avec obstination le mot fabuleux prêté à Chesterton : « Quand on cesse de croire en Dieu, ce n’est pas pour croire en rien, c’est pour croire en n’importe quoi ! » Mais en deux cens ans, la République n’est pas parvenue à créer un appareil symbolique capable de prendre en charge le besoin d’absolu qui existe à des degrés divers en chacun de nous. L’homme est un animal religieux qui a besoin de sacré et, en deux siècles, la République n’a pas réussi à créer un sacré républicain ! On l’a vu encore à l’occasion des obsèques de Johnny Halliday en décembre 2017. Aussi déchristianisée que soit la France, au seuil de la mort, c’est l’Eglise qui conserve le monopole de l’accompagnement spirituel. Elle seule est alors apte à créer du sens. C’est la dernière instance pourvoyeuse de sens, , avec ce qu’il lui reste de liturgie, de décorum… Il n’y a que cela pour « faire sens ». Et si la modernité est une vaste tentative de destruction et d’annulation du sens, ce qu’il reste de l’Église s’inscrit en faux contre cette entreprise démiurgique.
C’est là que l’on voit ressurgir, non pas ce qu’Olivier Todd appelle le « catholicisme zombie », mais les racines chrétiennes de la France. Même si cela représente aujourd’hui quelque chose de culturellement très confus et diffus, cela existe toujours. Tandis que la République, elle, n’a rien à proposer. Il n’y a pas de sacré républicain. Alors même que la pratique religieuse s’est effondrée dans notre pays, face à la mort, l’instance pourvoyeuse de sens demeure l’Église. Il est de bon ton, dans certains milieux de pratiquer un syncrétisme prudent, en s’abritant derrière la célèbre phrase de l’historien Marc Bloch dans L’étrange défaite : « Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l’histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims; ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération ». En confidence, je ne me sens pas Français selon les critères de Marc Bloch, car je n’ai jamais vibré à la fête de la Fédération. Je partage sur ce point le sentiment de l’évêque d’Autun, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, requis pour la célébrer le 14 juillet 1790, et qui montant à l’autel accompagné de La Fayette, s’est tourné vers lui pour lui glisser : « Par pitié, ne me faites pas rire ! »
Que recouvre aujourd’hui le mot « République » ? Dans la novlangue politico-médiatique, c’est devenu un mot-abyme, un mot qui permet d’ensevelir et faire disparaître d’autres mots tels la France, la nation, la patrie, etc. Née d’un mouvement d’affirmation nationale, la République est réduite aujourd’hui à son statut d’image ne servant qu’à exprimer quelques principes très vagues et très généraux. C’est ce que le philosophe allemand Jürgen Habermas appelle le « patriotisme constitutionnel ». C’est-à-dire le patriotisme sans patrie, purgé de toute référence à l’histoire de France, de tout lien avec notre patrimoine historique, débarrassé de tout affect culturel. Cette République, leur République, n’est qu’une pure abstraction, ouverte à n’importe quoi, n’importe qui. Sa valeur suprême, c’est l’ouverture, par opposition à la nation dont la référence à la naissance contrevient à cet universalisme abstrait. Leur République, c’est une absence, ouverte uniquement à la présence de l’autre, du tout autre. Au fond, pour ces républicains-là, la France n’est plus qu’un espace juridique et administratif, se définissant simplement par les droits de l’homme, et prioritairement les droits de l’homme déraciné, de l’homme migrant.
—————-
(1) Paru en 1936, réédité par Perrin en 2019, avec une préface de Maxime Tandonnet.
(2) Albin Michel, 2 volumes, 2008-2009.
(3) En 2022, la situation évoluera, mais rappelons que le « phénomène Macron » inattendu n’a pu éclore depuis 2017 qu’à l’occasion de l’élimination-surprise – encore que savamment organisée – de François Fillon (ndlr).