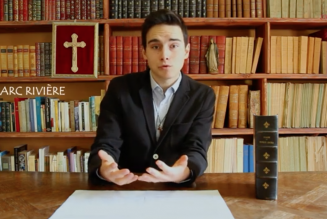Alors que le pontificat du pape François est achevé et que les cardinaux vont entrer en conclave, il est évident que la place accordée à la liturgie traditionnelle sera un dossier important pour le prochain pontife.
En 2021, l’archidiocèse de Chicago précisait la manière dont il entendait appliquer le motu proprio Traditionis Custodes : parmi différentes mesures restrictives, il interdisait les livres liturgiques traditionnels pour le Triduum pascal. Depuis des mois on apprend avec toujours plus de consternation et de tristesse les arrangements rituels mesquins imposés ici et là (arrangements acceptés malheureusement parfois ici et là…). C’est une idée véritablement saugrenue, moderne et peut-être même areligieuse de vouloir à toutes forces tout mélanger : accoler le nouveau rite d’ordination à une messe traditionnelle (Toulon et Carcassonne si l’on a bien compris), alterner les missels de dimanche en dimanche (Pontcalec), tolérer la messe mais interdire baptême, mariage, extrême-onction, confirmation (les diocèses et les cas abracadabrants ne se comptent plus), chercher à imposer la coexistence des deux missels au pèlerinage de Chartres, ou encore interdire la célébration traditionnelle de certaines fêtes (Chicago donc, avec d’autres)…
Dans le contexte de Traditionis custodes et des responsa ad dubia qui suivirent, la pression a été grande, venant de toutes parts, pour tenter de faire rentrer dans le rang les récalcitrants. L’objectif n’était pas occulte, nul complot, l’action se passait au grand jour : les livres liturgiques promulgués par Paul VI sont la seule expression du rit romain estimait feu le pape François. Législation, menaces, contraintes, chantages ont été tour à tour brandis pour nous décourager. Récemment, es qualité de président de la conférence des évêques de France[1], monseigneur de Moulins-Beaufort, dans un entretien dédaigneux et blessant faisait sentir tout sa superbe vigilance. De son côté dans une autre interview encore plus lunaire, monseigneur Jordy, es qualité de vice-président de la conférence des évêques de France[2], laissait jaillir sa profonde défiance et son absolue mésestime pour le monde traditionnel. Il n’est pas toujours évident de se sentir aimés par nos pasteurs ! Mais laissons là ces avanies, elles passeront. D’autant que tous les évêques et tous les cardinaux ne sont pas coulés au même moule, loin s’en faut et Dieu merci !
Pourquoi ne céderons-nous jamais un centimètre de terrain liturgique ? Ni baptême, ni dimanche, ni calendrier, ni lectionnaire, pas plus de mariage que d’obsèques, aucun saint, aucune rubrique, pas le moindre iota ? Et pas plus demain qu’il y a cinquante ans ?
On pourrait aborder la question sous différents biais :
- Pastoral avec Jean de Tauriers[3], « Qui osera regarder en face le désastre et en tirer les conséquences ? Les chiffres parlent pourtant d’eux-mêmes. »
- Spirituel avec Benoît XVI[4], « Ce qui a été sacré pour les générations précédentes ne peut à l’improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste. »
- Juridique avec le père Réginald-Marie Rivoire[5], « Ce qui est choquant, ce n’est pas tant que François contredise son prédécesseur, mais qu’il traite un rite liturgique multiséculaire comme s’il s’agissait d’une matière purement disciplinaire. »
- Doctrinal avec un groupe de théologiens[6], « On est fondé à craindre que, ne mettant plus en évidence le Sacrifice de Jésus, l’ordo Missæ ne le voue en fait à l’oubli ; car ce Sacrifice est une réalité trop surnaturelle pour que l’homme puisse, sans signe, s’en souvenir et en vivre. »
On pourrait. Et il faudrait ; et depuis soixante ans on l’a amplement entrepris sans presque jamais recevoir de réponse autre que celle du doigt tendu et des sourcils froncés en appui de l’injonction : obéissez !
Je voudrais aujourd’hui l’aborder sous un angle simplement rituel.
La liturgie est-elle un matériau disponible que l’on peut modeler à loisir, pétrir, transformer, retrancher, réinitialiser, raboter, découper, adapter ? A-t-elle comme premier effet de favoriser la pastorale qui elle-même se réduirait à du lien social ? N’est-elle pas plutôt la prière que le Christ rend à son Père par l’intermédiaire de l’Église ? Un culte incessant, toujours identique et toujours renouvelé car illuminé de l’intérieur par les paroles du Verbe, les prières des saints, les gestes antiques et patinés ? En ce cas il est alors évident que prendre un bout de ceci et un bout de cela (quel qu’il soit) n’a aucun sens, est littéralement insensé.
Comment peut-on espérer croître dans la vie spirituelle, comment peut-on pénétrer en profondeur les mystères, comment peut-on approfondir la contemplation des choses divines en papillonnant d’un rit à l’autre ? La vie spirituelle est trop exigeante pour cela ; accessible à tous, certes, mais exigeante. Saucissonner c’est au contraire renoncer à rendre à Dieu la perfection (humaine j’en conviens, mais si peu humaine cependant) du culte qui lui est dû, et renoncer tout autant à la puissance de la sanctification qui en jaillit naturellement et nous désaltère. Et si certains, pour se rassurer, se réjouissent que les plus jeunes passent sans difficulté d’un rit à l’autre, je voudrais leur adresser deux remarques ; premièrement pour mettre chacun en garde contre cette bougeotte qui ne permet pas le juste approfondissement spirituel qu’offre la fidélité rituelle ; je crois que l’on ne peut s’en satisfaire, ni s’en réjouir, même si l’on doit momentanément s’en accommoder. Deuxièmement, l’observation montre qu’avec le temps (le mariage, les exigences de l’éducation des enfants) vient la stabilité qui, bien souvent, est en faveur de la liturgie traditionnelle.
Il faut une vie entière pour pénétrer un rit. Les contemplatifs bénédictins qui se nourrissent de liturgie (je pense spontanément à Dom Guéranger, à Dom Delatte, à Dom de Monléon, à Dom Gérard…) nous l’ont dit, ils l’ont expérimenté de tout leur être, plusieurs heures par jour ; c’est pourquoi d’ailleurs les moines se méfient des gyrovagues. Car il en va pour un rit comme pour une règle : on ne peut être dominicain le matin et visitandine le soir, chartreux le dimanche et carmélite le restant de la semaine… La liturgie, celle qui mérite pleinement ce nom, ne se laisse pénétrer que lentement, par la répétition qui touche progressivement l’âme embuée, éclaire notre intelligence, ouvre nos yeux sur la réalité de la création et du monde dans lequel nous nous mouvons avec quelques difficultés. C’est parce qu’elle vient de loin et qu’elle est un édifice total qu’elle répond à sa double finalité : d’abord louer Dieu, ensuite nous sanctifier. La vie intérieure n’est pas une mince affaire. Elle nécessite persévérance, silence, recommencement, exploration, décantation. Par l’intériorisation et l’approfondissement de la prière liturgique on entre toujours plus dans les mystères de notre foi. La liturgie est la voie royale pour cela. C’est la voie royale parce que c’est ce qu’a voulu Dieu lui-même, et c’est une mission essentielle qu’il a confié à son Église. A force de côtoyer le rit, à condition d’être patients, humbles et persévérants, le rit nous ouvre pleinement son sens. Immolant souhaits et préférences, sans aller chercher ici et là ce qui nous satisfait immédiatement, nous rejoignons la haute et sainte et vénérable prière de l’Église qui, en un certain sens, n’est pas faite de main d’homme. Les réalités que recouvrent l’œuvre liturgique, l’opus Dei, sont si profondes, mystérieuses, terribles, qu’il faut user de tous ses trésors pour que l’âme en tire profit. Le rit et son noble cortège de rubriques nous aident à aller des choses visibles aux choses invisibles. Ainsi les vêpres répondent à la messe dans l’unité de calendrier qui les lie intimement ; les sacrements s’appuient les uns sur les autres et les sacramentaux les escortent ; les diacres qui proclament l’Évangile pour toute la création sont préalablement ordonnés pour le chanter por vis quam pro defunctis ; les évangiles du dernier et du premier dimanche de l’année liturgique se répondent et nous rappellent notre fin. La trame dense et drue de la liturgie tisse le plus inextricable et le plus extraordinaire ouvrage. Comme pour la pratique des vertus, c’est la force de la fidélité aux petites choses d’imprimer lentement une grande idée, de créer une habitude. « Bon et fidèle serviteur, parce que vous avez été fidèle en peu de chose, je vous établirai sur beaucoup d’autres : entrez dans la joie de votre Seigneur. » (Saint Matthieu.)
Écrivant cela je ne prétends pas que le nouveau rit ne possède aucune disposition au culte et à la sanctification : il en possède autant qu’il conserve de vestiges de l’ancien. De même, je ne prétends pas qu’il soit impossible de se sanctifier avec la liturgie réformée, mais par analogie avec les promesses de Notre Seigneur à ceux qui témoignent d’une dévotion à son Sacré-Cœur, je crois bien que par la fréquentation de la liturgie traditionnelle, les âmes tièdes deviendront ferventes et les âmes ferventes s’élèveront à une grande perfection.
Le pape François que nous confions à la miséricorde divine est mort, la liturgie traditionnelle est toujours là. Puisse le futur pape acter que la liturgie ne se morcelle pas.
Cyril Farret d’Astiès
[1] Il ne l’est plus depuis.
[2] Et responsable du suivi des catholiques de tradition.
[3] https://www.lesalonbeige.fr/atheisme-catholique/
[4] Motu proprio Summorum pontificum.
[5] Sedes Sapientiae n°171, mars 2025, La rationalité des normes canoniques.
[6] La pensée Catholique n°122, 1969.