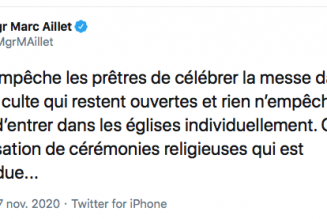A la veille du pèlerinage de Paris à Chartres, l’association Notre-Dame de Chrétienté a publié un long manifeste “Pour la Vérité, la Justice et la Paix” pour répondre aux polémiques diffusées par certains médias et prélats. Nous avions cité quelques extraits de ce long texte de 6 pages. A l’occasion des congés, nous vous proposons de le lire en intégralité, à tête reposée, en plusieurs parties. 2e partie :
« Vous ne pouvez pas être dans la communion de l’Église, si vous n’adoptez pas le Novus Ordo, partiellement ou totalement. Dura lex, sed lex. Rentrez dans le rang : l’Église a parlé, obéissez. » Mais nous avons souvenir, quant à nous, d’une autre parole, certaine, de l’Église, qui plus est une promesse, dans laquelle notre famille spirituelle a mis toute sa confiance. En 1988, alors que Mgr Lefebvre sacrait quatre évêques contre l’avis de Rome, les laïcs organisateurs du pèlerinage de Chrétienté ont pris la décision profondément douloureuse de s’écarter de cette voie pour rester unis de façon visible au Saint-Siège. C’est au nom de l’unité de l’Église, qu’on nous accuse aujourd’hui de mettre à mal, que ces laïcs et ces prêtres, profondément attachés aux pédagogies traditionnelles de la foi, se sont tournés vers le saint pape Jean-Paul II. Ce jour-là, le Saint Père leur a dit que leur attachement était « légitime » ; il a évoqué la beauté et la richesse de ce trésor de l’Église ; et pour faire honneur à cette démarche filiale, il a fait la promesse de garantir et de protéger, de manière large et généreuse, les aspirations des fidèles attachés aux formes liturgiques et disciplinaires antérieures de la tradition latine, sans aucune contrepartie d’ordre liturgique, sinon de reconnaître le Concile Vatican II et la validité du Novus ordo. L’Église catholique, prenant en considération les personnes, et leur histoire, nous a dit que nous sommes en communion avec l’Église en faisant le choix de la liturgie tridentine comme chemin véritable de sanctification. Nous ne pouvons douter de cette parole, dont la valeur demeure car elle dépasse les douloureuses contingences historiques de 1988.
Aujourd’hui encore, malgré les vexations multiples, notre famille spirituelle conserve une paisible espérance dans cette parole de l’Église, de qui elle a appris qu’en justice naturelle, pacta sunt servanda (la parole donnée doit être tenue). On nous dit que nous avons rompu le pacte, en durcissant nos positions, en refusant les mains tendues. Mais depuis 1988, nous n’avons rien changé de ce délicat équilibre entre fidélité envers le Siège de Pierre et attachement aux pédagogies traditionnelles de la Foi.
On a peu approfondi en quoi consistait cet « attachement » aux pédagogies traditionnelles de la foi. Certains le minimisent, le réduisant à une sensibilité, à une catégorie politique, à une nostalgie craintive ou une peur de la modernité qui passera avec le temps et la génération suivante. D’autres l’exagèrent, nous reprochant de faire de la liturgie une fin en soi, ou de l’instrumentaliser telle une arme au service d’un combat. Nous savons bien pourtant, nous pèlerins, que la fin c’est le Ciel, qu’il ne faut pas confondre le but d’avec la route qui y conduit, et qu’il y a plusieurs chemins qui mènent au Sanctuaire de tout repos. Mais nous croyons en l’importance des médiations dans l’ordre du Salut, en la valeur intrinsèque de celles-ci. Nous croyons en la liberté des enfants de Dieu pour user, selon leurs besoins et leur prudence, des richesses que l’Église leur propose depuis 2000 ans. Or, pour notre famille spirituelle, la liturgie traditionnelle est purement et simplement le milieu surnaturel de notre rencontre avec le Christ. Ses mots, ses sacrements, sa messe, ses offices, sa catéchèse ont été pour beaucoup d’entre nous la matière première de notre foi, le vecteur de la grâce, l’expression instinctive de notre relation à Dieu : en un mot, notre langue maternelle pour parler au Seigneur, mais aussi pour l’entendre. Pour d’autres, ces harmoniques ont été la cause, seconde mais providentielle, d’une conversion, ou d’un renouvellement radical de la foi. Pour beaucoup de prêtres, cette liturgie est devenue “viscérale”, au sens biblique, pénétrant de façon totalisante chaque fibre de leur être sacerdotal. Il n’est pas question-là de vague sentimentalité esthétique, mais de vie, de respiration, d’expression incarnée de la foi. Qui croit que le christianisme est une religion de l’Incarnation comprend que ces médiations ne sont nullement accidentelles, accessoires ou interchangeables à coup de décrets et d’interdits. […]