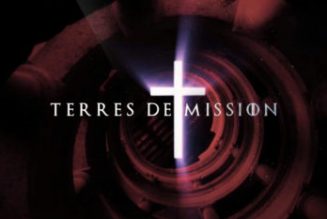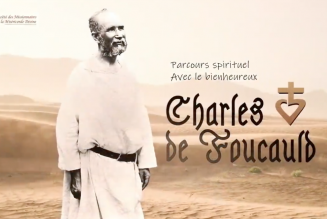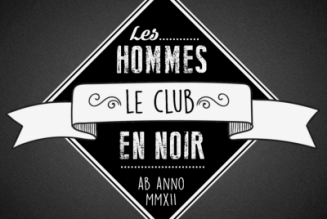1. Le caractère cultuel des lectures
Les lectures de la Sainte Écriture dans le cadre liturgique ont évidemment une fonction d’enseignement, mais celle-ci n’est pas exclusive d’une fonction cultuelle. En tant qu’elles font partie de la messe, les lectures sont elles-mêmes ordonnées aux fins de la messe. En cela, la lecture liturgique de la Sainte Écriture se distingue des lectures qui peuvent être faites dans un autre cadre, comme celui de l’étude ou de la prière personnelle.
Lors de l’ordination des sous-diacres, auxquels il revient de chanter l’épître à la messe solennelle, l’évêque décrit en ces termes leur fonction :
« Si ítaque humána fragilitáte contíngat in áliquo fidéles maculári, præbénda est a vobis aqua cœléstis doctrínæ, qua purificáti, ad ornaméntum altáris, et cultum divíni sacrificii rédeant.
Que l’on peut traduire par :
« Si donc, à cause de la fragilité humaine, il arrivait que les fidèles soient souillés par quelque faute, c’est à vous qu’il reviendra de donner l’eau de la céleste doctrine, par laquelle ils seront purifiés pour orner l’autel et retourner au culte du divin sacrifice. »[1]
C’est ce qui explique que la lecture liturgique ne peut s’en tenir à une « déclamation prosaïque, visant seulement à être comprise pratiquement »[2]. La récitation est stylisée grâce au chant et à la langue. Ainsi :
Le lecteur [n’introduit pas] dans le texte sacré ses propres sentiments ; c’est avec une stricte objectivité, qu’il le [présente], comme sur un plateau en or : c’est la parole de l’Écriture qu’il récite.[3]
2. Contenu de la lecture
La lecture qui suit immédiatement la collecte est généralement appelée par commodité « épître », car il s’agit souvent d’un passage d’une épître du Nouveau Testament, mais ce n’est pas toujours le cas. Le texte de la lecture peut aussi bien provenir d’autres livres du Nouveau Testament – tels les Actes des Apôtres (par exemple, pour la fête des saints Pierre et Paul) ou l’Apocalypse (par exemple, pour la fête de la Toussaint) – ou encore de l’Ancien Testament (c’est en particulier le cas pendant le Carême).
Notons à ce sujet que l’Ancien Testament lui-même, quand il figure dans les lectures de l’avant-messe, ne s’y lit pas pour lui-même ou comme un texte sacré quelconque, mais y prend place en raison de son contenu prophétique et dans l’éclairage du Nouveau Testament. »[4]
3. Le lecteur
La lecture liturgique des Saintes Écritures est une fonction sacrée, à laquelle il faut être député par une ordination.
À la messe solennelle, c’est au sous-diacre qu’il revient de chanter l’épître. Il en est ainsi à Rome depuis le VIIIe siècle et cet usage s’est généralisé au IXe siècle. Au jour de son ordination, le sous-diacre se voit remettre le livre des épîtres par l’évêque qui lui dit :
Recevez le livre des épîtres, et ayez le pouvoir de les lire dans la sainte Église de Dieu, tant pour les vivants, que pour les défunts.[5]
Auparavant, c’était un lecteur, c’est-à-dire un clerc ayant reçu l’ordre mineur du lectorat, le plus ancien des ordres mineurs, remontant au IIe siècle[6]. Le fait de confier la récitation des lectures à un clerc distinct de l’officiant « introduit un élément dramatique dans le culte : la parole qui vient de Dieu doit être proclamée par un autre que celui qui prononce la parole qui monte de l’Église vers Dieu »[7].
Lorsque le prêtre n’est pas assisté du diacre et du sous-diacre, l’épître peut encore être chantée par un lecteur[8], mais comme cela se présente rarement, c’est généralement le prêtre lui-même qui lit ou chante l’épître. Il pose alors les mains sur le missel pour imiter en quelque manière la position du sous-diacre qui tient le livre dans ses mains.
4. Lieu et orientation de la lecture
Pour chanter l’épître, le sous-diacre se tient à droite et se tourne vers l’autel c’est-à-dire vers l’est. Nous verrons que le diacre, lui, chantera l’évangile à gauche, tourné vers le nord. Ces positions et orientations spécifiques – que le prêtre reproduit l’ailleurs à sa manière lorsqu’il doit lui-même lire ou chanter l’épître et l’évangile à l’autel – contribuent puissamment à cette dramatisation de la liturgie que nous évoquions à l’instant. Il y a ainsi :
– le « côté de l’épître », c’est-à-dire le côté droit de l’autel et du chœur, où se déroule l’essentiel du début de la messe (introït, collecte, épître, chants intercalaires) et où le prêtre reviendra pour la fin de la messe (antienne de communion, postcommunion) ;
– le « côté de l’évangile », c’est-à-dire le côté gauche de l’autel, où se proclame l’évangile de la messe, ainsi que le dernier évangile ;
– le centre de l’autel où se déroule essentiellement le cœur de l’action sacrée, de l’offertoire à la communion.
Il n’est pas facile d’expliquer la fixation du lieu des lectures et de l’orientation des ministres. Toutefois, il semble bien que la valeur allégorique qui leur fut conférée joua un rôle important dans la perpétuation de l’usage actuel.
Ainsi, s’agissant de l’épître, nous avons déjà mentionné le fait que le sud (le côté droit quand on regarde l’autel qui est à l’est) est référé à Israël ou aux Apôtres qui en venaient. Il était donc cohérent que l’on chante de ce côté l’épître dont le texte est précisément d’un des prophètes d’Israël ou d’un Apôtre.
Quant à son orientation, le sous-diacre regarde l’autel qui représente le Christ, car il tient symboliquement la place de saint Jean-Baptiste, dont la prédication dirigeait lui-même et les autres vers le Christ, à partir des Écritures[9].
5. Bénédiction du sous-diacre après l’épître
Après la lecture de l’épître, le sous-diacre apporte le livre au célébrant, lui baise la main et reçoit de lui une bénédiction. Dans la ligne de l’application allégorique de l’épître à la prédication des prophètes ou de saint Jean-Baptiste, cette cérémonie symbolise l’accomplissement de l’Ancienne Alliance par le Christ, que représente le célébrant[10].
6. Deo Gratias
L’épître ayant été chantée ou lue, le servant répond : « Deo gratias » :
… après une proclamation adressée à tous, comme après la présentation de la parole de Dieu, il ne faut pas laisser l’impression que les mots aient retenti dans le vide. Ils ont été entendus, et l’écho qui les répercute est celui par lequel le chrétien répond à toutes les interpellations de la vie : Dieu soit remercié.[11]
7. Chants intercalaires
Dans le cours sévère de l’action liturgique, il s’introduit en cet endroit, un moment de pause, où l’on reprend haleine, avant l’entrée triomphale de la parole de Dieu dans l’évangile[12].
Après l’épître et avant l’évangile prennent place en effet les chants intercalaires. Ils sont ordinairement au nombre de deux : le graduel et l’alleluia. En temps de pénitence l’alleluia est remplacé par un trait, voire tout simplement omis. Durant le temps pascal, en revanche, c’est le graduel qui est remplacé par un premier alleluia. Enfin, à certaines occasions, l’alleluia est lui-même suivi d’une séquence.
Le nombre habituel de deux chants intercalaires s’explique par le fait qu’il y avait dans les premiers temps de l’Église trois lectures : une de l’Ancien Testament, une des épîtres, puis l’évangile. On intercalait donc deux chants entre ces trois lectures.
Une structure semblable demeure encore certains mercredis de l’année – les mercredis des Quatre-Temps, le mercredi de la 4e semaine de Carême, le mercredi de la Semaine Sainte[13] – mais, ainsi que nous l’avons expliqué, il n’y a ordinairement qu’une lecture avant l’évangile, tirée soit de l’Ancien Testament, soit du Nouveau. Les deux chants intercalaires se trouvent donc accolés et placés entre l’épître et l’évangile.
Les textes pour l’alléluia et le graduel sont presque toujours tirés des psaumes.
Graduel
Le graduel, composé d’un répons et d’un verset, constitue la partie la plus musicale de l’office. Il tire son nom du fait qu’il était chanté par les chantres depuis l’ambon, sorte de tribune de laquelle était proclamé l’évangile. Le sommet de l’ambon étant réservé au diacre pour la lecture de l’évangile, les chantres se plaçaient sur les marches – ou degrés – pour chanter ce que l’on a alors appelé le graduel[14]. Ce nom nous rappelle également les psaumes dits « graduels » des israélites, qui se chantaient en gravissant les marches qui menaient au temple[15] à l’occasion des fêtes de pèlerinage.
Alléluia
Le mot alléluia nous vient de l’hébreu. C’est un cri d’allégresse, que l’on peut traduire par « louez le Seigneur », que l’on trouve par exemple dans les descriptions de la liturgie céleste au livre de l’Apocalypse[16]. Il semble que son emploi à la messe trouve son origine dans la recherche d’un répons connu par tous afin d’encadrer le verset de psaume que l’on chante avant l’évangile. Il a alors pris l’aspect d’un prélude à l’évangile[17].
Le charme de l’alléluia, est dans le jubilus, jubilation ou encore cantilena suivies de neumes, groupe de notes détachées qui le prolongent comme une explosion de joie et que la parole ne pourrait rendre. »[18]
Trait
Aux temps de pénitence[19], l’allégresse n’étant pas de mise, l’alléluia est soit omis, soit remplacé par un trait, composé de plusieurs versets de psaume :
Au point de vue musical, le trait se caractérise par une mélodie moins riche. C’est de là aussi que semble venir le nom tractus = εἱρμός [eirmos : lien, enchaînement], mélodie caractéristique répétée au cours d’un chant selon des règles fixes.[20]
Séquence
Enfin, en de rares occasions, les chants intercalaires sont suivis d’une séquence (ou prose). Autrefois très nombreuses, leur nombre a été réduit à cinq dans le missel romain. Il s’agit du Victimae paschali laudes de Pâques, du Veni Sancte Spiritus de la Pentecôte, du Lauda Sion de la Fête-Dieu, du Stabat Mater de la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, et du Dies Irae pour les messes des morts[21]. Il s’agit de compositions poétiques, dont les auteurs sont parfois connus, tel saint Thomas pour le Lauda Sion.