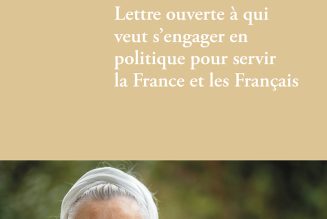À la grand-messe, après être parvenu à l’autel et l’avoir vénéré par un baiser, le prêtre l’encense. Il semble que, durant les premiers siècles de l’Église, l’encens ne fut pas ou peu utilisé, peut-être pour se démarquer des liturgies païennes qui en faisaient un important usage. L’encens cependant était utilisé dans les cérémonies de l’Ancien Testament et trouvera finalement sa place dans la liturgie chrétienne.
Ce rite est particulièrement expressif et d’un symbolisme très riche.
Prière
Les nuages parfumés qui s’élèvent étaient déjà, [dans les psaumes], l’image de la prière montant vers Dieu[1] ; de même, [dans] l’Apocalypse, les parfums dans les coupes d’or des vieillards représentent les prières des saints[2]. Ainsi, la fumée de l’encens devient un “nuage sacré”[3], qui symbolise la communauté en prière, élevant son cœur et prenant son essor vers Dieu ; […].
Purification rituelle
en même temps l’encens devient lui-même un objet sacré, porteur de bénédiction divine, une fois surtout qu’il a été béni par l’Église.[4]
En l’occurrence, l’encensement de l’autel au début de la messe, comme à l’offertoire, a la valeur d’une purification rituelle :
le lieu de l’action sainte et l’officiant lui-même doivent être […] particulièrement mis à part du monde souillé par le péché et enveloppés dans l’atmosphère du sacré.[5]
L’Ancien Testament nous livre l’exemple d’un rite analogue, où notre encensement trouve peut-être son origine :
[Aaron] remplira alors un encensoir avec des charbons ardents pris sur l’autel, de devant Yahvé, et il prendra deux pleines poignées d’encens fin aromatique. Il portera le tout derrière le rideau, et déposera l’encens sur le feu devant Yahvé ; un nuage d’encens recouvrira le propitiatoire qui est sur le Témoignage, et Aaron ne mourra pas.[6]
Sacrifice
L’encens est enfin une expression particulièrement puissante du sacrifice. En grec le mot thus, qui signifie « encens », et le verbe thuein, qui signifie « sacrifier », ont la même racine. L’encens est le symbole par excellence du sacrifice. En effet, le grain d’encens est brulé, détruit, anéantit par le feu, et la fumée s’élève en agréable odeur, diffusant l’être profond de ce grain, son âme en quelque sorte, à travers sa destruction, signifiant ainsi tout à la fois le sacrifice intérieur de l’âme se donnant totalement à son Dieu et le sacrifice extérieur d’holocauste.
Encensement du prêtre
En tant que représentant de Notre-Seigneur, le prêtre est lui-même encensé de trois coups doubles, c’est-à-dire autant que la croix de l’autel, l’évangéliaire, ou même le Saint-Sacrement. Ce sera à nouveau le cas au moment de l’encensement de l’offertoire.
L’introït
Après avoir été encensé par le diacre, le prêtre lit au missel l’introït, c’est-à-dire l’« entrée ». Ce chant était originellement chanté pendant la procession de la sacristie jusqu’au sanctuaire. Avec le développement des prières au bas de l’autel, l’introït est désormais chanté par la chorale pendant que le prêtre et ses assistants récitent ces prières. Quant au prêtre, il le lit logiquement après les prières au bas de l’autel. Le signe de croix qu’il trace alors sur lui-même rappelle ce caractère de rite initial de l’introït[7].
L’ordinaire et le propre
L’introït fait partie de ce que l’on appelle le « propre », que l’on distingue de l’« ordinaire ». On peut en effet classer les textes de la messe en deux catégories :
– les uns, qui sont les plus nombreux, reviennent à chaque messe : ils constituent l’« ordinaire » de la messe ;
– les autres sont variables, ils sont propres à la messe célébrée ce jour-là : ils constituent le « propre » de la messe.
Le propre de la messe comporte : l’introït, la collecte, l’épître, le graduel et l’alléluia ou le trait, l’évangile, l’antienne d’offertoire, la secrète, l’antienne de communion et la postcommunion.
Puisque l’introït est le premier de ces textes variables, il donne généralement son nom à la messe : son ou ses premiers mots servent à désigner la messe et parfois aussi le jour. Ainsi, nous parlons du dimanche de Laetare pour le quatrième dimanche de Carême, car l’introït commence par ces mots : Laetare Jerusalem… « Réjouis-toi Jérusalem… ». De même, la messe Rorate (messe de Bienheureuse Vierge Marie pendant l’Avent) tire son nom de l’introït : Rorate caeli desuper… « Cieux, répandez d’en haut votre rosée… » C’est encore le premier mot de l’introït de la messe des défunts qui lui donne son nom : Requiem aeternam dona eis Domine… « Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel… »
L’introït livre généralement en quelques mots l’idée fondamentale qui gouverne le thème de la messe du jour.
Structure de l’introït
L’introït est composé d’une antienne, d’un verset de psaume, de la petite doxologie et de la répétition de l’antienne. Voyons par exemple l’introït de la messe Rorate :
| Antienne
(Is 45, 8) |
Roráte, cæli, désuper, et nubes pluant iustum : aperiátur terra, et gérminet Salvatórem. | Cieux, répandez d’en haut votre rosée, et que les nuées fassent pleuvoir le juste : que la terre s’ouvre et germe le Sauveur. |
| Psaume
(Ps 84, 2) |
Benedixísti, Domine, terram tuam : avertísti captivitátem Iacob. | Vous avez béni, Seigneur, votre terre ; vous avez délivré Jacob de la captivité. |
| Petite doxologie | Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen. | Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, et maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. |
| Antienne
(Is 45, 8) |
Roráte, cæli, désuper, et nubes pluant iustum : aperiátur terra, et gérminet Salvatórem. | Cieux, répandez d’en haut votre rosée, et que les nuées fassent pleuvoir le juste : que la terre s’ouvre et germe le Sauveur. |
Antienne
L’antienne est habituellement tirée des psaumes, ou d’un autre livre de l’Écriture Sainte, mais ce n’est pas une règle absolue.
Avec autant de simplicité que de maîtrise, l’antienne de l’introït de beaucoup de fêtes indique donc le motif qui doit dominer toute [la messe].[8]
Ainsi, pour la messe de la Bienheureuse Vierge Marie au temps de l’Avent, l’antienne est un verset du livre d’Isaïe qui exprime l’attente du Sauveur.
Certains jours cependant, comme les dimanches après la Pentecôte, ne sont pas ou moins caractérisés par un thème particulier que l’antienne d’introït aurait à introduire. Il semble que l’antienne ait tout simplement été déterminée en suivant le psautier. Quoiqu’il en soit,
l’ordre est resté ce qu’il était il y a mille ans. […] ce qui a dirigé le choix des psaumes et des versets n’était pas le désir de s’en tenir rigoureusement à un thème déterminé […]. On flâne plutôt à travers le pré fleuri du Psautier, cueillant, çà et là une fleur parfumée, un verset expressif qui puisse jaillir du cœur d’une communauté en prière. »[9]
Verset de psaume
Le psaume est aujourd’hui réduit à un verset : c’est un reste du psaume qui accompagnait la procession. Ainsi, pour la messe de la Bienheureuse Vierge Marie au temps de l’Avent, le premier verset du psaume 84, qui évoque la délivrance à venir : « vous avez béni, Seigneur, votre terre, vous avez délivré Jacob de sa captivité » (Ps 84, 2).
Petite doxologie
Le Gloria Patri forme quant à lui la conclusion du psaume. La première partie – Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto[10] – est d’origine orientale (Antioche, IVe s.) et nous renvoie aux temps de la lutte contre l’arianisme.
Les ariens [qui niaient la divinité du Fils] utilisaient comme cri de guerre et comme mot de passe la formule, en soi irréprochable mais susceptible d’interprétation fausses : Gloria Patri per Filium in Sancto Spiritu, parce qu’ils y voyaient exprimée une subordination du Fils au Père, qu’ils défendaient.
Dans le camp catholique, les dirigeants […] y opposèrent l’autre formule : Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, […] qui se rattache à la formule baptismale de Mt 28, 19 et exprime sans équivoque l’égalité de nature des trois personnes divines.
Ainsi, dans la bouche du nouveau peuple de Dieu, chaque psaume [de l’AT, donc] devait aboutir à une louange du Dieu Trinité [révélé dans le NT].[11]
La réponse – Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum[12] – qui est d’origine occidentale, a également joué un rôle dans la lutte l’arianisme.
Au synode de Vaison (529), qui la mentionne pour la première fois, elle est dirigée contre les hérétiques qui nient l’éternité du Fils, c’est-à-dire toujours les Ariens. C’est donc, avant tout, le erat in principio que l’on voulait mettre en relief, et cela à propos du Fils (et du Saint-Esprit). […] nous rendons au Dieu Trinité la gloire qui lui revient depuis l’origine du monde et lui reviendra toujours.[13]
Aux messes de Requiem et du temps de la Passion, le Gloria Patri est omis, probablement parce que ces messes ont gardé sur ce point comme sur certains autres une forme plus antique, antérieure à l’ajout de la petite doxologie, motivé par la lutte contre l’arianisme. Quoi qu’il en soit, ce détail accentue l’atmosphère de deuil, qui convient à ces messes[14].
Position du prêtre
Remarquons enfin que le prêtre lit l’introït du côté de l’épître, c’est-à-dire du côté droit en regardant l’autel.
Selon Yves de Chartres, le prêtre se tient à droite pour le chant de l’introït […] et l’oraison, et cela parce qu’il représente le Christ qui, selon Mt 15, 24[15], ne doit d’abord rechercher que les brebis perdues de la maison d’Israël, représentée par le côté droit.[16]
En effet, les points cardinaux structurent l’espace liturgique. Ainsi l’orient est référé au Christ, tandis que l’occident est référé au diable. Le sud (le côté droit de l’autel donc, ou côté de l’épître) est référé à Israël, ou aux Apôtres qui en venaient, tandis que le nord (le côté gauche de l’autel donc, ou côté de l’évangile) est référé aux païens. Nous aurons l’occasion d’y revenir.