Nous avons interrogé Philippe d’Iribarne, sociologue et directeur de recherches au CNRS, à propos de son dernier ouvrage: Au-delà des fractures chrétiennes.
L’Eglise contemporaine semble extrêmement fracturée. Est-ce une nouveauté ou bien l’Eglise a-t-elle toujours été divisée?
Effectivement, au cours de l’Histoire, l’Eglise s’est souvent divisée avec des conséquences souvent dramatiques. Pensons à la crise arienne, au grand schisme entre l’Orient et l’Occident, à l’apparition du protestantisme, aux guerres de religion, à l’hérésie cathare, à la crise janséniste, à l’opposition, en France, entre prêtres jureurs, acceptant la Constitution civile du clergé, et prêtres réfractaires, à la crise moderniste, à la condamnation de l’Action française. Chaque fois, on voit émerger un courant qui se dit porteur d’un christianisme plus authentique, plus pur, débarrassé des tares de l’institution. Des causes temporelles peuvent être en cause, ou l’attachement à des cultures conduisant à des interprétations différentes de l’enseignement du Christ et des visions différentes de celui-ci. Ces divisions sont plus ou moins pérennes. On en voit disparaître avec le temps, du fait qu’un des camps en présence à été éradiqué, comme pour les cathares, ou que le sujet d’opposition a disparu, comme pour la Constitution civile du clergé, ou encore que les tenants de camps opposés se sont engagés dans une démarche de réconciliation, comme entre calvinistes et luthériens. Mais d’autres divisions réapparaissent.
De nos jours, la fracture dominante est liée à l’émergence d’un nouveau christianisme dont le cœur est la référence à un accueil inconditionnel de l’autre, qu’il soit immigré, homosexuel, fidèle d’une autre religion ou délinquant. Ce christianisme est en phase avec l’idéologie postmoderne qui défend une société « inclusive » reconnaissant l’égale valeur de toutes les cultures, de toutes les religions, de tous les choix de vie et affirme que tout le mal du monde vient de « dominants », hommes, blancs, hétérosexuels, coupables d’être racistes, sexistes, homophobes, islamophobes, etc., les « dominés » étant vus de leur côté de pures victimes. Une partie des chrétiens, dits « progressistes », se sont ralliés à cette vision. D’autres, au contraire, dits « traditionalistes », la refusent. Ils défendent une « civilisation chrétienne » menacée par la constitution d’une société « permissive »qui rejette la dimension exigente des enseignements du Christ, et dénoncent la tendance à brader ce qui est propre au christianisme, dont le caractère central de la Croix, au nom du « dialogue » entre religions. C’est avec cette fracture que nous avons à vivre de nos jours.
Sur quelles bases pensez-vous que l’unité pourrait se (re)faire?
Pour retrouver une certaine unité, il serait fondamental de mieux distinguer ce qui relève du cœur de la foi au Christ de ce qui dérive d’un attachement à une culture particulière conduisant à adopter son cadre de pensée, ou encore de l’engagement dans une causes temporelle qui conduit à retenir, dans les enseignements du Christ, ce qui est favorable à cette cause. Il serait bon de prendre exemple sur ce qu’a fait l’Eglise primitive quand elle a dû faire coexister les chrétiens issus du monde juif à ceux étaient issus du monde grec. Les premiers entendaient imposer aux seconds les prescriptions de la Loi juive, dont la circoncision, pendant que ceux-ci refusaient de s’y soumettre (Ac 15, 2). La tension a été vive (Ac 15, 7).
Le conflit a été surmonté grâce à une distinction entre deux plans. C’est dans l’ordre de la foi que tous sont semblables, et dans celui de la charité qu’ils se retrouvent : « Or voici qu’à présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches, grâce au sang du Christ. Car c’est lui qui est notre paix, lui qui des deux n’a fait qu’un peuple, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine » (Ep 2,13-14). Dans cet ordre, « il n’est plus question de Grec ou de Juif, de circoncision ou d’incirconcision, de Barbare, de Scythe, d’esclave, d’homme libre : il n’y a que le Christ qui est tout et en tout » (Col 3, 11). Mais, simultanément, on a affaire à deux mondes qui n’ont pas à chercher à imposer l’un à l’autre leurs coutumes et leurs modes d’expression de la foi. L’attachement à l’Esprit plutôt qu’à la lettre a permis de raccorder ces deux ordres : « En effet ce n’est pas ce qui se voit qui fait le Juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais ce qui est caché qui fait le Juif, et la circoncision est celle du cœur, celle qui relève de l’Esprit et non de la lettre » (Rm 2, 28-29). Dès lors, affirme Paul, « L’un était-il circoncis quand il a été appelé ? Qu’il ne dissimule pas sa circoncision. L’autre était-il incirconcis ? Qu’il ne se fasse pas circoncire » (1 Co 7, 18).
Toute incarnation du christianisme dans une communauté ecclésiale conduit à rencontrer la forme d’ordre temporel qui fait référence dans le monde auquel celle-ci se rattache. Déjà, dans l’antiquité, la christianisation du monde grec a produit un christianisme hellénisé et celle du monde romain un christianisme romanisé, ne serait-ce que du fait des différences entre le grec et le latin. On trouve déjà cette attention à ce phénomène chez nombre de théologiens médiévaux à propos des différences d’expression entre « savants et sages, l’un Grec et l’autre Latin »[1]. De nos jours, des efforts sont faits par les confessions chrétiennes pour que les divergences de formulation ne constituent pas un obstacle insurmontable à un rapprochement œcuménique[2]. Ainsi, ayant en vue les chrétiens orientaux, le concile Vatican II a affirmé, dans le décret sur l’œcuménisme, que « ce qui a été dit de la légitime diversité en matière de culte et de liturgie doit s’appliquer aussi à la formulation théologique » (17). On trouve une telle évolution « en Orient, dans la révision actuelle, faite en commun avec les Eglises non-chalcédoniennes, des formulations christologiques sur lesquelles nous nous étions séparées au concile de Chalcédoine »[3].
Un point frappant dans les divisions que nous observons est la capacité de chacun des courants qui s’opposent à opérer une sélection au sein de l’Ecriture, en conservant ce qui s’accorde avec la vision temporelle qu’il défend et en passant sous silence (pour ne pas dire censurant) ce qui conduit à la questionner. Ceci est frappant, par exemple, dans la manière dont le courant « progressiste » se sert de l’Ecriture pour étayer l’exigence d’un accueil inconditionnel de l’étranger. Certains passages de l’Evangile sont invoqués : la parabole du Bon Samaritain (Lc 10, 25-37), l’évocation du jugement dernier « j’étais étranger et vous m’avez accueilli » (Mt, 25 35-40). Mais les passages de l’Ecriture qui invitent à faire preuve de discernement à l’égard des étrangers sont ignorés[4]. Les textes de la Bible hébraïque qui évoquent l’étranger en difficulté, lequel mérite la même sollicitude que la veuve et l’orphelin, sont mis en avant : « Si un étranger réside avec vous dans votre pays, vous ne le molesterez pas. L’étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote et tu l’aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers au pays d’Égypte » (Lv 19, 33-34). Par contre les passages qui portent sur les membres d’un peuple qui veut imposer sa loi et dont il faut se protéger, sont ignorés : « Sauve-moi du gouffre des eaux, de l’emprise d’un peuple étranger » (Ps 143, 7) ; « notre héritage a passé à des inconnus, nos maisons à des étrangers » (Lamentations 5,2) ; « Mais si tu n’obéis pas à la voix de Yahvé ton Dieu, ne gardant pas ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd’hui, toutes les malédictions que voici t’adviendront et t’atteindront. […] L’étranger qui est chez toi s’élèvera à tes dépens de plus en plus haut, et toi tu descendras de plus en plus bas. C’est lui qui fera de toi sa chose, et non toi de lui ; c’est lui qui sera à la tête, et toi à la queue. » (Dt 28, 15 ; 43-44). Réciproquement, le courant « traditionnaliste », dans sa défense d’une « civilisation chrétienne » face à une submersion migratoire tend à faire peu de cas des passages invitant à l’accueil. Une lecture partagée de l’Ecriture qui fasse toute sa place aux passages paraisant antagonistes serait de nature à favoriser un rapprochement.
Un point fondamental est sans doute que les représentants de chaque courant admettent qu’ils n’ont pas construit un super-christianisme de purs, indemne des limitations que l’on constate dans les courants concurrents, mais que tous sont marqués par l’imperfection humaine.
Ces divisions idéologiques conduisent souvent les observateurs à s’intéresser prioritairement aux “extrêmes”. Comment décririez-vous, au contraire, le “fidèle moyen”?
S’il n’est pas trop difficile de caractériser des « extrêmes », chez qui l’on trouve des visions claires de ce que c’est que d’être chrétien, et qui s’expriment de manière assurée et souvent véhémente, cela est beaucoup plus difficile pour les fidèles que l’on pourrait qualifier de « moyens ». Parmi ceux-ci, on trouve de multiples tendances. Certains ont des conceptions proches de celles des « progressistes » d’un côté ou des « traditionalistes » de l’autre, mais dans une version dépourvue de passion et parfois de cohérence. Ainsi ils peuvent affirmer, comme la moitié des catholiques pratiquants, que toutes les religions se valent, mais rester en fait très attachés à la valeur unique du christianisme. Ou encore, ils peuvent affirmer que la réforme liturgique qui a suivi Vatican II a été une catastrophe, tout en s’accommodant en fait de la forme de messe à laquelle elle a conduite. On voit aussi des catholiques engagés dans les courants charismatiques, d’autres très actifs dans des organisations caritatives, sans affirmer pour autant que l’action de celles-ci constitue l’alpha et l’oméga de l’expression de la foi chrétienne. D’autres encore vont à la messe de façon plus ou moins discontinue, font baptiser leurs enfants et les envoient au catéchisme, mais n’ont qu’une idée confuse de ce que signifie être chrétien. Ils ont souvent du mal à transmettre.
On peut comprendre, dans cette situation de flou, le faible engagement de la majorité des catholiques dans leur foi. Peu d’entre eux déclarent avoir une « forte religiosité » ‒ seulement 9% en 2008 contre 49% pour les musulmans, 43% pour les juifs, 29% pour les protestants[5]. Depuis l’écart s’est encore creusé[6]. Juifs et musulmans sont beaucoup plus confiants que les catholiques dans la valeur de leur religion. Ainsi, d’après un sondage de 2023, 75% des Français musulmans estiment qu’« il y a une seule vraie religion », alors que ce n’est le cas que de 20% en moyenne chez les « adeptes des autres religions », de fait essentiellement catholiques sans qu’on ait des chiffres plus détaillés par religion. De même 66% des Français musulmans se disent « croyants et religieux », alors que ce n’est le cas que de 18% en moyenne « dans les autres religions », 65% de ceux qui s’en réclament se déclarant « croyants mais non religieux »[7].
Pour sortir de cette situation piteuse, le monde chrétien a un obstacle majeur à surmonter. Autant, au cours de son histoire, il a produit des trésors en matière de spiritualité autant il n’a fait que balbutier en ce qui concerne les rapports entre la foi et la vie de la cité, sujet majeur dans les fractures actuelles. Il est vrai que la parole du Christ « rendez-à César ce qui est à César » et son refus d’être roi, n’aident pas à voir clairement ce que doivent être ces rapports. Du coup l’Eglise tente, aux diverses périodes de l’Histoire, de christianiser des ordres temporels successifs. Elle l’a fait avec un ordre chevaleresque, un ordre bourgeois, tente de le faire maintenant avec un ordre postmoderne, en étant à chaque étape plus ou moins happée par l’ordre qu’elle s’emploie à transformer. Comme l’attachement à des ordres anciens ne disparaît pas quand de nouveaux apparaissent, une fracturation du monde chrétien en résulte. De grands efforts sont à faire pour mieux comprendre et mettre en valeur l’influence que la construction de l’être intérieur qu’apporte la vie chrétienne exerce non seulement sur les rapports interpersonnels mais sur les rapports sociaux et sur la marche des institutions qui régissent la cité. Il est fort instructif, en la matière de comparer les sociétés marquées par un héritage chrétien et celles qui sont marquées par d’autres héritages, tel celui de l’islam[8].
[1] Hervé Legrand, « Une méthode nouvelle de dialogue théologique : le consensus différencié sur la doctrine de la justification (Augsbourg 1999) », p. 3-4.
[2] Ibid.
[3] Ibid., p. 7.
[4] Philippe d’Iribarne, « L’étranger dans la Bible comme personne et comme peuple », Société, droit et religion 2019/1.
[5] Trajectoires et origines. Enquête sur la diversité des populations en France, Sous la direction de Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon, Ined éditions 2015, p. 566.
[6] Le Figaro, 31 mars 2023, rendant compte des résultats d’une nouvelle enquête « Trajectoires et origines » menée par l’INSEE et l’INED en 2019 et 2020.
[7] Ifop, Enquête auprès des Français musulmans sur les questions de religion et de laïcité, 7 décembre 2023.
[8] Philippe d’Iribarne, L’islam devant la démocratie, Gallimard, 2013.

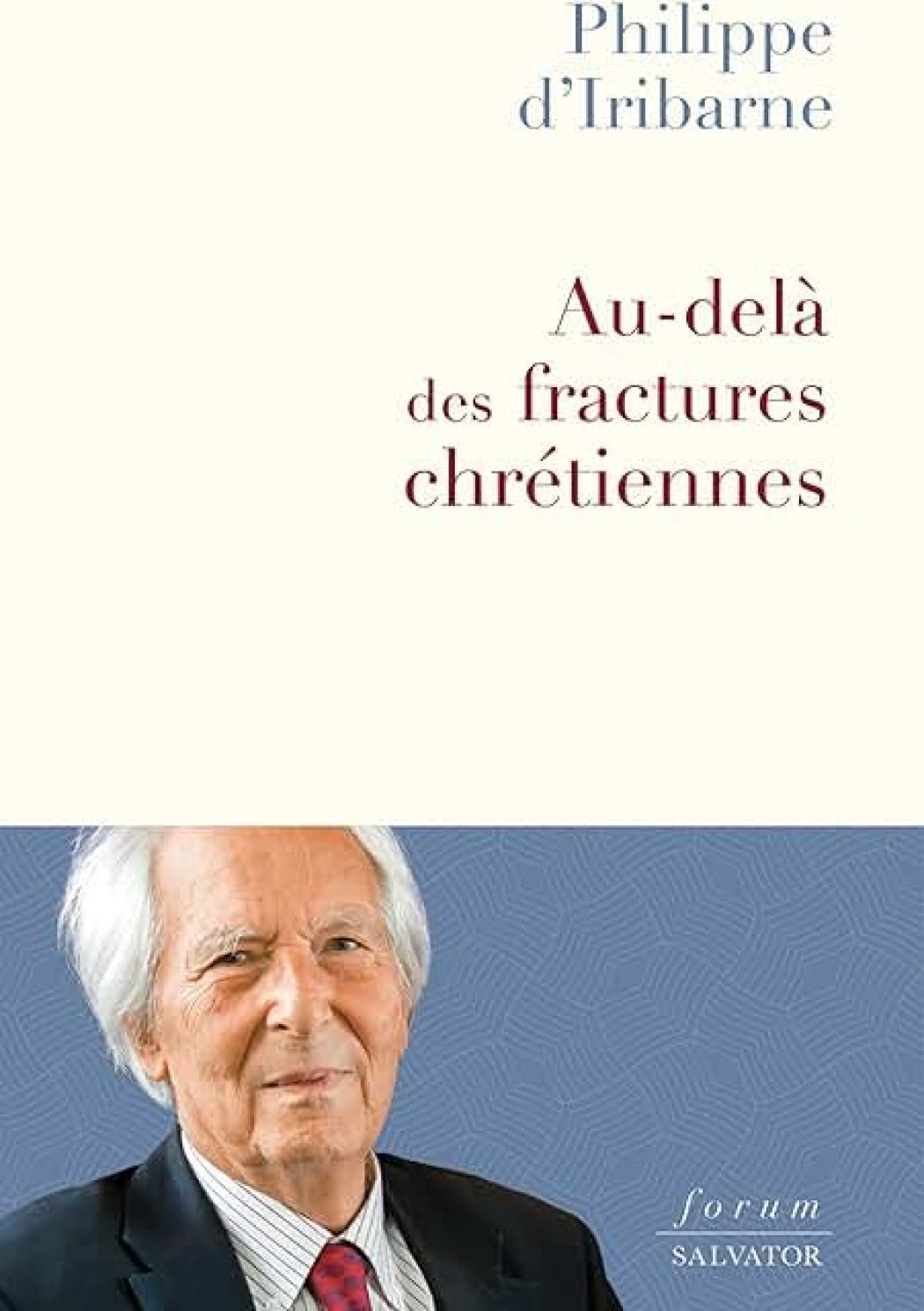


D'Haussy
Pour se décentrer du rite latin je conseille à tout le monde de fréquenter des chrétiens orientaux catholiques, orthodoxes et pré chalcédoniens…
(ça va vous entraîner à accepter d’être minoritaires 😏)
Montalte
Article très intéressant. Certains points peuvent se discuter mais ça change des bêtises d’autres tribunes libres publiées récemment