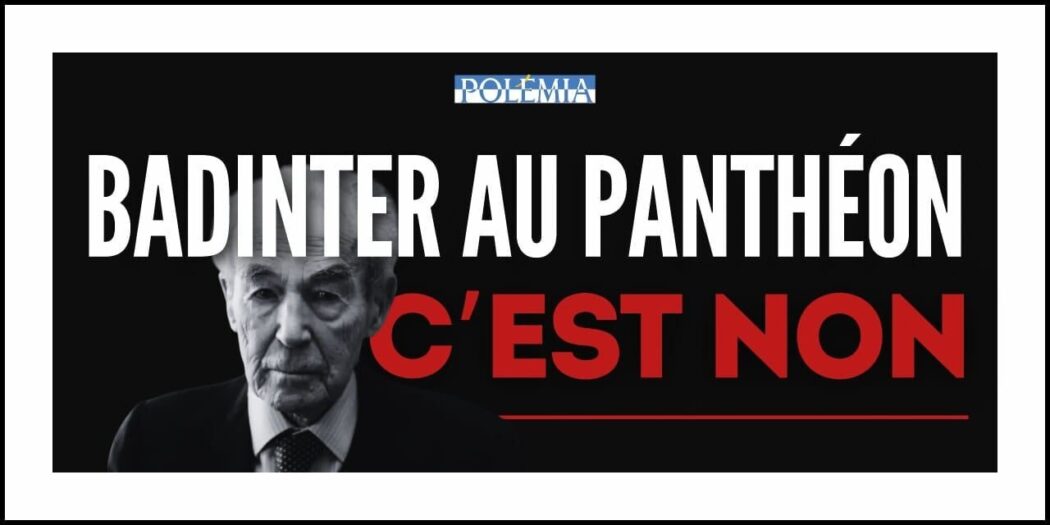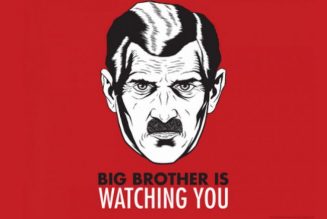Polémia lance une campagne contre le projetde panthéonisation de Robert Badinter et lance une pétition pour faire connaître la nocivité de ce personnage.
En effet, Robert Badinter a relégué les victimes, ou en tout cas certaines, à l’arrière-plan de l’institution judiciaire. Son combat pour les criminels, à travers ses procès, son mandat de ministre et son œuvre, a créé un déséquilibre qui se paie aujourd’hui dans un contexte d’insécurité généralisée en France. Le délinquant semble sanctuarisé, tandis que la victime s’efface et l’édifice judiciaire voit sa balance pencher considérablement du côté du crime.
Robert Badinter, avocat, ministre de la Justice (1981-1986) et président du Conseil constitutionnel, incarne une vision humanitariste du droit. Son engagement contre la peine de mort, concrétisé par son abolition en 1981, en a fait une véritable icône. Cependant, cet « humanisme » revendiqué par Badinter, centré sur la rédemption du criminel, semble avoir occulté les victimes, reléguées à l’arrière-plan. Si la loi Badinter de 1985 sur les accidents de la route constitue une exception notable en renforçant les droits des victimes, elle ne saurait masquer une tendance générale : dans les combats de Badinter, le criminel est souvent érigé en figure centrale, au détriment de la souffrance des victimes. Cette analyse explore ce paradoxe, en soulignant les contradictions d’un homme qui, tout en défendant l’imprescriptibilité du génocide, a parfois semblé minimiser les victimes des crimes ordinaires.
La sanctuarisation du criminel : l’inversion des valeurs de Robert Badinter
Les procès marquants de Robert Badinter, comme ceux de Roger Bontems (1972) et Patrick Henry (1977), révèlent une focalisation sur la défense du criminel. Dans l’affaire Bontems, accusé de complicité dans une prise d’otages meurtrière à Clairvaux, maître Badinter plaide pour éviter la guillotine, arguant que son client n’a pas directement tué. Malgré l’échec, cette affaire catalyse son combat abolitionniste. Dans le cas de Patrick Henry, assassin d’un enfant de 7 ans, Badinter transforme le procès en une tribune contre la peine de mort, déclarant : « Guillotiner, c’est couper un homme vivant en deux. » Sa plaidoirie sauve Henry de la peine capitale, mais la victime, Philippe Bertrand, est reléguée à une abstraction. Le tueur d’enfant devient victime d’une société considérée comme injustement répressive et l’enfant mort est évacué dans une démonstration d’inversion des valeurs où le mal est érigé en bien et le bien est tout bonnement nié.
Cette sanctuarisation du criminel, perçu comme une victime de la société, si elle peut s’entendre pour maître Badinter qui défend son client, devient une norme dangereuse dès lors qu’elle est érigée en dogme par le législateur à l’initiative du garde des Sceaux Robert Badinter. D’une posture légitime dans le cadre de la défense pénale, l’on passe à une idéologie politique qui bouleverse l’équilibre d’une institution dans laquelle la réinsertion du criminel primera désormais sur la reconnaissance de la douleur des victimes.
Les paradoxes de Badinter : la victime à géométrie variable
Badinter lui-même incarne des contradictions. Sa lutte pour l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, notamment concernant les juifs, montre une sensibilité aiguë pour certaines victimes plus que pour d’autres. En 1979, il signe une tribune dans Le Monde, « Pour le jugement des crimes contre l’humanité », dénonçant les thèses révisionnistes et plaidant pour la justice face aux crimes imprescriptibles. Badinter est ainsi capable de fermeté et, en 1987, durant le procès de Klaus Barbie, il insistera sur la singularité du génocide juif.
Ministre, il promulgue en 1985 une exception à la loi qui interdit depuis 1881 de filmer ou d’enregistrer une audience, puis à partir de 1954 de photographier les scènes d’un procès, déclarant : « Vu l’atrocité des faits et le nombre exceptionnel de victimes, le procès s’annonce historique et médiatique. Ne conserver aucune trace de ce procès pour la mémoire paraît inconcevable. »
Cette attention portée aux victimes de temps passés contraste avec son approche des victimes de crimes ordinaires et présents, souvent éclipsées par son discours sur la rédemption des criminels.
Dans Les Épines et les roses (2011), il reconnaît avoir été perçu comme « le ministre des criminels ». Son obsession pour la réinsertion reflète une croyance en la perfectibilité humaine, mais l’auteur a toujours refusé cette perfectibilité à certains.
Les victimes de la route : une exception dans l’œuvre de Badinter
La loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, illustre un engagement concret en faveur des victimes d’accidents de la circulation. En instaurant un droit quasi automatique à l’indemnisation pour les piétons, cyclistes, passagers et victimes vulnérables (enfants de moins de 16 ans, personnes de plus de 70 ans), cette loi marque une évolution significative en faveur des victimes d’accidents de la route. Ce texte a répondu à une hécatombe routière avec une quinzaine de milliers de morts sur les routes par an dans les années 1970, en imposant une responsabilité objective des conducteurs de véhicules terrestres à moteur, même en l’absence de faute directe. Cette législation, imposée contre les lobbies des assureurs, a permis de réparer les préjudices subis par les victimes. Cependant, cette loi se distingue par son cadre spécifique : les accidents de la route, souvent involontaires, diffèrent des crimes intentionnels. Les victimes de la route bénéficient d’une protection renforcée, mais ce régime d’indemnisation contraste avec le traitement des victimes de crimes violents, souvent laissées dans l’ombre des combats de Badinter.
Un déséquilibre durable : la victime reléguée au second plan
L’abolition de la peine de mort, promulguée le 9 octobre 1981, marque l’apogée du combat de Badinter pour les criminels contre les victimes. Mais, comme le souligne le professeur Jean-Louis Harouel, auteur de Libres réflexions sur la peine de mort (2019), elle s’est accompagnée d’un affaiblissement du système pénal, où la disparition de la peine capitale a délégitimé les autres peines, favorisant un laxisme perçu comme générateur d’insécurité.
Les victimes, loin d’être au centre du système judiciaire, se retrouvent souvent seules face aux assureurs ou aux expertises médicales, comme le note la critique des pratiques d’indemnisation sous la loi Badinter elle-même. Le contraste est frappant : alors que Robert Badinter a su mobiliser les médias pour faire du procès Barbie un moment de pédagogie sur la Shoah, les victimes de crimes violents n’ont pas bénéficié d’une telle visibilité. Outre un parti pris évident du ministre, cette marginalisation reflète une justice qui, sous l’influence de l’humanitarisme, privilégie la réhabilitation du criminel au détriment de la réparation morale et matérielle des victimes.
Rétablir l’équilibre, sortir du paradoxe de Badinter et du laxisme
Robert Badinter a transformé la justice française par son humanitarisme et son éloquence. Son héritage révèle un déséquilibre : en sanctuarisant le criminel comme figure à sauver, il a parfois effacé la victime, sauf dans le cas notable des accidents de la route. Ses contradictions, notamment sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, soulignent le paradoxe de sa pensée.
Ce paradoxe se retrouve dans une société qui choisit ses victimes. Gisèle Pélicot a eu ainsi tous les égards de la presse et le procès de ses violeurs a été entouré d’une attention particulière. Il en va de même pour certaines victimes, celles considérées comme ayant fait l’objet de racisme ou de sexisme. En revanche, des victimes comme Lola ou Thomas à Crépol n’ont pas bénéficié d’une pareille attention. Pour rétablir l’équilibre, il est impératif de redonner une place centrale aux victimes, non seulement dans les discours, mais dans les mécanismes de la justice, afin que l’humanitarisme de Badinter ne soit pas perçu comme une absolution unilatérale des criminels.
Une vision aux conséquences graves
La philosophie pénale de Robert Badinter, centrée sur la réinsertion et la compréhension des causes sociales de la délinquance, a profondément marqué la justice française contemporaine. Si elle se veut humaniste, cette approche est également à l’origine d’une culture de l’excuse, affaiblissant la responsabilité individuelle et la fonction dissuasive de la peine.
Robert Badinter, figure emblématique du droit français, a durablement influencé la politique pénale par son engagement pour une justice tournée vers la réhabilitation plutôt que vers la répression. Ministre de la Justice de 1981 à 1986, il a porté une vision pénale inspirée par des idées progressistes, notamment celles de Marc Ancel et de son concept de Défense sociale nouvelle. Cette philosophie, qui met l’accent sur la réadaptation du délinquant et la compréhension des facteurs sociaux de la criminalité, a été saluée pour son humanisme, mais critiquée pour avoir contribué à un laxisme judiciaire perçu comme une menace pour l’ordre public. Cet article explore comment la pensée de Badinter, en s’appuyant sur des théories « humanistes », a désarmé l’appareil judiciaire en marginalisant la notion de responsabilité individuelle.
Les racines de la pensée de Badinter : une justice centrée sur l’individu
Robert Badinter s’enracine dans une vision humanitariste qui privilégie la réinsertion du délinquant à la punition pure. Dans son ouvrage L’Exécution (1973), il dénonce les excès d’une justice répressive, racontant l’expérience traumatisante du procès de Roger Bontems, condamné à mort malgré un rôle qu’il considère comme secondaire dans un crime. Ce texte, empreint d’émotion, illustre sa conviction que la peine doit viser à comprendre et à réhabiliter plutôt qu’à détruire. L’auteur donne ici la primeur aux sentiments et à l’émotion, alors que la matière juridique induit un formalisme rationnel.
Dans Liberté, libertés (1976), Robert Badinter plaide pour une justice qui tienne compte des circonstances sociales et psychologiques du délinquant, arguant que la prison doit être un lieu de transformation, non de vengeance. Cette approche s’inscrit dans un courant plus large, celui de la Défense sociale nouvelle de Marc Ancel, qui prône une politique criminelle humanitariste. Badinter, en tant qu’avocat et ministre, a fait de ces idées un pilier de sa réforme du système pénal, cherchant à remplacer la logique punitive par une logique de réadaptation. Aujourd’hui, cette vision est unanimement partagée à gauche de l’échiquier politique.
Publiée en 1954, l’œuvre de Marc Ancel, La Défense sociale nouvelle, marque une rupture avec les conceptions classiques du droit pénal. Ancel y propose une approche centrée sur la réadaptation du délinquant, en s’appuyant sur une analyse des causes sociales et psychologiques de la criminalité.
Selon lui, la société doit protéger à la fois le corps social et l’individu délinquant, en respectant sa dignité humaine. Cette doctrine, traduite en plusieurs langues et largement débattue à l’international, rejette la peine comme simple châtiment au profit de mesures éducatives et préventives. Ancel critique le légalisme rigide des philosophes du XVIIIe siècle, comme Beccaria, dont l’influence aurait retardé l’émergence de cette vision qu’il considère comme humaniste. Il souligne que des réformes fragmentaires, dès le XIXe siècle, avaient commencé à répondre aux préoccupations de la Défense sociale, mais c’est au XXe siècle, après les expériences des régimes totalitaires, que le mouvement prend son essor.
La création de la Société internationale de défense sociale en 1949 et du Centre d’études de défense sociale en 1953 témoigne de cette dynamique. Cependant, l’analyse d’Ancel n’est pas sans nuance et il insiste toujours sur la nécessité d’un équilibre : la réadaptation ne doit pas sacrifier la protection de la société.
L’influence de Badinter : une justice moins punitive, mais à quel prix ?
En tant que ministre, Badinter a traduit ces idées en politiques concrètes, notamment à travers l’abolition de la peine de mort (1981) et la promotion de peines alternatives à l’incarcération. Son discours au Sénat en 1981, publié dans Contre la peine de mort (2006), illustre son rejet d’une justice fondée sur la vengeance : « La justice de la France ne peut être une justice qui tue. » Il défend une approche où la peine doit servir à réintégrer le délinquant dans la société, en s’attaquant aux causes profondes de la délinquance, comme la pauvreté ou l’exclusion. Cependant, cette attention portée au criminel et à ses motivations a conduit à une relativisation de la faute. En mettant l’accent sur les circonstances atténuantes, la pensée de Badinter a fini par justifier le crime par des facteurs externes, créant ce que certains critiques appellent une « culture de l’excuse », où l’on excuse les fautes des criminels en les justifiant par un contexte jugé criminogène (pauvreté, enfance difficile…). Cette approche a influencé les magistrats, qui désormais privilégient des peines légères ou des mesures de réinsertion au détriment de sanctions fermes.
Une responsabilité individuelle affaiblie
La principale critique adressée à la pensée de Badinter est qu’elle a sapé la notion de responsabilité individuelle. En insistant sur les déterminismes sociaux, cette philosophie tend à dédouaner le délinquant de ses choix. Or, comme le soulignent les néoclassiques, la peine a une fonction de prévention collective : en infligeant une souffrance proportionnée, elle dissuade les potentiels criminels et renforce le sentiment de justice dans la société. S’il admet que la peine-châtiment reste parfois nécessaire, celle-ci se perd dans l’application pratique des réformes qu’il a pu inspirer. La concentration sur la réadaptation a conduit à une justice moins sévère, où les peines d’emprisonnement sont souvent écourtées au profit de mesures alternatives. Cette évolution a alimenté un sentiment d’impunité parmi les délinquants et une frustration chez les victimes, qui estiment que la justice ne joue plus son rôle protecteur.
Un laxisme judiciaire aux conséquences sécuritaires et morales dramatiques
La « culture de l’excuse » attribuée à la pensée Badinter a des répercussions profondes sur le système judiciaire et la société. En réduisant la portée dissuasive de la peine, cette approche favorise la récidive. La justice, en cherchant à comprendre le délinquant, néglige les attentes des citoyens en matière de sécurité. La multiplication des aménagements de peine et des libérations conditionnelles, encouragées par les réformes de Badinter, a renforcé l’idée d’une justice « molle ». Si l’objectif était de favoriser la réinsertion, le manque de moyens pour accompagner ces mesures (suivi psychologique, programmes de formation) a souvent conduit à des échecs, laissant les délinquants livrés à eux-mêmes et les citoyens désabusés. Outre la conséquence sécuritaire, le sentiment de ne pas être protégé par la justice favorise par ailleurs le rejet de l’institution judiciaire.
La pensée de Robert Badinter a cherché à humaniser la justice pénale en plaçant la réinsertion au cœur du système. Cependant, en marginalisant la responsabilité individuelle et la fonction dissuasive de la peine, elle a contribué à une situation de laxisme judiciaire. Pour répondre aux défis actuels, il est nécessaire de repenser cet équilibre : une justice humaniste doit aussi être humaniste pour les victimes et garantir la protection de la société tout en offrant des chances de rédemption. Les idées de Badinter, empreintes d’idéalisme et d’humanitarisme, ont finalement désarmé la justice face à la criminalité.