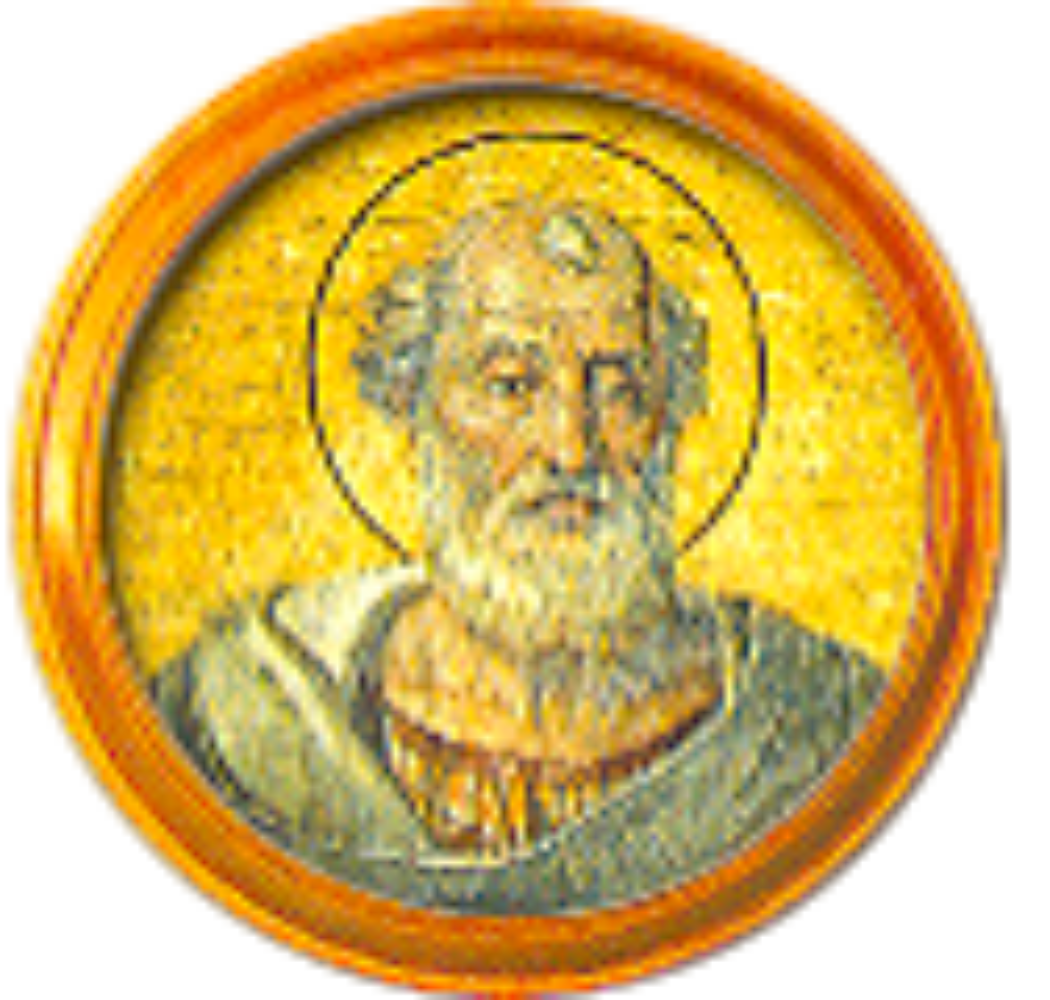D’Aurelio Porfiri, éditeur et écrivain catholique italien, pour le Salon beige:
l y a quelques mois, une nouvelle parue dans les journaux italiens a suscité beaucoup de commentaires — à juste titre. Un jeune homme a tué un autre garçon de son âge parce qu’il ne supportait pas que cette personne soit « heureuse ». Le meurtrier a déclaré : « J’ai choisi de le tuer parce qu’il semblait trop heureux, et je ne supportais pas son bonheur. » Je sais, en lisant quelque chose comme cela, on peut penser que ce jeune homme est non seulement un assassin, mais aussi un déséquilibré. Oui, c’est peut-être le cas. Mais il ne faut pas sous-estimer la puissance de la frustration chez les personnes qui n’arrivent pas à s’ajuster à une certaine réalité. Parfois, je pense que certaines personnes sont simplement incapables d’accepter la réalité telle qu’elle est, et qu’elles essaient donc de la détruire d’une manière ou d’une autre — dans ce cas précis, en tuant quelqu’un qui « semblait heureux ».
Le plus grand problème de ce jeune homme, c’est qu’il ne comprend pas qu’il a tué une personne — ce qui est déjà horrible —, mais qu’il n’a pas tué le bonheur. Le bonheur sera toujours là, même s’il a « supprimé » du monde quelqu’un qui lui rappelait son propre malaise. On ne peut pas tuer la réalité.
Je crois que le problème est semblable, bien que différent dans la forme, à celui des hérétiques. Le sens du mot « hérétique, hérésie » renvoie à quelque chose qui concerne le choix. N’est-ce pas curieux ? Cela semble en réalité quelque chose de bon et noble, que quelqu’un ait le courage de faire un choix. Mais ici, le choix ne se fait pas entre deux alternatives, mais contre la réalité de la vérité éternelle et immuable de l’Église catholique romaine — vérité qui peut être approfondie, mais non changée. Les hérétiques ne pensent pas ainsi. Ils croient que la vérité peut et doit être changée pour s’adapter à leur idée de la réalité — une idée qui n’a pas de fondement dans l’enseignement constant de l’Église.
Ce problème m’est revenu à l’esprit en méditant sur saint Jules (pape de 337 à 352), que l’Église fête le 12 avril. Il faut d’abord rappeler ceci : ce pape romain fut élu en février de l’année 337. Cette même année, trois mois plus tard, l’empereur Constantin mourut au mois de mai. Comme nous le savons, l’empereur Constantin a joué un rôle central dans l’histoire du christianisme, car il fut l’empereur qui, en 313 avec l’édit de Milan, permit enfin à l’Église — et à d’autres religions — de ne plus être persécutée.
Mais, comme toujours, les choses ne sont pas si simples. La culture de Rome était païenne, et l’opposition au christianisme était forte. Les chrétiens étaient vus comme des « ignorants », comme des personnes peu fiables. Même si le IVe siècle fut probablement le plus grand siècle pour l’histoire de la littérature chrétienne, le christianisme était constamment menacé — de façon compréhensible par l’extérieur, mais aussi de l’intérieur. À l’époque du pape Jules, l’une des pires hérésies (donc une menace interne) fut l’arianisme, la doctrine du prêtre Arius (250–336), qui, fondamentalement, ne reconnaissait pas pleinement la divinité du Christ. Ce n’était pas une opinion innocente, car cela remettait en cause le cœur même de la doctrine chrétienne établie. L’un des grands problèmes de cette époque concernait Athanase (296–373), évêque d’Alexandrie, ardent défenseur de l’orthodoxie chrétienne, et à ce titre violemment combattu par les hérétiques. Le pape Jules le rétablit dans sa charge légitime d’évêque d’Alexandrie, bien que le problème ne s’arrêtât pas là.
Le pape convoqua un concile pour trancher l’affaire d’Athanase, et il affirma clairement la primauté du siège de Pierre :
« Lorsqu’il y a des accusations contre l’évêque d’Alexandrie et d’autres évêques, il faut avant tout, selon la coutume, nous écrire pour que l’affaire puisse être réglée équitablement ici. »
Car le siège de Rome, lorsqu’il adhère à l’enseignement immuable de l’Église — que nul pape ne peut changer, mais seulement interpréter —, est appelé à gouverner les questions concernant la foi du peuple de Dieu.
Le pape considérait qu’il ne suffisait pas d’avoir une approche amicale envers les ariens ; il savait qu’il fallait leur faire comprendre clairement qu’ils couraient un grave danger, car leurs actions contre l’Église du Christ pouvaient les conduire à la damnation éternelle. Il faut toujours se rappeler qu’un pape — tous les papes — ne sont pas les propriétaires de l’Église. Ils ne peuvent pas agir de leur propre initiative, comme dans une entreprise commerciale. Ils ne sont que les gardiens du dépôt de la foi, chargés de le préserver pour le bien des fidèles, et ils doivent le transmettre à leurs successeurs, fondamentalement inchangé dans son contenu.
Le pape Benoît XVI, dans l’audience générale du 3 mai 2006, a déclaré :
« Le Concile Vatican II commente : “Ce que les Apôtres ont transmis contient tout ce qui contribue à une conduite sainte du Peuple de Dieu et à l’accroissement de la foi ; ainsi, dans l’Église, la doctrine, la vie et le culte perpétuent et transmettent à chaque génération tout ce qu’elle est elle-même, tout ce qu’elle croit” (Dei Verbum, n. 8). L’Église transmet tout ce qu’elle est et tout ce qu’elle croit, elle le transmet par le culte, par la vie et par la doctrine. Ainsi, la Tradition est l’Évangile vivant, annoncé dans son intégrité par les Apôtres, sur la base de la plénitude de leur expérience unique et non répétable : par leur activité, la foi est transmise aux autres, jusqu’à nous, et jusqu’à la fin du monde. La Tradition est donc l’histoire de l’Esprit qui agit dans l’histoire de l’Église par la médiation des Apôtres et de leurs successeurs, dans une continuité fidèle avec l’expérience des origines. C’est ce que disait saint Clément de Rome à la fin du Ier siècle : “Les Apôtres”, écrivait-il, “nous ont prêché l’Évangile de la part du Seigneur Jésus-Christ ; Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Le Christ vient donc de Dieu, les Apôtres du Christ. L’un et l’autre ont été envoyés selon l’ordre de Dieu… Nos Apôtres ont connu, par Notre Seigneur Jésus-Christ, qu’il y aurait des disputes autour du nom de l’épiscopat. C’est pourquoi, ayant reçu une parfaite connaissance de l’avenir, ils désignèrent les ministres déjà mentionnés et, par la suite, établirent une règle selon laquelle, après leur mort, d’autres hommes éprouvés devaient leur succéder dans leur ministère” (Ad Corinthios, 42, 44 : PG 1, 292, 296). Cette chaîne du service a continué jusqu’à aujourd’hui ; elle continuera jusqu’à la fin du monde. En effet, le mandat que Jésus a confié aux Apôtres a été transmis par eux à leurs successeurs. En allant au-delà de l’expérience du contact personnel avec le Christ, unique et non répétable, les Apôtres ont transmis à leurs successeurs le mandat solennel reçu du Maître d’aller dans le monde. “Apôtre” vient précisément du mot grec apostéllein, qui signifie “envoyer”. Le mandat apostolique — comme le montre le texte de Matthieu (Mt 28, 19s) — implique un service pastoral (“allez donc, de toutes les nations faites des disciples”), liturgique (“baptisez-les”) et prophétique (“enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit”), garanti par la proximité du Seigneur, jusqu’à la fin des temps (“et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde”). Ainsi, même si c’est différemment des Apôtres, nous avons aussi une expérience vraie et personnelle de la présence du Seigneur ressuscité. Par conséquent, à travers le ministère apostolique, c’est le Christ lui-même qui atteint ceux qui sont appelés à la foi. La distance des siècles est surmontée, et le Ressuscité se rend présent pour nous, dans l’Église et dans le monde d’aujourd’hui. C’est notre grande joie. Dans le fleuve vivant de la Tradition, le Christ n’est pas à 2 000 ans de nous, mais il est réellement présent parmi nous et nous donne la Vérité, il nous donne la lumière qui nous fait vivre et trouver le chemin de l’avenir. »
Je crois qu’un vrai catholique — malgré ses limites et ses échecs — ne peut que se réjouir lorsque l’Église défend son dépôt de foi avec courage, sans faire de compromis avec un monde qui s’égare. Des papes comme Jules ont choisi la voie la plus difficile, parce qu’ils comprenaient à quel point il était dangereux de céder aux erreurs graves. Ils savaient que l’erreur n’a pas de droits. Car un pape — tous les papes — doit toujours écouter le commandement de Notre Seigneur Jésus-Christ, que l’on trouve dans l’Évangile selon saint Jean :
« Pais mes brebis. »