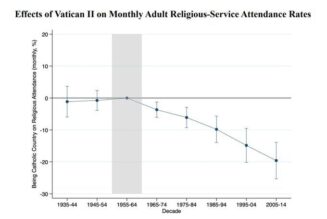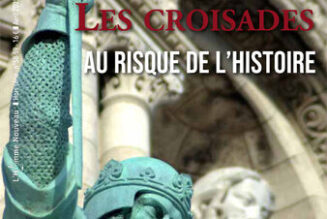Cinquième enfant de Louis VIII (+ 1226) et de Blanche de Castille (+ 1252), Louis IX naît le 25 avril 1214. Baptisé à Poissy (actuel département des Yvelines), il devient à douze ans le 44e roi de France. Patron du diocèse aux armées et de sa cathédrale, il est également invoqué comme patron de la France, notamment le 25 août, jour où l’on célèbre l’anniversaire de sa mort. Louis, dit le « Prudhomme », meurt au cours de la dernière croisade à Tunis en 1270, après 43 ans de règne. Il est canonisé par le pape Boniface VIII dès 1297.
De Mgr Ravel, évêque aux armées :
"Une fois que nous sommes accordés sur les faits de l’histoire, sur leur interprétation, sur le besoin d’en faire mémoire pour disposer du présent, pour préparer le futur, pourquoi s’attarder à cet homme du passé ? Qu’il s’agisse de saint Louis ou d’autres, sur quoi repose notre attachement ? C’est une loi générale : les saints ne sont jamais réductibles à leur époque. Un saint ne se laisse pas figer dans son siècle. S’il est décalé par rapport à notre temps, c’est un décalage vers l’avenir : il nous attend au tournant suivant. Aimable, il nous tend la main, mendiant notre cœur.
Donnons à nouveau notre affection à saint Louis, roi de France. Essayons de lui ouvrir notre cœur ainsi que nous le faisons pour un ami, lui confiant nos peines, nos joies, l’associant à notre mission, cherchant à le connaître avec bienveillance. À cette condition, il nous livrera quelques secrets de sa sainteté. Car connaître le secret d’un ami, c’est autre chose que de scruter les détails de son existence, à la façon d’un historien. Le secret partagé crée une intimité profonde entre deux êtres. Avec eux, quelque chose de la gravitation du Christ nous entraîne vers Dieu.
Dans son ouvrage Saints de France (paru chez Boivin, 1ère édition 1951), Henri Pourrat touche à ce secret avec une rare virtuosité. Il plante le décor : « Avec lui, le royaume entre dans son printemps », et d’ajouter : « En cette aurore du XIIIe siècle, toute la pensée grandit. » Louis IX naît avec Bouvines (27 juillet 1214), l’éclatante victoire de son grand-père Philippe Auguste (+ 1223). Mais la redistribution politique ne vaut pas tant que la floraison printanière d’idées nouvelles. Louis reçoit à sa table deux Docteurs de l’Église, saint Bonaventure et saint Thomas d’Aquin (+ 1274). Cette vitalité de l’esprit, bientôt écrite dans la politique et les mœurs, cette sève neuve, cette fièvre du cœur, cette vague de la pensée coïncident avec le roi saint Louis et lui avec elle. Un pareil printemps soulève l’enthousiasme, le goût de l’aventure et des folles équipées. Quand les feuilles voltigent et que notre mental erre, sous l’ombre nostalgique sécrétée par l’automne, une telle incarnation de la (re)naissance nous gonfle d’espérances nouvelles. Je ne parle pas tant de la saison que de notre société, où la chute des valeurs produit l’odeur des cimetières. Notre époque accueille des esprits émoussés, fades, gavés de politiquement correct. Pouvons-nous connaître, à notre génération, une telle pulsation de l’esprit ? Quelle nouveauté, quelle poussée, quelle grandeur nouvelles tendent nos énergies ? Une fin de race n’attire pas. Un point de croissance ne fascine pas. Les projets qu’on nous présente ne portent même plus de promesses. Il nous reste l’épaisseur maigrichonne du train-train quotidien. Heureusement, l’Évangile reste un prodigieux défi…
« Le plus fier chrétien que les païens eussent jamais connu », confie le sire de Joinville, conseiller du roi, à ses Mémoires. Parmi les regards sur saint Louis, on en trouve un qui fait le lien par-dessus les autres, c’est celui sur son christianisme. Au fond et à la cime de ses actions, il y a le chrétien. Son baptême aboutit à la sainteté. Mais il lui fournit d’abord l’unité de sa vie. Ce fameux dénominateur commun qui manque à notre vie sectorisée, Louis le trouve dans son baptême. De l’extérieur, les païens sentent et admirent la cohérence du roi. Ils ne jugent pas d’abord sa sainteté : pour l’estimer, il faut cette aimable confrontation entre les actes et l’Évangile que l’Église seule est habilitée à mettre en place. Mais les incroyants goûtent l’unité de l’homme. « Fier », indique la densité aimable, le rayon noble au parcours tranquille. La fierté éveille l’admiration sans la rechercher. Cette reconnaissance par les païens importe autant que la canonisation par l’Église. Elle chante le regard du païen sur l’homme juste. Elle dit ce à quoi il est sensible. Elle peut le déterminer à chercher « l’Unique ». En ce sens, saint Louis n’est pas seulement un exemple de piété mais un prototype du témoin.
« Tant qu’il put il choisit de faire la paix » (Henri Pourrat dans Saints de France). Formé aux armes, faiseur de croisade, combattant de première ligne, il n’idéalise pas la guerre. Elle n’est jamais un but en soi. Bien qu’à l’époque il faille gagner sa valeur à coups d’épée, le cœur de Louis IX voit plus loin que le bout de son arme. La guerre fait peut-être la valeur d’un chevalier, mais seule la paix fait le bonheur d’un pays. Il est difficile de trancher au sujet du saint roi : de la paix ou de la justice, on ne sait laquelle il préfère. « Par son amour de la justice, il se fait tant aimer, que, sans être ses sujets » (Henri Pourrat dans Saints de France), des Lorrains et Bourguignons lui demandent de leur faire droit. La postérité lui a fait un trône sous un chêne pour y rendre la justice. Certainement, l’histoire ne se trompe pas, à ceci près que saint Louis s’assoit à même le sol. C’est moins gracieux pour les images, mais cela correspond mieux à son style, absolument royal. Il est vrai aussi que la paix le hante, avec le roi d’Angleterre, avec ses grands barons, avec le sultan d’Égypte. Les deux vertus nous parlent : nous les posons l’une sur l’autre car la justice forme le socle de la paix.
À ceux qui croient plus volontiers à la valeur de la naissance qu’à celle des mérites, il réplique comme à son fils Philippe : « Biau fils, vraiment j’aimerais mieux qu’un Écossais vint d’Écosse qui gouvernât bien et loyalement, que tu gouvernasses mal en point et en reproches. » Toujours la même recherche de la justice. La compétence donne des droits que la filiation n’impose pas. On imagine, derrière ces mots de paix, justice et compétence, l’immense liberté du souverain. Quand on a le pouvoir de faire et de défaire pour un peuple tout entier, on s’acharne à faire le bien et à défaire le mal. Et tant pis pour les courtisans payant en flatterie ce qu’ils doivent en bonne monnaie. Seulement voilà : au XIIIe siècle, on fait la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est juste et ce qui ne l’est pas, entre ce qui unit et ce qui divise, entre le bien personnel et le bien commun. C’est peut-être en cela que l’époque du saint roi élève et dynamise.
De sa liberté, il est encore question dans ses rapports avec les gens d’Église. Il ne cesse de surprendre. Tandis que la croix et la bannière voguent ensemble, liées comme elles peuvent l’être dans le monde chrétien, on s’attend de la part de saint Louis à une obéissance méticuleuse, servile à force d’être respectueuse. Il n’en est rien. Sa vénération pour le mystère du prêtre ou de l’Église ne lui ôte aucune part de son discernement. Prenons un exemple. Louis fait vœu de conduire une croisade lors d’une grave maladie (presque à sa mort). Guéri, il veut tenir sa promesse ; mais sa mère, Blanche de Castille, ne l’entend pas ainsi. Elle fait intervenir l’évêque de Paris pour s’opposer à son départ. Ce dernier montre que son vœu, fait dans le délire, ne l’oblige pas. « Bon, dit le roi, je ferai donc à votre volonté. » Il rend sa croix à l’évêque. Mais aussitôt : « Et maintenant, suis-je en délire ? Eh bien, c’est maintenant que je vous demande de me donner la croix de Notre-Seigneur Jésus-Christ ! » Ces libres chevaliers de France n’abdiquent pas leur liberté. La rectitude de leur foi ne la ronge pas. Elle l’amplifie. Est-il meilleur témoin de la liberté évangélique, au croisement du respect et de la responsabilité ?
Da façon d’être roi le rattache au saint roi David bien mieux qu’une généalogie hasardeuse. Le roi dans la Bible règne en pasteur et père. Il ne suffit pas au pasteur de conduire le peuple. Il s’assimile à lui, il ne fait qu’un avec lui. En Égypte, alors que la famine et la peste poussent à la retraite, on veut obliger le roi épuisé à s’embarquer avec les autres malades. Mais il entend rester le dernier. Un de ses frères, le comte d’Anjou, lui reproche de retarder le mouvement : « Comte d’Anjou, si je vous suis à charge, débarrassez-vous de moi. Mais je n’abandonnerai jamais mon peuple. » Un peu plus tard, fait prisonnier des Sarrazins, il apprend que les riches négocient séparément leur rançon. Aussitôt, il leur interdit ces marchés pour que les pauvres ne restent pas seuls en captivité : « Je prends tout sur moi et veux être chargé de payer du mien propre le rachat de tous. » C’est le roi-pasteur selon le cœur de Dieu. Devant Mansourah, alité mais entendant le feu grégeois déchirer les airs pour tomber sur son armée, il soupirait : « Beau sire Dieu, gardez-moi mes gens ! » Henri Pourrat ajoute : « Le suzerain se doit même de former les cœurs de ses gens. » Le sire de Joinville en est un témoin remarquable. Au roi qui lui demande s’il est préférable d’attraper la lèpre que de commettre un péché mortel, Joinville répond avec sa franchise habituelle qui lui semble préférable d’avoir commis trente péchés mortels que d’être attaqué par la lèpre. C’est qu’il connaît ce qu’est la lèpre. Elle tue mais d’abord elle rogne, elle ronge, elle grignote. Saint Louis le reprend avec douceur mais précision. Il le traite de « hâtif musard ». Charles Péguy ne manque pas de commenter cette scène exemplaire. Il vaut mieux attraper trente fois la lèpre que de commettre un péché mortel. En d’autres circonstances, il éduque le même Joinville à l’humilité, le pressant de laver les pieds des pauvres.