D’Aurelio Porfiri, éditeur et écrivain catholique italien, pour le Salon beige:
Il y a quelque temps, je suis tombé sur un hommage à Mario Palmaro, décédé il y a quelques années des suites d’une grave maladie, publié dans Il Timone. Une phrase qu’il avait écrite m’a frappé : “Ce n’est pas le Pape qui crée la vérité ; le Pape en est le gardien. Une chose n’est pas vraie parce que l’Église la dit, mais l’Église la dit parce qu’elle est vraie.” Cette phrase m’est revenue à l’esprit alors que je réfléchissais à ce que je devais dire sur saint Thomas d’Aquin (1226-1274), étoile toujours brillante de la pensée catholique et, à ce titre, patrimoine de toute l’humanité. Jusqu’à récemment, être thomiste était un signe sûr d’être catholique et de suivre l’orthodoxie – c’est-à-dire ce qu’il faut croire – plutôt que l’orthopraxie, un vague « bien se comporter » (mais selon quoi ?). Or, l’orthopraxie n’a aucun sens si elle est séparée de l’orthodoxie, car nos actions ne peuvent être justes si elles ne sont pas correctement guidées. L’orthopraxie est à la base de la notion de « bien possible », selon laquelle une chose n’est pas simplement juste ou fausse, mais peut le devenir « sous certaines conditions ». Cette notion est appliquée partout, même dans la liturgie, où des considérations totalement extérieures à celle-ci protègent parfois des personnes de bonne volonté mais avec une formation totalement inadéquate. La pensée de notre humble frère dominicain – le thomisme – a servi de rempart contre la dérive d’une intelligence avide d’auto-célébration (il faudrait relire le philosophe français Marcel De Corte pour un développement éclairé de cette idée). Elle a permis un retour à la vérité des choses. On raconte qu’au début de ses conférences, saint Thomas montrait une pomme à son auditoire et déclarait : « Ceci est une pomme. Si vous n’êtes pas d’accord, vous pouvez sortir. » Que voulait-il dire ? Il voulait dire – et cela reste vrai aujourd’hui – qu’aucun discours ne peut commencer sans l’acceptation préalable de la vérité des choses telles qu’elles sont. C’est pourquoi il définissait la vérité, dans la continuité d’une tradition de pensée non seulement chrétienne, comme adaequatio rei et intellectus – c’est-à-dire l’intellect qui se conforme à la vérité des choses. Ce réalisme sain nous protège d’une religion fondée sur des contorsions intellectuelles ; il nous permet d’affirmer des choses vraies parce qu’elles sont vraies en elles-mêmes, et non simplement parce que nous les disons.
Le Père Enrico Zoffoli, dans son ouvrage Saint Thomas d’Aquin : un portrait (2024, édité par moi chez Chorabooks), décrit ainsi l’héritage du grand penseur : “À quarante-neuf ans, Thomas d’Aquin nous a laissé l’un des plus puissants et originaux systèmes de pensée humaine de tous les temps, exprimé dans une production littéraire qui ne cesse d’étonner (…). L’abondance des sources de sa pensée est telle qu’elle semblerait incroyable si elle ne transparaissait pas continuellement dans ses œuvres. L’Aquinate connaît parfaitement (et récite même par cœur) les principaux Pères de l’Église grecque et latine, comme en témoigne sa Catena Aurea in Evangelia. La forêt obscure, âpre et forte des œuvres de saint Augustin lui est familière. Il est informé de tous les écrivains et documents ecclésiastiques, des origines jusqu’à son époque. Il maîtrise toute la littérature grecque et latine, des historiens aux naturalistes, des poètes aux philosophes et aux juristes… Dans le domaine de la bibliographie aristotélicienne, il n’a pas de rival, connaissant les commentaires sur le Stagirite, qu’ils soient anciens ou contemporains, arabes, juifs ou chrétiens. Il n’est pas exagéré de le considérer comme l’héritier le plus brillant de toute la culture antique de l’Occident…” Et à propos du réalisme de saint Thomas : “C’est grâce à son réalisme qu’il ouvre la voie à la foi en fournissant des motifs de crédibilité qui en font le plus subtil et le plus heureux dépassement de la raison…” (E. Zoffoli, op. cit.). Thomas nous ancre au monde précisément pour nous permettre de le dépasser dans une synthèse plus élevée. Il nous enseigne que le christianisme ne rejette pas la réalité – comme c’était le cas de certaines tendances hérétiques au sein même du christianisme ou encore de certaines religions orientales – mais qu’il la pénètre, la comprend, l’accepte et, seulement après cela, la transcende vers une Réalité plus grande. Un thomiste profond comme Antonio Livi décrit ainsi le thomisme : “L’Aquinate, au-delà de la grandeur et de l’originalité de sa spéculation, est aussi l’auteur d’une synthèse théorique où convergent de manière cohérente Platon, Aristote, le néoplatonisme, la pensée patristique, la philosophie arabe et la philosophie juive. Ainsi, la philosophie thomiste se prête aisément à une mise en relation et une comparaison entre la pensée antique et la pensée médiévale, puis entre la pensée médiévale et la pensée moderne. Une caractéristique de la philosophie thomiste est la parfaite cohérence entre des éléments épistémologiques typiques de l’empirisme et ceux qui semblent relever de l’intellectualisme. En réalité, il faut toujours se rappeler que saint Thomas attache une attention constante à l’unité du système de vérité et d’expérience, ce qui signifie l’unité entre la perception sensible et la connaissance intellectuelle, entre la prima operatio intellectus et le jugement, entre intellectus et ratio. Une unité, certes, dans la distinction, que la gnoseologie thomiste analyse en détail, mais jamais au point d’attribuer une autonomie à l’un de ces moments de la connaissance” (2007, Le sens commun et la logique aléthique). L’ampleur de la pensée de saint Thomas est bien trop vaste pour tenter d’en donner ne serait-ce qu’un aperçu avec une prétention d’exhaustivité. Il faut donc se contenter de mettre en lumière cet aspect du réalisme, qui me semble être le fondement de tout le reste. Dans l’Encyclique Aeterni Patris (1879), le pape Léon XIII identifiait ainsi la contribution de saint Thomas d’Aquin à la tradition de la pensée chrétienne : “Mais entre tous les docteurs scolastiques, brille, d’un éclat sans pareil leur prince et maître à tous, Thomas d’Aquin, lequel, ainsi que le remarque Cajetan, pour avoir profondément vénéré les Saints Docteurs qui l’ont précédé, a hérité en quelque sorte de l’intelligence de tous. Thomas recueillit leurs doctrines, comme les membres dispersés d’un même corps; il les réunit, les classa dans un ordre admirable, et les enrichit tellement, qu’on le considère lui-même, à juste titre, comme le défenseur spécial et l’honneur de l’Église. D’un esprit ouvert et pénétrant, d’une mémoire facile et sûre, d’une intégrité parfaite de mœurs, n’ayant d’autre amour que celui de la vérité, très riche de science tant divine qu’humaine, justement comparé au soleil, il réchauffa la terre par le rayonnement de ses vertus, et la remplit de la splendeur de sa doctrine. Il n’est aucune partie de la philosophie qu’il n’ait traitée avec autant de pénétration que de solidité : les lois du raisonnement, Dieu et les substances incorporelles, l’homme et les autres créatures sensibles, les actes humains et leurs principes, font tour à tour l’objet des thèses qu’il soutient, dans lesquelles rien ne manque, ni l’abondante moisson des recherches, ni l’harmonieuse ordonnance des parties, ni une excellente manière de procéder, ni la solidité des principes ou la force des arguments, ni la clarté du style ou la propriété de l’expression, ni la profondeur et la souplesse avec lesquelles il résout les points les plus obscurs.
Ajoutons à cela que l’angélique docteur a considéré les conclusions philosophiques dans les raisons et les principes mêmes des choses : or, l’étendue de ces prémisses, et les vérités innombrables qu’elles contiennent en germe, fournissent aux maîtres des âges postérieurs une ample matière à des développements utiles, qui se produiront en temps opportun. En employant, comme il le fait, ce même procédé dans la réfutation des erreurs, le grand docteur est arrivé à ce double résultat, de repousser à lui seul toutes les erreurs des temps antérieurs, et de fournir des armes invincibles pour dissiper celles qui ne manqueront pas de surgir dans l’avenir. De plus, en même temps qu’il distingue parfaitement, ainsi qu’il convient, la raison d’avec la foi, il les unit toutes deux par les liens d’une mutuelle amitié : il conserve ainsi à chacune ses droits, il sauvegarde sa dignité, de telle sorte que la raison, portée sur les ailes de saint Thomas, jusqu’au faîte de l’intelligence humaine, ne peut guère monter plus haut, et que la foi peut à peine espérer de la raison des secours plus nombreux ou plus puissants que ceux que saint Thomas lui a fournis. C’est pourquoi, surtout dans les siècles précédents, des hommes du plus grand renom en théologie comme en philosophie, après avoir recherché avec une incroyable avidité les œuvres immortelles du grand docteur, se sont livrés tout entier, Nous ne dirons pas à cultiver son angélique sagesse, mais à s’en pénétrer et à s’en nourrir. On sait que presque tous les fondateurs et législateurs des Ordres religieux ont ordonné à leurs frères d’étudier la doctrine de saint Thomas et de s’y attacher religieusement, et qu’ils ont pourvu d’avance à ce qu’il ne fût permis à aucun d’eux de s’écarter impunément, pas même sur le moindre point, des vestiges d’un si grand homme : sans parler de la famille dominicaine, qui revendique cet illustre maître comme une gloire lui appartenant, les Bénédictins, les Carmes, les Augustins, la Société de Jésus et plusieurs autres Ordres religieux sont soumis à cette loi, ainsi qu’en témoignent leurs statuts respectifs.” Malheureusement, il n’est pas rare aujourd’hui d’assister à un rejet du thomisme, y compris dans des congrégations religieuses vénérables, au nom de l’adhésion à une pensée moderne qui ne représente pas seulement un éloignement du thomisme mais, peut-être justement à cause de cet éloignement, également un refus du cheminement naturel de la raison.
Saint Pie X affirmait dans l’encyclique Pascendi (1907) qu’un signe clair de l’avancée du modernisme est le rejet de la scolastique, et donc de la pensée de saint Thomas qui en est le cœur. Or, au thomisme devraient recourir tous ceux qui ont à cœur l’usage de la raison. Un thomiste comme le cardinal Dino Staffa pouvait ainsi affirmer : “La philosophie thomiste, bien qu’elle soit prescrite par l’Église, ne cesse pas d’être une philosophie, c’est-à-dire une œuvre exclusive de la raison. L’autorité qui l’impose n’entend pas se substituer à la démonstration et à l’évidence intrinsèque de ses conclusions.” (1989, Il Tomismo è vivo). En somme, saint Thomas d’Aquin appartient à l’humanité précisément parce qu’il part des faits réels, d’une adhésion aux exigences naturelles de la pensée qu’aucune rationalité, si elle ne veut pas se suicider, ne peut rejeter. Malheureusement, même dans l’Église, le non-respect de la vérité, remplacée par la notion relativiste du « bien possible », a trouvé sa place dans beaucoup, trop d’esprits.



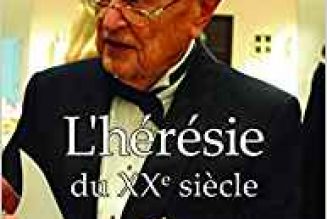


Trophyme
Excellente présentation du génie de l’Aquinate