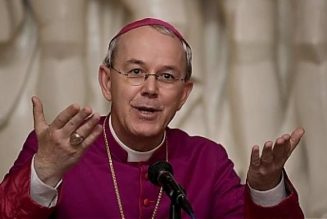Nous remercions l’association Una Voce de nous autoriser à publier des extraits des excellents commentaires des cinq pièces grégoriennes du dimanche ou de la fête à venir.
Vous aurez la totalité des textes sur le site et nous ne pouvons que vous encourager à vous abonner à la newsletter hebdomadaire en cochant dans la case adéquate sur la page d’accueil.
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face, Vierge, patronne secondaire de la France a rendu sa belle âme à Dieu, à l’âge de 24 ans, le 30 septembre 1897. La date de sa fête liturgique est le 3 octobre (le 1er octobre selon le nouveau calendrier de 1969) mais la solennité, qui n’est pas obligatoire, se fait le dernier dimanche de septembre en France dans l’Ordo selon les livres liturgiques de 1962. L’on peut très bien célébrer le 16e dimanche après la Pentecôte.
► Introït : Veni de Líbano
Veni de Líbano, sponsa mea, veni de Líbano, veni ;
Viens avec moi du Liban, mon épouse, viens avec moi du Liban ;Vulnerásti cor meum, soror mea sponsa, vulnerásti cor meum ;
Tu m’as blessé au Cœur, ma sœur, mon épouse, tu m’as blessé au Cœur.
Dans ces deux versets du Cantique des Cantiques, c’est le Christ qui appelle l’Église, son épouse, du cri de l’amour qui, comme un feu, le brûle. Ce cri est pour chacun de nous. Dans la mesure où nous avons su cultiver en nous le sens divin de la foi, nous l’entendons qui nous convie pour des entretiens courts ou prolongés.
Que de fois ne l’entendit-elle pas, la petite Sainte ! Le jeudi Saint, 2 mai 1896, lorsque, dans l’obscurité de sa cellule, elle eut son premier crachement de sang, elle le perçut plus vif, « comme un lointain murmure qui annonçait l’arrivée de l’époux ». Le murmure se précisa, à mesure que l’amour, s’intensifiant, creusait dans le cœur de l’Époux une blessure plus cuisante. Elle n’en a plus parlé mais au moment de sa mort son dernier mouvement, lorsqu’elle ouvrit les yeux et les tint fixés vers le ciel, le temps d’un Credo, brillants de paix céleste et d’un bonheur indicible, n’était-il pas la réponse au suprême vent ?
C’est cet appel du dernier instant, éternellement prolongé dans l’éternelle union, que le Christ chante par notre voix au matin de sa fête. Admirable ouverture de ce drame d’amour auquel nous sommes conviés.
La mélodie est calquée sur la mélodie de l’introït Tibi dixit cor meum du mardi de la deuxième semaine de Carême. D’après Dom Baron, le calque est très réussi. Le mouvement mélodique est très réduit. Mais quelle mélodie traduirait bien ce chant mystérieux qui va de l’âme du Christ à l’âme qui s’est donnée à lui ? Le Psaume 112 vient alors, comme la voix de l’Église ou, si l’on veut, comme celle de la Sainte, nous invitant à chanter le Roi d’amour.
Laudáte púeri, Dóminum ; laudáte nomen Dómini
Louez le Seigneur, enfants, louez de nom du Seigneur.
► Graduel : Confíteor tibi
Comme je l’ai annoncé, j’utiliserai le coffret de la Schola Bellarmina publié en 2013, précisément le troisième CD de ce volume 15 consacré au Commun des saints. Hervé Lamy et Vincent Lecornier sont sous la direction de Bernard Lorber. Dom Baron, pour commenter le graduel qui va suivre, cite un extrait du passionnant ouvrage de sainte Thérèse, « Histoire d’une âme ». Le voici :
Je voudrais trouver un ascenseur pour m’élever jusqu’à Jésus… J’ai demandé aux livres saints… et j’ai lu ces mots sortis de la sagesse éternelle « Si quelqu’un est tout petit, qu’il vienne à moi ». Je me suis donc approchée de Dieu et, voulant savoir encore ce qu’il ferait au tout petit, j’ai continué mes recherches et voici ce que j’ai trouvé « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein, je vous bercerai sur mes genoux ». Ah ! Jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. O mon Dieu, vous avez dépassé mon attente, je veux chanter vos miséricordes ! Vous m’avez instruite dès ma jeunesse. [Fin de citation].
C’est ce qu’elle chante dans le graduel par notre voix avec l’Évangile de saint Matthieu.
Confíteor tibi, Pater, Dómine cæli et terræ, quia abscondísti hæc a sapiéntibus, et prudéntibus, et revelásti ea párvulis
Je vous bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, car vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents de ce monde et les avez révélées aux petits.
Dómine, spes mea a juventúte mea.
Seigneur, dès mon enfance, j’ai espéré en vous.
La première phrase est toute recueillie dans une joie profonde. Dès le début de la seconde un mouvement d’exaltation assez inattendu se dessine et va s’épanouir sur une formule originale celle-là qui chante avec beaucoup de bonheur l’allégresse de la sainte évoquant ces paroles divines, qui furent pour elle « si tendres et mélodieuses ». Sur les belles formules des grandes allégresses, la joie de la petite sainte exulte ici du commencement à la fin.
► Alléluia : Quasi rosa
« Ma Sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus va bientôt mourir… je me demande vraiment ce que notre Mère pourra en dire après sa mort ! Elle sera bien embarrassée ! Cette petite sœur, tout aimable qu’elle est, n’a pour sûr rien fait qui vaille la peine d’être raconté ! » Ainsi parlait une sœur converse du couvent de Lisieux, pendant l’agonie de sainte Thérèse. Pouvait-elle penser que cette même « petite sœur » serait déclarée patronne des missions par le pape Pie XI, et patronne secondaire de la France avec sainte Jeanne d’Arc ! Que les premières démarches en vue de sa béatification seraient faites à peine douze ans après sa mort, et que deux ans après elle serait canonisée ! Que sa vie serait traduite en plus de trente-cinq langues ! Elle qui voulait rester toute petite et lutter contre l’orgueil : par la simple phrase de la sœur converse, elle avait gagné.
Sa vie a été consacrée à la confiance absolue en l’amour qui culmine dans l’acte d’offrande en l’Amour miséricordieux, du 9 juin 1895 : « Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m’offre comme victime d’holocauste à Votre Amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous. »
Les paroles de l’Ecclésiastique qui nourrissent le texte de l’alléluia de la fête correspondent bien à ce que la petite Thérèse a su entendre.
Il n’est que de citer cette phrase de l’ « Histoire d’une âme » :
« Le petit enfant jettera des fleurs, il embaumera de ses parfums le trône divin, il chantera de sa voix argentine le cantique d’amour ».
Voici ce texte scripturaire, beaucoup trop long pour un verset d’alléluia, le plus copieux du répertoire, mais magnifique…
Quasi rosa plantáta super rivos aquárum fructificate : quasi Libanus odórem suavitátis habete : florete, flores, quasi lílium, et date odórem, et frondete in grátiam, et collaudate cánticum, et benedicite Dóminum in opéribus suis.
Croissez comme la rose plantée sur les bords des eaux : comme le Liban répandez votre parfum suave : semblable au lys, faites éclore vos fleurs et exhalez vos parfums, parez-vous de beauté, chantez un cantique et louez le Seigneur pour la grandeur de ses œuvres.
Dom Baron nous donne quelques informations techniques sur la façon dont on a procédé pour trouver une mélodie sur un texte aussi étendu. Écoutons-le :
On a choisi celle de l’alléluia du Xe dimanche après la Pentecôte. On en a répété la première phrase et on a appliqué à floréte flores, qui s’imposait comme mot central, l’admirable vocalise de la fin. Cela fait, il restait la moitié du texte. Fort heureusement ce même alléluia se trouve avoir un second verset, tout autre, tant pour le texte que pour la mélodie. Il est en usage pour la fête de saint Alexis le 17 juillet, au supplément pour certains lieux. On a eu l’idée, après une incise de transition sur quasi lílium de le joindre au premier et, par de très habiles sutures, on a fait l’unité. Autant que faire se pouvait ; car on sent tout de même les deux mélodies, d’autant que la vocalise finale ne reproduisant pas le jubilus de l’alléluia, un lien puissant fait ainsi défaut dans l’ensemble.
► Offertoire : Magníficat
La vie apparemment obscure de Thérèse dans son couvent, occupée par de simples tâches (balayage, couture, travaux ménagers…), fut en réalité un long combat caché contre elle-même, et sa nature difficile. D’après les notes prises par sa sœur Céline, on apprend que Thérèse montra dès l’enfance un caractère orgueilleux et obstiné. Avant de devenir la religieuse souriante, serviable et humble, elle fut tout le contraire : dépressive, scrupuleuse à l’extrême, capricieuse, excessivement fragile. Elle fut jusqu’à la fin de sa vie atteinte par d’affreux doutes, mais s’abandonna à la confiance de l’Amour de son Divin époux. Elle ne fléchit jamais, même durant le long combat contre la mort que Dieu lui réserva comme ultime épreuve.
Le Magnificat avec son humble exultation convenait après l’Évangile de saint Matthieu où l’on a entendu pour finir « Quiconque s’abaissera comme cet enfant, celui-là est grand dans le Royaume des cieux ». Elle y est dans le Royaume notre Sainte. Et grande. Et elle y exulte, chantant à jamais son Magnificat. Ne l’a-t-elle pas déjà esquissé sur la terre ? Elle ne s’est jamais regardée que comme toute petite, elle l’a écrit à toutes les pages de son Histoire ; que comme servante, la servante qui ne cherche qu’à « faire plaisir ». Et elle a eu cette simplicité merveilleuse, cette humilité suprême de dire, parce que l’Esprit l’y poussait, que « le Seigneur fera par moi des merveilles qui surpasseront infiniment mes immenses désirs…Personne ne m’invoquera sans recevoir de réponse… Je ferai tomber, après ma mort, une pluie de roses… « .
Avec elle, chantons-le, nous aussi le Magnificat, pour remercier Dieu de nous avoir donné sa servante pour nous servir, et, par elle, de faire en nous les grandes choses qu’il veut.
Magníficat ánima mea Dóminum : et exsultávit spíritus meus in Deo salutári meo : quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ : fecit mihi magna qui potens est.
Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur : car il a jeté les yeux sur son humble servante, il a fait en moi de grandes choses.
La mélodie est celle de l’offertoire Jubiláte du IIe dimanche après l’Épiphanie qui a été choisie. Évidemment si habile qu’il soit, le calque ne vaut pas l’original. Cela mis à part, il est très satisfaisant. On aurait pu croire que l’enthousiasme grandiose du Jubiláte se fût mal accordé avec de telles paroles sur des lèvres si délicates. Mais la seconde phrase a été laissée de côté. On peut le regretter ; en fait elle eût été de trop. La joie de la première, avec sa belle progression sur ánima mea et sur le salutári meo, suffit à la louange contemplative en extase éternelle devant son Dieu et son Sauveur. Et son humilité est splendidement glorifiée sur les motifs exaltants de veníte et de audíte, dans l’original. La discrétion, l’intimité qui caractérisent le quanta fecit ánimæ meæ dans le Jubiláte viennent ici sur fecit mihi magna ; l’idée est la même et la mélodie devenue intérieure, enveloppe de mystère cette opération du Seigneur dans l’âme de sa chère petite Sainte.
► Communion : Circumdúxit
« Je ne suis pas un guerrier qui combat avec des armes terrestres, mais avec le glaive de l’esprit qui est la parole de Dieu. Aussi la maladie n’a pu m’abattre…Je l’ai dit : je mourrai les armes à la main ». Ses paroles au cours de son agonie résument toute l’ardeur combative et toujours dans l’humilité : « Oui… il me semble que je n’ai jamais cherché que la Vérité… Oui, j’ai compris l’humilité du cœur ». Thérèse avait vaincu, et sereinement, après de longues et interminables souffrances, elle rendit son âme à Dieu. Elle avait vingt-quatre ans. C’était le 30 septembre 1897.
Circumdúxit eam, et dócuit : et custodívit quasi pupíllam óculi sui. Sicut aquila expándit alas suas, et assúmpsit eam, atque portávit in húmeris suis. Dóminus solus dux eius fuit.
Il l’a entouré et a pris soin d’elle : il l’a gardée comme la prunelle de ses yeux. Comme l’aigle il a déployé ses ailes, l’a enlevée et emportée sur ses épaules. Le Seigneur seul fut son guide.
C’est Moïse qui chantait ainsi, au peuple réuni, ce que Dieu avait fait pour lui au cours de son histoire. Chant suprême d’action de grâces après lequel il mourut.
L’Église n’a eu qu’à mettre les pronoms au féminin pour l’appliquer à sainte Thérèse et lui faire évoquer ce qu’elle a écrit de plus profond et de plus ardent : « Sans se montrer, sans faire entendre sa voix, il m’instruit dans le secret… Je suis destinée à devenir la proie de l’Aigle divin… » écrit-elle dans « Histoire d’une âme ».
Et si l’on pense que c’est dans l’Eucharistie et par l’Eucharistie que se sont faits cette éducation, cette direction, cet envol ; si nous nous remettons en mémoire le récit qu’elle nous a fait de sa première communion : « Ah ! qu’il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme ! Oui, ce fut un baiser d’amour !… » et que nous songions à ce que toutes ses autres communions ont ajouté à cette fusion, à cette fusion qui s’achève maintenant dans « l’éternelle communion de la patrie » ; alors, quelle évocation splendide que le chant sur lequel s’achève la messe de sa fête !
L’original est la communion Pópulus acquisitiónis du jeudi de la semaine de Pâques. Le calque n’est pas serré et pour adapter la mélodie à la longueur du texte, on a dû ajouter la dernière phrase de la communion Vox in Rama des Saints Innocents.