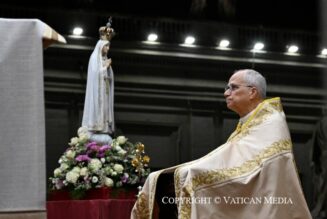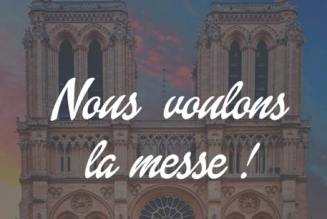Près de six mois après son élection sur le trône de Pierre, le Pape Léon XIV effectuera son premier déplacement hors d’Italie, en Turquie, du jeudi 27 au dimanche 30 novembre prochain, jour de la saint André, patron de l’Église grecque-orthodoxe.
La visite apostolique sera concentrée à Iznik, ville du premier concile œcuménique de Nicée en 325, située à 130 km d’Istanbul. Ce voyage en commémoration du 1700e anniversaire du concile avait été évoqué à de multiples reprises par le Pape François, puis par Léon XIV lui-même.
Le 7 juin dernier, l’évêque de Rome, recevant les participants à un symposium sur Nicée, affirmait que ce grand événement de l’histoire chrétienne n’était pas « un événement du passé », mais « une boussole » qui doit continuer « à guider vers la pleine unité visible des chrétiens ».
Jusqu’à ce jour, aucun Pape de l’histoire contemporaine ne s’est rendu à Nicée. Jean-Paul II était allé en Turquie la première année de son pontificat, en 1979, également aux alentours de la saint André. Il s’était rendu à Ankara, Istanbul, Ephèse et Izmir. Benoît XVI avait visité la Turquie du 28 novembre au 1er décembre 2008 et François en novembre 2014.
Ensuite, le Souverain pontife américain accomplira un voyage au Liban, du dimanche 30 novembre au mardi 2 décembre, répondant ainsi à l’invitation du chef de l’État et des autorités ecclésiastiques. Le 4 août dernier, Léon XIV s’adressait pour la première fois spécifiquement aux fidèles du Liban à l’occasion des cinq ans du drame survenu dans le port de Beyrouth. 235 personnes y avaient péri, plus de 6 500 avaient été blessées. Il apportait toute sa proximité spirituelle et sa compassion au peuple libanais dont il avait reçu le président maronite, Joseph Aoun, le 13 juin dernier. Le Pape avait également lancé un appel à la fin des violences au Liban lors du Jubilé des Églises orientales, le 14 mai dernier.
Pour Mgr Hugues de Woillemont, directeur de L’Œuvre d’Orient,
Le pape Léon est un pape qui se distingue par son écoute, par sa profondeur spirituelle, par sa présence à l’autre, mais aussi par sa connaissance rigoureuse des dossiers. Le choix de ce premier voyage est surprenant, tout comme l’arrivée de ce pape était une surprise. Les cardinaux et l’Esprit Saint ont fait le choix de cet homme qui associe beaucoup d’éléments qu’on voudrait opposer, mais qui trouve en lui une unité : il est américain mais a vécu en Amérique latine, il est diocésain et religieux, spirituel et théologien…
Le dernier voyage d’un pape au Liban remonte à 2012, lorsque Benoit XVI s’y était rendu, et à 2014 pour la Turquie, voyage effectué par le pape François. Choisir ces pays pour un premier voyage apostolique est un choix très fort, pour les habitants de ces pays évidemment, mais pour L’Œuvre d’Orient aussi. L’Œuvre d’Orient est en effet née au Liban par la volonté de deux universitaires laïcs et d’un prêtre, avec l’idée de soutenir les écoles au Moyen-Orient. Ce voyage est donc pour L’Œuvre d’Orient, pour la Turquie et le Liban une chance et une grâce. Le pape y va d’abord comme pèlerin de la paix, pour conforter la foi des croyants, mais aussi en tant que chef d’État pour porter un message.
En Turquie, ce voyage revêt une importante dimension œcuménique, comme en témoigne la rencontre avec le patriarche Bartholomée 1er de Contantinople. Ces rencontres œcuméniques confortent ce qu’il y a de commun et de beau, mais manifestent aussi le chemin qu’il reste à faire sur le chemin d’une pleine communion. L’Œuvre d’Orient travaille aussi dans cette logique, en échangeant avec des responsables religieux, afin de montrer qu’une foi commune unit les catholiques et les orthodoxes. L’enjeu est de renforcer la présence chrétienne, même si elle est minoritaire, mais aussi de dialoguer avec l’islam. Le pape visitera la mosquée bleue à Istanbul et sera également accueilli par le président Erdogan. Il y a donc une dimension interreligieuse en plus de celle de soutien des chrétiens.
Le choix du Liban est un choix courageux du pape Léon XIV. Le pape Jean-Paul II avait qualifié le Liban de « message ». Le modèle multiconfessionnel du Liban est aujourd’hui extrêmement fragilisé par des logiques d’affrontement, même si le pays a aujourd’hui à sa tête un président et un premier ministre qui travaillent ensemble. Pour la population, les enjeux sont notamment économiques. Pour les chrétiens, un voyage apostolique est toujours un soutien moral et une invitation à la communion dans et entre les Églises. Venir au Liban, c’est aussi pour le Saint Père soutenir la coexistence et le dialogue interreligieux, encourager la stabilité politique et promouvoir la paix dans la région.
a) En Turquie
Jeudi 27 novembre : Le Pape arrivera à 12h30 à Ankara, puis visitera le mausolée de Mustafa Kemal Atatürk. Il se rendra ensuite au palais présidentiel pour une cérémonie de bienvenue qui sera suivie d’une rencontre présidentielle. À 15h30, il s’adressera aux autorités, à la société civile et au corps diplomatique pour le premier discours de son voyage. Il partira ensuite pour Istanbul.
Vendredi 28 novembre : Le pape rencontrera à 9h30 les évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses, et agents pastoraux à la cathédrale du Saint-Esprit d’Istanbul où il prononcera un deuxième discours, avant de visiter la maison d’accueil pour personnes âgées des Petites sœurs des Pauvres. Il partira ensuite pour Iznik où aura lieu une rencontre œcuménique de prière près des fouilles de la basilique Saint-Néophyte, lieu d’un nouveau discours. À son retour à Istanbul, il participera à une rencontre privée avec les évêques.
Samedi 29 novembre : Le pape visitera la mosquée Sultan Ahmet, ou mosquée Bleue, l’un des plus célèbres monuments ottomans, puis rencontrera les chefs des Églises et des communautés chrétiennes à l’église syriaque orthodoxe Mor Ephrem. Il participera ensuite à une doxologie (prière œcuménique de louange à Dieu) à l’église patriarcale Saint-Georges avant de rencontrer le patriarche œcuménique Bartholomée au palais patriarcal, sur les rives du Bosphore. La signature d’une déclaration commune est annoncée. La journée se conclura par une messe à la Volkswagen Arena d’Istanbul.
Dimanche 30 novembre : Le Pape ira prier à la cathédrale apostolique arménienne puisse rendra à l’église patriarcale Saint-Georges pour une divine liturgie (discours du pape prévu), avant une bénédiction œcuménique et un déjeuner avec Bartholomée.
b) Au Liban
Dimanche 30 novembre : Le Pape arrivera à Beyrouth vers 15h et rencontrera les autorités libanaises au palais présidentiel. À 18 heures, il prononcera un discours adressé aux autorités, à la société civile et au corps diplomatique avant de se rendre à un dîner privé à la nonciature.
Lundi 1er décembre : Le Pape se rendra à Annaya au monastère Saint-Charbel, afin de prier sur la tombe du saint. Charbel Makhlouf, moine ermite maronite libanais canonisé en 1977, est une figure majeure du christianisme au Liban. Le Saint Père rencontrera ensuite les évêques, prêtres, religieux et agents pastoraux au sanctuaire Notre-Dame du Liban à Harissa, où il prononcera un discours. Il se rendra ensuite à la nonciature apostolique pour une rencontre privée avec les patriarches catholiques. Après cela, une rencontre inter-religieuse aura lieu place des Martyrs, puis un échange avec les jeunes au patriarcat maronite de Bkerké.
Mardi 2 décembre : Le Pape se rendra à l’hôpital psychiatrique des Franciscaines de la Croix à Jal el Dib pour y rencontrer les sœurs. Il ira ensuite se recueillir sur le site de l‘explosion du port de Beyrouth. Le voyage du Pape se clôturera par une messe sur le front de mer à Beyrouth.
3 LE VOYAGE EN TURQUIE
a) Informations générales
Pays de 84 millions d’habitants, doté d’une population jeune et urbanisée, la Turquie est la 19ème puissance économique mondiale. Située au carrefour de l’Asie, du Moyen-Orient et de l’Europe, elle bénéficie d’une position stratégique. Sa croissance économique, très rapide au début des années 2000, s’essouffle depuis quelques années. Président de la République depuis 2014, Recep Tayyip Erdoğan a été réélu en mai 2023 pour cinq ans. L’alliance gouvernementale rassemblant le parti du président, l’AKP, et ses alliés du MHP dispose d’une majorité absolue à la Grande Assemblée nationale. Le principal parti d’opposition est aujourd’hui à la tête des 5 provinces les plus peuplées (Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Antalya). Avant la crise sanitaire, les tensions politiques et la crise syrienne avaient déjà affecté la Turquie et réduit sa capacité d’attraction des touristes et des investissements internationaux. Les séismes du 6 février 2023 dans le sud-est du pays ont fait plus de 56 000 victimes et plus de 3,3 millions de déplacés. Environ 650 000 logements ont été détruits et,selon les autorités turques, le PNUD et la Banque mondiale, le coût de la reconstruction s’élèverait à 103,5 Mds$.
b) Les Églises en Turquie
Aujourd’hui, la Turquie compte environ 100 000 chrétiens sur 84 millions d’habitants. Le reste de la population est en grande majorité musulmane sunnite. Parmi les chrétiens, tous n’ont pas le même statut : les ressortissants de la République de Turquie, arméniens et grecs, bénéficient des droits des minorités accordés par le traité de Lausanne de 1923 et ont leurs propres écoles et leur propre patriarche ; les chaldéens n’ont pas les mêmes droits, mais leur nombre croît du fait de l’immigration des chrétiens venus d’Irak, qui transitent par Istanbul en attendant de partir en Europe ou en Amérique ; s’ajoutent aussi les descendants des chrétiens latins qui ont gardé leur confession catholique ainsi que les expatriés. En se rendant en Turquie en 2014, le pape François avait rappelé au président turc Erdogan son devoir de protéger la liberté religieuse en accordant « les mêmes droits » à tous les citoyens, quelle que soit leur confession.
c) Les enjeux
« Ce voyage avait été initié par le pape François, qui aurait dû se rendre en Turquie pour commémorer les 1700 ans du Concile de Nicée et rencontrer les patriarches des différentes Églises. Si la question s’est posée de réunir les patriarches sans le pape pour cet anniversaire, il a rapidement été décidé que cette commémoration n’aurait pas de sens sans la présence du pape. Léon XIV a ensuite choisi de maintenir le voyage, qui sera donc son premier voyage pontifical. En Turquie, les chrétiens ne sont pas minoritaires, ils sont ultra-minoritaires. Ils représentent environ 0,2 % de la population. Pourtant, ce pays a été particulièrement important dans l’histoire de la foi chrétienne, notamment car c’est ici que se sont tenus deux conciles majeurs : celui de Nicée et celui de Chalcédoine. Cette situation d’ultra-minorité favorise le dialogue et l’œcuménisme entre les différentes communautés chrétiennes en Turquie. Ce n’est pas un œcuménisme de façade, mais un œcuménisme qui se vit au quotidien, par une vraie fraternité.
Par ce voyage du Pape, les chrétiens espèrent se sentir reconnus et encouragés dans leur présence en Turquie, et entendre qu’ils comptent aux yeux de l’Église, malgré leur petit nombre. On parle beaucoup les concernant de « pastorale de présence », et ils espèrent que cette visite rappellera l’importance de leur simple présence dans le pays. Le Concile de Nicée est le premier concile œcuménique. Il est particulièrement important car il est à l’origine du credo. Le credo est en effet un élément fondateur de l’œcuménisme, car il est le même pour tous les chrétiens. Toute l’année, des pèlerins se sont déjà rendus dans la ville d’Iznik pour commémorer cet événement. » Propos recueillis auprès du frère Milad Yacoub, frère assomptionniste à Istanbul
4 LE VOYAGE AU LIBAN
a) Informations générales
Petit pays de 5,8 millions d’habitants au cœur du Moyen-Orient, le Liban est une République parlementaire qui prévoit la répartition du pouvoir entre les différentes religions. Le président de la
République est chrétien maronite, le président du Conseil des ministres est sunnite et le président du Parlement chiite. Le chef de l’État est M. Joseph Aoun (depuis janvier 2025), le président du conseil des ministres M. Nawaf Salam et le président du parlement M. Nabih Berry (depuis 1992). Au sein de l’Assemblée nationale, les sièges sont répartis à parité sur une base confessionnelle (64 chrétiens, 64 musulmans).
Le pays fait actuellement face à de multiples chocs. À la crise socio-économique et financière, dont les premiers effets se sont fait ressentir dès 2019, se sont ajoutées les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19, de l’explosion survenue sur le port de Beyrouth le 4 août 2020 et du conflit armé de 2024. Le dysfonctionnement des services publics met en péril les acquis du développement et creuse les disparités socio-économiques.
b) Les Églises au Liban
L’État libanais reconnaît 12 Églises sur son territoire. En 2025, la présence chrétienne est estimée à environ un tiers de la population, alors qu’elle en représentait 51,2 % lors du dernier recensement officiel de 1932. Démographiquement, les maronites sont les plus nombreux. Ils sont suivis par les grecs orthodoxes et les grecs catholiques.
Les Églises catholiques :
• L’Église maronite – siège patriarcal à Bkerké (Liban)
• L’Église grecque melkite catholique – siège patriarcal à Damas (Syrie) et à Raboué (Liban)
• L’Église arménienne catholique – siège patriarcal à Beyrouth (Liban)
• L’Église syriaque catholique – siège patriarcal à Beyrouth (Liban)
• L’Église chaldéenne – siège patriarcal à Bagdad (Irak)
• L’Église latine
Les Églises orthodoxes :
• L’Église grecque orthodoxe d’Antioche – siège patriarcal à Damas (Syrie)
• L’Église arménienne orthodoxe – siège patriarcal à Antelias (Liban)
• L’Église syriaque orthodoxe – siège patriarcal à Damas (Syrie)
• L’Église assyrienne – siège patriarcal à Erbil (Irak)
• L’Église copte orthodoxe – siège patriarcal au Caire (Égypte)
Les Églises protestantes :
Peu nombreux, les protestants appartiennent à plusieurs obédiences au Liban, comme les évangéliques, les baptistes, les épiscopaliens, les anglicans, etc.
c) Le rapport « Impayés de l’État libanais envers les institutions non-étatiques à but non-lucratif »
À l’occasion de la Journée mondiale des Pauvres, L’Œuvre d’Orient a rendu public lors d’une conférence de presse un rapport inédit sur les impayés de l’État libanais envers les associations et les établissements privés à but non-lucratif dont 70 % appartiennent aux Églises locales. Ce préjudice, évalué à 150 millions de dollars, concerne 254 établissements, écoles semi-gratuites,
orphelinats, hôpitaux, centres pour personnes handicapées et maisons pour personnes âgées – et affecte chaque année près de 150 000 personnes vulnérables au Liban. Cette initiative unique, qui s’appuie sur une cartographie et des données chiffrées encore jamais publiées, est le fruit d’une participation exceptionnelle d’établissements de plusieurs confessions qui rendent tous une mission de service public au Liban : associations laïques, institutions religieuses chrétiennes et sociétés de bienfaisance druze, sunnite et chiite. Ce rapport met en lumière le rôle central de service public que jouent ces établissements au Liban, dont l’abandon de la part de l’État menace la pérennité et la prise en charge de centaines de milliers de Libanais. C’est le cas en particulier de l’hôpital psychiatrique des sœurs franciscaines de la Croix que le Saint Père va visiter lors de son voyage.
d) La reconstruction du pays : un convalescent sur le chemin d’une vraie guérison ?
« Le Liban a un président après deux ans de paralysie, et un accord a mis fin à la guerre lancée par Israël. Mais Joseph Aoun est sous surveillance. Notamment du Parti de Dieu, qui, même s’il n’est plus l’État dans l’État qu’il était, est loin d’être mort. L’environnement reste explosif, des territoires palestiniens à la Syrie. À l’automne, après des mois d’escalade de part et d’autre, Benjamin Netanyahou déclenchait contre le Hezbollah une offensive terrestre et aérienne au Sud-Liban, bombardant des villages d‘où les habitants musulmans mais aussi chrétiens fuyaient en masse. Puis il cibla la banlieue sud de Beyrouth, tuant le chef charismatique du mouvement chiite, Hassan Nasrallah. Des frappes meurtrières touchaient d’autres régions où Israël soupçonnait des positions du Parti de Dieu. Les déplacés étaient accueillis à Beyrouth et ailleurs, parfois dans un net climat de tension, parfois aussi dans une belle solidarité. Sous pression franco-américaine, une trêve, jugée à l’avantage d’Israël, était finalement conclue fin novembre, prévoyant le retrait du Hezbollah de la zone frontalière et le déploiement de l’armée nationale.
L’électrochoc de cette offensive a contribué au sursaut politique majeur : élu début janvier par le parlement, Joseph Aoun, commandant de l’armée, homme respecté, a nommé premier ministre l’ancien président de la Cour internationale de justice (CIJ), Nawaf Salam. Ce juriste a choisi des ministres pour leurs compétences. Le Hezbollah n’a pas fait obstacle. Joseph Aoun a résumé le sentiment partagé par 90 % des Libanais : « la fatigue d’une guerre des autres chez nous ». Les défis du président sont énormes, tant sécuritaires qu’économiques : relancer un pays gangréné par la corruption. Avec la livre au plus bas, des avoirs bloqués, le nouvel essor espéré n’est pas encore réalité. Et il lui faut sécuriser la frontière nord avec la Syrie. Plus d’1,5 million de Syriens se trouvent encore au Liban, selon des évaluations concordantes. Le nombre de ceux arrivés après la chute de Bachar al-Assad et depuis les massacres des Alaouites équivaut au nombre de ceux retournés dans leur pays après la fin de la dictature, selon une source sécuritaire.
L’opinion serait plus divisée encore qu’après le conflit Hezbollah-Israël de 2006 : entre ceux du camp chrétien, heureux de la fin de l’interférence de l’Iran dans leur pays et de l’affaiblissement du mouvement chiite, et ceux qui jugent la paix en sursis ou bien illusoire. « Il est temps de repenser tout le système politique, abstraction faite des événements fortuits qui ne convergent vers aucune ouverture, qu’il s’agisse de l’élection présidentielle, de l’affaiblissement du parti chiite – qui se reconstruit à l’ombre des compromis libanais – ou des plans de redressement économique. », estime ainsi le philosophe Mouchir Aoun. Alors que Tsahal a gardé cinq positions près de la frontière et, violant l’accord de trêve, a continué à mener des frappes, le Hezbollah aura globalement effectué son retrait au nord du fleuve Litani et l’armée aura pu se déployer au sud, conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité, votée en 2006.
Coupé le cordon ombilical (armes, gardiens de la révolution…) qui le reliait à Téhéran du fait du renversement d’Assad en Syrie, le Hezbollah se trouve très nettement affaibli militairement. Mais les obsèques, le 23 février, de Hassan Nasrallah ont été suivies par une immense foule de chiites pleurant leur « sayyed ». Son « martyr » a une dimension mystique. Son successeur, Naïm Qassem, a délivré ce message : « la résistance n’est pas terminée ». Des miliciens ont bloqué ce même mois la route de l’aéroport pour protester contre l’interdiction, à la suite d’une menace de bombardement israélien, de l’atterrissage d’avions venant de Téhéran.
La double gageure militaire de Joseph Aoun est que l’armée récupère les stocks d’armes et intègre les miliciens du Hezbollah. Le camp chrétien des Forces libanaises fait pression, demandant un calendrier précis. Le président doit manœuvrer habilement et ménager le mouvement chiite, qui, déjà contraint d’évacuer ses armes de la zone frontalière avec Israël, est réticent à les rendre à l’échelle nationale. L’entrée en fonctions de Donald Trump a été perçue favorablement par une bonne partie des chrétiens. Son administration est intervenue pour que l’accord de novembre soit mieux appliqué. Son conseiller pour le Moyen-Orient n’est autre que l’Américano-Libanais Massad Boulos, beau-père de sa fille Tiffany ! Pour certains Libanais, Trump peut sauver leur Liban multiconfessionnel et son identité chrétienne, et Netanyahou, ami de Trump, a fait œuvre utile en écrasant l’ennemi intérieur. Le but ultime du président américain serait que le Liban normalise ses relations avec Israël, en intégrant les « accords d’Abraham » lancés lors de son premier mandat (plusieurs pays arabes avaient normalisé leurs relations avec l’Etat
hébreu). Mais la question palestinienne, brûlot depuis soixante ans au Liban, reste le grand obstacle. Pour les Libanais musulmans et les quelque 400 000 Palestiniens réfugiés, l’accord du Front uni arabe de 2002 qui conditionnait une normalisation entre pays arabes et Israël à la création d’un État palestinien doit être respecté. « Si on essaie de forcer la main du Liban pour abandonner la cause palestinienne, cela pourrait créer de fortes tensions », redoute un Français résidant au Liban. Le Hezbollah pourrait cesser de soutenir la trêve, et une nouvelle guerre civile éclater avec l’armée, qui compte des chiites dans ses rangs. »
Article de Jean-Louis de la Vaissière, paru dans le bulletin de l’Œuvre d’Orient, n°819
Source : L’Oeuvre d’Orient