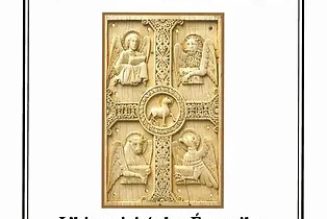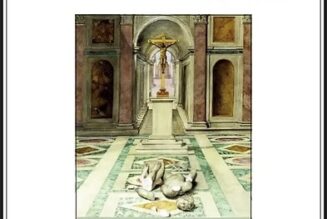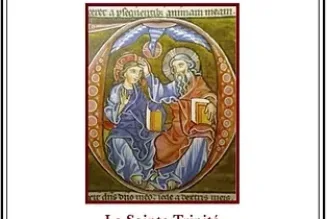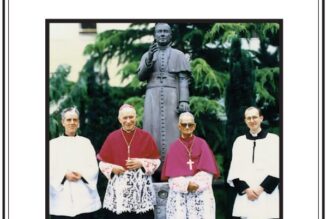A l’heure où l’on célèbre les 800 ans de la naissance de Saint Thomas d’Aquin (1225-1274), il est important de rappeler l’importance de la théologie naturelle ou théologie philosophique ou théodicée. Il s’agit de «la science de Dieu, acquise à la lumière de la raison» (Cf. Farges, A. et Barbedette, D., «Cours de philosophie scolastique», T. II, Berche et Tralin Libraires, Paris, 1905, p. 241). Cette science s’acquiert, entre autres, grâce à l’observation de la nature qui nous conduit à l’affirmation de l’existence de Dieu. Et malheureusement, pour diverses raisons que nous verrons plus loin, cette science a été délaissée durant ces dernières décennies par une bonne partie des catholiques.
Et pourtant l’Église reconnaît la capacité de l’homme à connaître Dieu grâce à raison naturelle. Dans le §36 du Catéchisme on lit :
«” La Sainte Église, notre mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toutes choses, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées ” (Cc. Vatican I : DS 3004 ; cf. 3026 ; DV 6). Sans cette capacité, l’homme ne pourrait accueillir la révélation de Dieu. L’homme a cette capacité parce qu’il est créé ” à l’image de Dieu ” (Gn 1, 27). «
Cet enseignement du Catéchisme a des liens avec ce qu’écrivaient déjà Saint Paul et Saint Augustin. Le §32 du Catéchisme nous enseigne :
«Le monde : A partir du mouvement et du devenir, de la contingence, de l’ordre et de la beauté du monde, on peut connaître Dieu comme origine et fin de l’univers.
S. Paul affirme au sujet des païens : ” Ce qu’on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste : Dieu en effet le leur a manifesté. Ce qu’il y a d’invisible depuis la création du monde se laisse voir à l’intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité ” (Rm 1, 19-20 ; cf. Ac 14, 15. 17 ; 17, 27-28 ; Sg 13, 1-9).
Et S. Augustin : ” Interroge la beauté de la terre, interroge la beauté de la mer, interroge la beauté de l’air qui se dilate et se diffuse, interroge la beauté du ciel (…) interroge toutes ces réalités. Toutes te répondent : Vois, nous sommes belles. Leur beauté est une profession (confessio). Ces beautés sujettes au changement, qui les a faites sinon le Beau (Pulcher), non sujet au changement ? ” (Serm. 241, 2 : PL 38, 1134).
«A cours des siècles, la théologie naturelle s’est beaucoup développée, notamment grâce aux apports de Saint Thomas d’Aquin dans sa «Somme contre les Gentils» et sa «Somme Théologique». Et pendant des siècles son enseignement a été transmis aux prêtres et laïcs, surtout dans les universités.
Suite à des événements comme la Révolution Française, la théologie naturelle n’a plus été enseignée dans les universités laïques. Elle s’est maintenue dans les universités et instituts catholiques. Cet enseignement était obligatoire pour les prêtres et théologiens jusqu’au Concile Vatican II.
Or, il y a eu un malentendu suite au Concile Vatican II. Quoiqu’il y avait plus de liberté après, cela ne voulait pas dire qu’il fallait abandonner complètement l’enseignement de Saint Thomas d’Aquin. D’ailleurs la déclaration «Optatam Totius» sur la formation des prêtres rappelait que pour la théologie il fallait continuer avec «Saint Thomas pour maître» (§16). Et pour Saint Thomas d’Aquin la théologie naturelle était très importante.
Et Saint Jean-Paul II rappelait cela dans «Fides et Ratio», §61 :
«Si, en diverses circonstances, il a été nécessaire d’intervenir sur ce thème, en réaffirmant aussi la valeur des intuitions du Docteur Angélique et en insistant sur l’assimilation de sa pensée, cela a souvent été lié au fait que les directives du Magistère n’ont pas toujours été observées avec la disponibilité souhaitée. Dans beaucoup d’écoles catholiques, au cours des années qui suivirent le Concile Vatican II, on a pu remarquer à ce sujet un certain étiolement dû à une estime moindre, non seulement de la philosophie scolastique, mais plus généralement de l’étude même de la philosophie. Avec étonnement et à regret, je dois constater qu’un certain nombre de théologiens partagent ce désintérêt pour l’étude de la philosophie. «
La situation est telle qu’actuellement beaucoup de prêtres et théologiens n’ont pas beaucoup étudié la philosophie naturelle, qui est importante pour donner des raisons de notre espérance, comme l’écrivait Saint Pierre dans sa première épître (1P 3:15, Bible de Jérusalem) : «Au contraire, sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ, toujours prêts à la défense contre quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous.». Et comme ils ne l’ont pas beaucoup étudiée, beaucoup ne vont justement pas l’encourager auprès des laïcs.
Par contre, comme beaucoup l’ont remarqué, la philosophie naturelle a été beaucoup étudiée par des philosophes qui se sont spécialisés en philosophie médiévale ou qui ont beaucoup étudié l’oeuvre de Saint Thomas d’Aquin, en suivant toutes les parties nécessaires à sa compréhension : logique, cosmologie, psychologie, métaphysique, etc.
En ces temps où beaucoup demandent des raisons de notre espérance, il est important que les laïcs s’intéressent à la théologie naturelle comme le demande la Bible et le Catéchisme. Pour cela ils doivent s’adresser aux prêtres qui ont étudié la philosophie de Saint Thomas d’Aquin, ou aux laïcs qui l’ont étudiée.
Jaime V. Torres-Heredia Julca
Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.