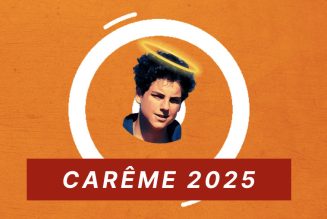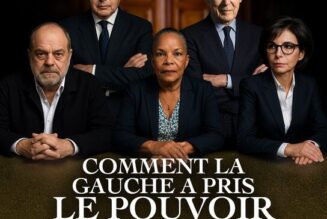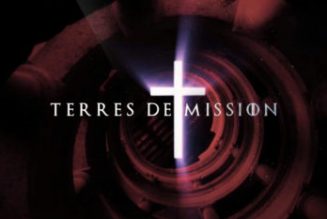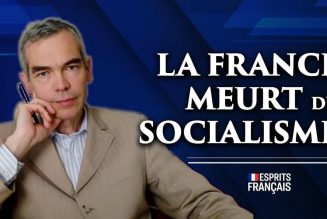Le chant de l’évangile est une cérémonie particulièrement développée à la messe solennelle. Les rites qui l’accompagnent soulignent l’importance que l’Église accorde à la parole du divin Maître et disposent à la révérence envers celle-ci.
1. Le livre est déposé sur l’autel
En premier lieu, le diacre dépose sur l’autel le livre des évangiles. C’est le premier geste de révérence à l’égard des saints évangiles, dont le livre sera ensuite porté en procession, salué, encensé et marqué d’une croix par le diacre, baisé par le prêtre. Ces gestes participent d’un culte d’adoration relatif à l’égard du livre des évangiles, semblable à celui que nous pouvons avoir à l’égard des images de Notre-Seigneur ou des représentations de la Croix[1]. À travers le livre des évangiles, c’est le Christ que nous adorons :
[…] l’évangile n’est pas seulement un enseignement, qu’il n’est pas seulement le point culminant de la partie de l’avant-messe affectée à l’enseignement ; il est plus encore : c’est un acte d’hommage envers le Christ, la liturgie voyant dans l’Évangile le Christ en personne[2].
En l’occurrence, seul le livre des évangiles peut reposer au centre de l’autel qui, en dehors de là, ne porte que les oblats ou le Saint-Sacrements lui-même.
2. Le diacre demande et reçoit la bénédiction du prêtre
Il appartient au diacre de chanter l’évangile. Cette fonction lui est réservée depuis le IVesiècle. Auparavant, il fait remplir l’encensoir par le prêtre, puis récite à genoux la prière Munda cor :
Purifiez mon cœur et mes lèvres, Dieu tout-puissant qui avez purifié les lèvres du prophète Isaïe avec un charbon ardent. Daignez par votre miséricordieuse bonté me purifier pour que je sois capable de proclamer dignement votre saint Évangile. Par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il[3].
En effet :
Le cœur et les lèvres de celui qui va annoncer la parole de Dieu doivent être purs, comme Dieu lui-même l’a fait comprendre à son messager Isaïe[4], quand le Séraphin toucha ses lèvres avec le charbon ardent ; non seulement les lèvres, qui doivent prononcer la parole sainte, mais aussi le cœur, puisqu’il ne s’agit pas d’une récitation mécanique, mais d’une proclamation portée par l’Esprit, remplie de l’Esprit, et puisque le messager de la bonne nouvelle […] doit d’abord la recevoir dans son propre cœur avant de la publier devant la communauté[5].
Ayant pris le livre des évangiles sur l’autel, il s’agenouille de nouveau et demande au prêtre sa bénédiction :
« Père, daignez me bénir. »[6]
À quoi le prêtre répond :
« Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres pour que tu proclames son Évangile d’une manière correcte et digne. Au nom du Père, et du Fils, + et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. »[7]
Le diacre baise alors la main du prêtre qui vient de le bénir.
Lorsque le prêtre doit lire lui-même l’évangile, il s’incline profondément devant l’autel et récite les mêmes prières, en demandant toutefois la bénédiction à Dieu directement[8].
3. Procession
La procession se met alors en place : en tête les acolytes, portant leurs chandeliers allumés, puis le cérémoniaire et le thuriféraire, dont l’encensoir est fumant, enfin le sous-diacre, puis le diacre, portant le livre des évangiles. Ce cortège solennel forme l’image du cortège triomphal du Christ[9].
[…] le port de lumières devant l’évangile correspond à une antique coutume, commune à tous les chrétiens[10].
Pour saint Jérôme, si l’on allume des lumières quand l’évangile va être lu, même en plein jour, c’est une manière d’exprimer la joie[11]. On remarquera d’ailleurs que les cierges allumés ne sont pas portés à l’évangile pour les messes des défunts.
Il s’agit également d’un honneur rendu au livre des évangiles, ce que suggère un rapprochement avec un rite semblable qui existait dans le cérémonial civil romain :
Le liber mandatorum [livre d’instructions], qui contenait les prérogatives conférées par l’empereur au praefectus praetrorio [préfet du prétoire], est déposé dans la salle du tribunal [prétoire] sur une table couverte d’un tapis entre deux cierges allumés[12].
Les honneurs de la lumière et de l’encens portés devant le livre des évangiles s’apparentent aussi à ceux que l’on rendait aux hauts dignitaires de l’État romain, puis, à partir de Constantin, aux dignitaires de l’Église pour leurs interventions solennelles. Ainsi :
[…] dans l’évangéliaire qui contient la parole du Christ, c’est le Christ lui-même que l’on veut honorer, son entrée que l’on veut solenniser[13].
4. Orientation
La procession se dirige vers la gauche du chœur et s’arrête face au nord. Cette orientation est symbolique.
D’après saint Rémi d’Auxerre (+ 908) : « … le Nord est la région du diable auquel il faut opposer la parole de Dieu[14].
Pour saint Yves de Chartres (+ vers 1117) : « … l’Évangile est annoncé contre le paganisme, représenté par le nord de la terre où la froidure de l’infidélité a régné si longtemps[15].
Saint Yves de Chartres attache aussi une signification au passage du côté droit au côté gauche pour lire l’évangile : « il représente la prédication de la foi passant des Juifs aux païens[16].
Ce passage est également présent lorsque le prêtre chante ou lit lui-même l’évangile : un servant déplace alors le missel de la droite vers la gauche de l’autel (ce que fait également le sous-diacre à la messe solennelle) et le prêtre se tient, non pas face à l’autel mais de biais, pour faire face au nord. C’est la même position qu’il adoptera pour le dernier évangile.
5. Acclamations, signes de croix et encensement
Le diacre interpelle d’abord les fidèles : « Dominus vobiscum. » Puis il annonce l’évangile : « Suite du saint évangile de selon saint… »[17]. Ce faisant il signe le livre d’une croix, à l’endroit du titre de l’évangile, puis se signe lui-même sur le front, sur les lèvres et sur le cœur, geste que reproduisent tous les assistants.
Ces signes de croix appellent évidemment la bénédiction divine, mais. En effet, « le désir de recueillir la parole sacrée et d’en retenir la bénédiction […] a trouvé une expression durable dans […] le signe de la croix »[18]. Il faut peut-être trouver « le sens originel de [ces] croix tracées sur eux-mêmes par les fidèles […] dans le texte de l’Évangile souvent cité à ce propos sur le malin ennemi, qui voudrait enlever du cœur des auditeurs la semence de la parole de Dieu[19] »[20].
Les signes de croix constituent également une profession de foi :
[…] on y voit la disposition à confesser franchement sa foi dans le sens de la parole de saint Paul : “Je ne rougis pas de l’Évangile.”[21] C’est bien en ce sens que de la croix sur le front est sorti le triple signe de croix et la croix sur le livre : nous voulons, le front haut, nous porter garants de la parole que nous a apportée le Christ et qui est consignée dans ce livre, la confesser de bouche et surtout la conserver fidèlement dans le cœur[22].
Un ancien missel proposait cette prière à réciter en même temps que l’on se signait :
Seigneur, par le signe de la croix vivifiante, protégez tous mes sens, pour entendre les paroles du saint évangile, les croire avec le cœur et les accomplir par les œuvres[23].
À l’annonce de l’évangile, on répond : « Gloria tibi Domine. Gloire à vous Seigneur », ce qui confirme que c’est bien, dans l’évangile, le Christ lui-même qu’on veut honorer. Le diacre encense d’ailleurs le livre des évangiles d’autant de coups que le Saint-Sacrement sera encensé à l’élévation (trois coups doubles). Il en sera de même de la réponse des servants à la fin de l’évangile : « Laus tibi, Christe. Louange à vous, ô Christ. »
Dès ce moment, tous, y compris le prêtre demeuré à l’autel, se tournent vers le livre des évangiles. On se tient debout pour entendre l’évangile. Cet usage, attesté depuis le IVesiècle, est une marque de respect supplémentaire.
6. Baiser de l’évangéliaire
Le chant de l’évangile étant achevé, le sous-diacre, qui soutenait le livre le porte au prêtre, qui l’honore d’un baiser. On remarquera d’ailleurs que le sous-diacre ne s’arrête pas devant le tabernacle ou la croix d’autel pour faire la génuflexion, car il porte le livre des évangiles ouvert. En baisant le livre, le prêtre dit :
Que par les paroles évangéliques, nos péchés soient effacés[24].
Puis le prêtre est lui-même encensé. Ces deux rites qui concluent la proclamation de l’évangile manifestent le désir de recueillir la parole sacrée et d’en retenir la bénédiction.
7. Distribution
Quant au choix des textes, il est remarquable que « pour les évangiles […], la distribution des lectures dans la liturgie romaine au début du Moyen Âge […] concorde presque complètement avec l’ordonnance actuelle, pour autant qu’il s’agit de part et d’autre des mêmes fêtes liturgiques[25]. »
En effet, à de rares exceptions près, les évangiles du propre du temps, c’est-à-dire des dimanches, des fêtes principales de l’année liturgique et des féries [jours de semaine] du Carême que l’on trouve aujourd’hui dans le missel correspondent exactement à ceux que donne un manuscrit du VIIIe siècle, reproduisant les usages liturgiques du VIIesiècle[26].
C’est donc une vénérable tradition de près de treize siècles que perpétue le missel :
[…] chaque année aux mêmes jours l’Église, par la voix de ses diacres, forme ses enfants aux mêmes enseignements évangéliques. […]
Si le pape saint Grégoire (+ 604) devait reparaître, il entendrait dans les innombrables cathédrales, églises et oratoire de l’ancien et du nouveau monde les mêmes évangiles qui retentissaient de son temps à la messe pontificale dans les basiliques romaines[27].