C’est un avis du CCNE (Comité consultatif national d’éthique) qui date du mois d’avril, mais il annonce la tenue au premier semestre 2026 d’un thème des Etats généraux de la bioéthique :
Face à la diminution du taux de naissance et à l’augmentation des situations d’infertilité, le Comité Consultatif National d’Éthique pour les sciences de la vie et de la santé (C.C.N.E.) publie ce jour son Avis n°149. Cet avis, entrepris à la suite d’une saisine par le Ministre délégué chargé de la santé et de la prévention, examine les déterminants multiples de ces phénomènes ainsi que leurs implications sociétales et éthiques.
L’Insee et les instituts de recherche spécialisés constatent un recul significatif du nombre de naissances en France : de 888 000 naissances en 1973 à 663 000 en 20241, avec un indicateur conjoncturel de fécondité désormais établi à 1,62 enfant par femme, bien en dessous du seuil de renouvellement des générations (2.05). Cette tendance s’inscrit dans un mouvement plus large observé dans de nombreux pays industrialisés. En France, cette dynamique est atténuée par des politiques familiales historiquement soutenues et un solde migratoire positif contribuant au renouvellement démographique.
Les causes de cette baisse des naissances sont multiples et leur évaluation reste complexe en raison du manque de données précises. Les données scientifiques mettent en évidence plusieurs facteurs contributifs, parmi lesquels l’impact de l’âge maternel, les modifications environnementales, l’exposition aux perturbateurs endocriniens, la progression de certaines pathologies métaboliques, et la mise en évidence de facteurs génétiques. À ces facteurs s’ajoute une diminution de la fécondité liée à des dimensions socio-économiques, culturelles et sociétales, ainsi qu’un questionnement grandissant sur la parentalité voire un réel non-désir d’enfant.
« Les études épidémiologiques convergent : la fertilité humaine est un indicateur biologique sensible aux transformations de notre environnement et de nos modes de vie. Il est essentiel d’intensifier les recherches pour mieux comprendre les mécanismes et adapter les stratégies de prévention et de prise en charge » – Joëlle Belaïsch-Allart, médecin gynécologue obstétricienne, rapporteure de l’Avis 149 et membre du C.C.N.E.
L’avis met en exergue deux dynamiques distinctes. D’une part et majoritairement, l’évolution socio-économique et culturelle, qui retarde les projets parentaux en raison de la précarité des jeunes générations, de la transformation du rôle des femmes dans la société et des contraintes professionnelles. D’autre part, on observe une progression de l’infertilité aggravée par des facteurs environnementaux, biologiques et médicaux. Ces phénomènes sont accentués par un accès inégal aux techniques d’assistance médicale à la procréation (A.M.P.).
Le Comité insiste sur la nécessité d’aborder cette problématique sous l’angle du respect de l’autonomie individuelle tout en renforçant la solidarité collective.
« Le vieillissement accéléré de la population et la chute de la natalité questionnent notre modèle de société et exigent une réponse immédiate et adaptée » – Jean-François Delfraissy, Président du C.C.N.E.
Dans son Avis n°149, le Comité a fait le choix d’ouvrir sa réflexion sur la natalité en s’interrogeant sur la place de l’enfant dans la société actuelle, considérant qu’il n’est pas possible de questionner les différents enjeux relatifs à la procréation sans accorder prioritairement son attention à l’intérêt supérieur de l’enfant à venir. De même, le C.C.N.E. rappelle que si le choix d’avoir un enfant relève de la liberté de chacun, il est impératif que la société accompagne ceux qui rencontrent des difficultés à concrétiser ce projet. Par cet Avis le Comité souligne l’importance pour notre société de pouvoir conjuguer solidarité collective et respect de l’autonomie individuelle. Ainsi, et pour répondre à ces défis, il appelle à une action forte et coordonnée, articulée autour de plusieurs axes :
-
- Sensibilisation et éducation : renforcer l’information sur la fertilité et ses déterminants, notamment l’impact de l’âge sur la procréation.
- Réinvention des politiques publiques : faciliter la parentalité en repensant les dispositifs de soutien aux familles, notamment en matière de logement et de modes de garde.
- Amélioration de l’accès aux soins : garantir une prise en charge équitable et renforcée des parcours d’A.M.P.
- Engagement en faveur de la recherche : intensifier les études sociologiques afin d’analyser plus finement les déterminants de la baisse de la natalité, intensifier les études sur les différents type d’infertilité et la recherche en sciences humaines et sociales.
Le C.C.N.E. insiste sur la nécessité d’un débat éclairé, fondé sur les avancées scientifiques et respectueux des choix individuels. Il rappelle que la compréhension des dynamiques de la natalité et de la fertilité doit s’appuyer sur des travaux de recherche interdisciplinaires et sur une concertation large impliquant l’ensemble des acteurs concernés.
L’Avis complet est disponible sur le site du C.C.N.E.
Cet avis de 76 pages évoque l’avortement, à propos de l’information à donner sur la fertilité :
Une information spécifique doit être délivrée, de façon précoce, à l’égard des jeunes (lycéens, étudiants…), avec bienveillance et sans moralisation. Les formations à l’éducation sexuelle sont en effet insuffisantes : elles évoquent les enjeux relatifs à la contraception, les IVG, les maladies sexuellement transmissibles (MST), mais très rarement la santé reproductive.
La contraception est citée à plusieurs reprises comme l’une des causes du recul de la fécondité :
La transformation du rôle de la femme dans la société, le recul de l’âge de la maternité et l’augmentation du non-désir d’enfant : l’émancipation des femmes, rendue possible par des progrès sociaux comme l’accès à l’éducation, à la contraception et la participation croissante au marché du travail depuis les années 1970 a conduit à une diminution de l’importance accordée au mariage et à la maternité.
Par ailleurs, la diffusion de la contraception moderne et la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse ont contribué à ce report de l’âge de la maternité, en réduisant la fréquence des grossesses et des naissances non désirées, notamment aux âges jeunes
La France ne peut pas cumuler “en même temps” une politique de mort et une politique pro-vie…



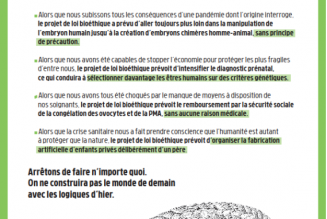

Montalte
Joëlle Belaisch, celle qui veut supprimer la clause de conscience… Et elle vient se plaindre qu’ils n’y ait plus d’enfants ?
MartinePichon
“le choix d’avoir un enfant relève de la liberté de chacun” : c’est bien ça le problème.
Avoir un enfant (des enfants) n’est pas un choix mais une évidence. C’est pourquoi, avant que le féminisme s’empare des cerveaux, les femmes comme les hommes, dès qu’ils avaient atteints leur majorité, songeaient à se marier et fonder une famille.
L’âge idéal pour avoir des enfants sans difficulté est entre 20 et 30 ans pour les femmes, 25 et 35 ans pour les hommes.