« Il est étrange de voir combien les hommes aiment mieux souffrir que changer leurs habitudes », écrivait Étienne de La Boétie dans son Discours de la servitude volontaire. Ce constat, vieux de cinq siècles, trouve un écho singulier dans la France contemporaine. Car si les enquêtes d’opinion indiquent qu’une majorité des Français partagent aujourd’hui des idées que l’on qualifiées de « droite » , attachement à l’autorité, valorisation du travail, souci des racines culturelles, inquiétude face à l’immigration massive, besoin de sécurité, rares sont ceux qui osent affirmer clairement ce positionnement.
Un paradoxe se dessine : une majorité silencieuse pense dans une direction mais vit comme si elle ne le pensait pas, par crainte du regard social. Comme si évoquer des idées de droite relevait d’une confession intime, presque honteuse. Le Français craint de faire sont « coming-out » personnel. Cette tension n’est pas anodine : elle révèle un déséquilibre profond dans la liberté du débat démocratique et dit quelque chose d’inquiétant sur l’état de notre civilisation.
Le philosophe Antonio Gramsci parlait « d’hégémonie culturelle ». C’est un concept développé par ce théoricien marxiste. Il part du postulat que la conquête du pouvoir présuppose celle de l’opinion publique. L’hégémonie culturelle désigne le pouvoir d’une minorité à imposer ses représentations du monde, ses mots, ses normes, de telle sorte qu’elles deviennent celles de tous. En France, cette hégémonie est depuis longtemps celle de la gauche intellectuelle et médiatique. Elle s’est construite sur l’après 68, s’est nourrie des luttes sociales et anticoloniales, et s’est institutionnalisée dans le champ culturel, éducatif, associatif.
Mais paradoxalement, au moment où la gauche a perdu une grande partie de ses bases populaires et s’est éloignée de ses promesses initiales (défense des classes laborieuses, exigence d’égalité réelle), son empreinte idéologique s’est incrustée. Cette continue d’imposer la pensée, le lexique, les limites de ce qui est audible et de ce qui ne l’est pas.
Résultat : affirmer certaines convictions, comme la nécessité d’une politique migratoire ferme, la défense d’un héritage civilisationnel judéo-chrétien, ou le refus du communautarisme, expose à l’accusation de racisme, voire de fascisme. Une accusation disqualifiante, qui suffit et sert souvent à clore tout débat.
C’est ici qu’intervient la dimension psychologique. De nombreux Français intériorisent une forme d’autocensure par peur des conséquences sociales. Un salarié redoute d’être marginalisé dans son entreprise, un commerçant craint de perdre des clients, un enseignant de susciter l’hostilité de ses élèves, de parents ou de ses collègues. Plus intime encore : l’individu craint de perdre ses amis, sa place dans un cercle familial ou amical.
La sociologie d’Erving Goffman sur la gestion de l’image et des stigmates est éclairante. Dans Stigmate, il montre comment certains individus, porteurs d’une identité perçue comme déviante, développent des stratégies de dissimulation pour éviter l’exclusion. Être « de droite », ou être perçu comme tel, fonctionne aujourd’hui parfois comme une identité stigmatisée, que l’on dissimule dans l’espace public.
Ce phénomène est accentué par ce que les psychologues appellent la « spirale du silence » théorisée par Elisabeth Noelle-Neumann. Lorsqu’une opinion semble minoritaire dans l’espace public, même si elle est majoritaire dans l’intime, les individus préfèrent se taire, renforçant ainsi l’impression d’isolement.
D’où l’analogie proposée : être de droite, en France, équivaut à vivre la difficulté à devoir faire son « coming-out ». Comme pour l’orientation sexuelle, il s’agit d’assumer une identité que la société stigmatise, mais qui constitue une part essentielle de soi. Le « coming-out » politique du Français implique de braver le risque de l’ostracisation, de la rupture sociale, parfois du harcèlement ou de la mise à l’écart professionnelle.
Hannah Arendt, dans La Condition de l’homme moderne, rappelle que la liberté ne se déploie véritablement que dans l’espace public, dans la parole partagée. Celui qui cache ses convictions vit en retrait de cette liberté, replié dans une forme de mutisme civique. Mais Arendt nous avertit aussi : dans des contextes de peur, les hommes se résignent facilement à la dissimulation, nourrissant un conformisme qui renforce le pouvoir d’une minorité prescriptrice.
Ainsi, une grande part des Français vivent cette tension : ils pensent d’une manière, parlent parfois autrement, et se taisent souvent. Comme si l’acte même d’assumer sa pensée relevait de l’héroïsme.
Ce paradoxe ne peut se comprendre sans évoquer l’évolution de la gauche française. En renonçant progressivement à certaines valeurs fondatrices, la souveraineté populaire, la protection des travailleurs face au libre-échange, elle a laissé un vide que la droite et ce quelle qualifie avec facilité d’extrême droite ont su occuper.
Aujourd’hui, la gauche s’est réfugiée dans un progressisme culturel, souvent urbain et minoritaire. C’est le règne de « boboland » qui tourne autour d’un nombril empreint de mépris de classe dans les actes mais surtout pas dans la pensée. Ces « élites » laissent sur le bord de la route une large partie de la population dont ils parlent parfois mais ignorent souvent.
C’est dans cet espace abandonné que s’installe une majorité d’opinions conservatrices, parfois même sans se dire de droite. Mais cette majorité, consciente de l’hégémonie culturelle d’une minorité, reste pourtant silencieuse.
Revenons à La Boétie. Sa réflexion sur la servitude volontaire, où les peuples acceptent leur asservissement parce qu’ils s’y accoutument, éclaire notre époque. Les Français qui pensent « à droite » mais n’osent pas le dire participent malgré eux à leur propre invisibilisation voire décivilisation. En ne s’exprimant pas, ils confortent l’illusion d’une minorité dominante qui croit parler au nom de tous.
Ce silence n’est pas neutre. Il engendre une démocratie appauvrie, où les débats se font caricaturaux, où les mots deviennent des armes et non des outils de compréhension, où la communication vaut acte. Ce silence renforce le sentiment de colère, voire de ressentiment, qui peut exploser brutalement lors des élections. Aujourd’hui, cette colère est contenue.
La question devient alors : comment briser ce cercle vicieux ? Comment faire en sorte que ceux qui pensent « à droite » puissent le dire sans craindre l’exclusion ?
Hannah Arendt, rappelle que la politique repose sur le courage d’apparaître. Il faut retrouver ce courage civique, non pas pour imposer un camp, mais pour restaurer une pluralité réelle du débat. De même, Alexis de Tocqueville observait que la démocratie américaine, pour fonctionner, devait s’appuyer sur des contre-pouvoirs et sur une liberté d’association qui permettait à chaque courant de s’exprimer. Sans cela, la démocratie se fige dans une illusion de pluralisme, alors qu’elle n’est qu’une uniformité imposée par la peur du jugement.
La France est aujourd’hui face à une énigme : un pays où la majorité des citoyens penchent vers des valeurs dites « de droite », mais où ces valeurs sont publiquement discréditées, ridiculisées ou soupçonnées. Ce paradoxe nourrit une société de faux-semblants.
Peut-être faudrait-il, comme pour d’autres causes jadis minoritaires, un « coming-out » collectif. Non pas pour imposer un dogme, mais pour assumer la diversité réelle des sensibilités, et rendre au débat public la richesse qu’il a perdue.
La Boétie nous a laissé cet avertissement : « Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libres. » Servir aujourd’hui, c’est se taire par peur. Se libérer, c’est parler. Mais la parole libre exige une société capable de l’entendre. Or, là réside le défi : reconstruire un espace où chacun puisse dire ce qu’il pense sans craindre pour son travail, ses amis ou son avenir. Nous en sommes encore loin et n’oublions pas que cette emprise culturelle est fondée sur un récit national tronqué. Rencontrons-nous au sein de cette majorité silencieuse, découvrons et assumons que nous faisons nombre, rétablissons notre récit national et ne négligeons pas notre identité qui font notre socle civilisationnel. Aujourd’hui la minorité gouverne et détient les postes clés. Bousculons le paradoxe : Osons notre « coming-out » et chassons des urnes la minorité.
La démocratie française est malade. Si elle veut rester vivante, elle doit relever ce défi. Sinon, notre pays court le risque de se dissoudre dans le silence de ses majorités et dans le vacarme de ses minorités.
In Ira Veritas, Septembre 2025
Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.

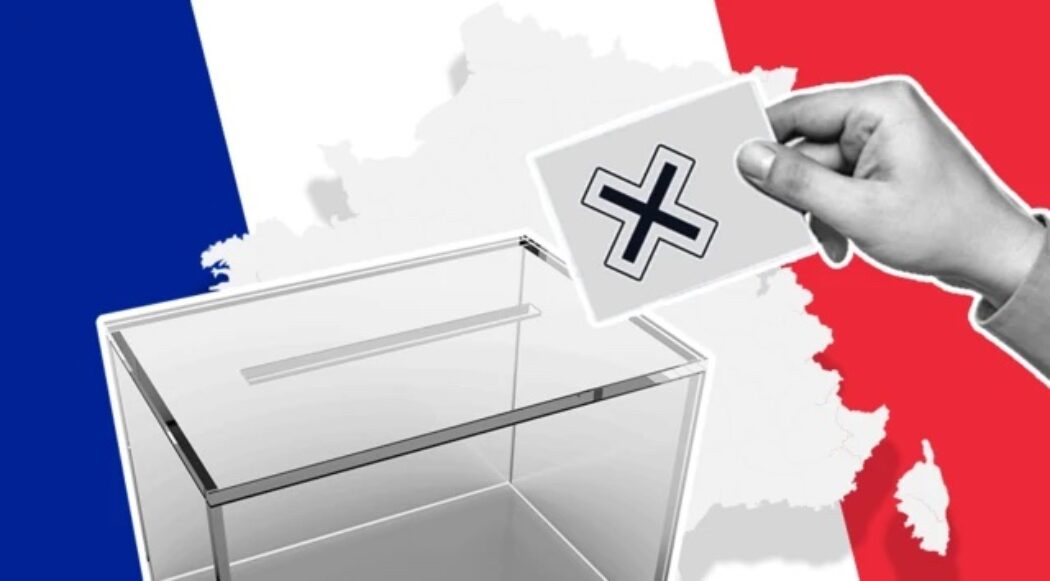
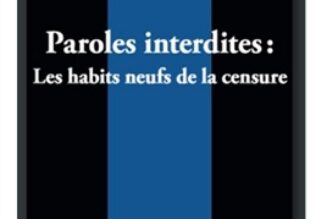

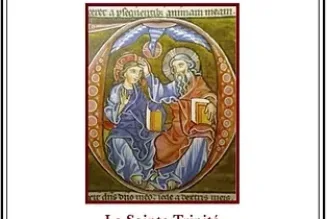


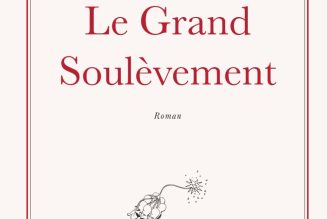
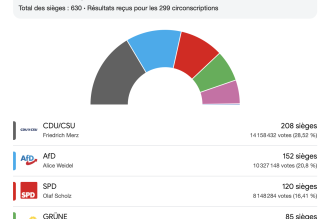


D'Haussy
Le plus dur n’est pas de se dire de droite.
Le plus dur est d’expliquer que la droite n’est ni le parti radical socialiste nommé RN ni le parti libéral sioniste nommé Reconquête.
C’est fatiguant.
Personnellement je dis que je suis catholique français, légitimiste, contre révolutionnaire et qu’il faut décapiter Marianne.
Généralement les ”gens normaux” n’ont rien à objecter.
ruaux
Je suis catholique donc une impossibilité de voter pour des partis qui pratiquent la peine de mort comme l’IVG , l’euthanasie
car je respecte un des commandements de Dieu “tu ne rueras pas” donc ni LFI,ni socialiste, ni Macron, ni LR/etc ni RN
BMN
avant mai 68, De Gaulle parlant de la gauche : “Laissons leur la culture, cela leur fera un os à ronger”.
après 1945, De Gaulle : “je vais redonner la république à la France, il n’y a aucune raison pour que je ne lui redonne pas aussi les francs-maçons.”
merci qui ?
D'Haussy
Merci de Gaulle, fondateur de la 5e catin.
L’idole des boomers de droite.