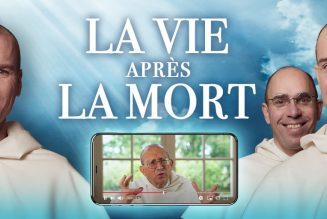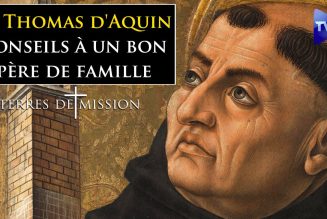Durant la messe, le prêtre se tiendra à l’autel. Mais avant de s’en approcher, une ultime préparation est nécessaire. Les prières dites « prières au bas de l’autel » ont une double tonalité : pénitence et joie. Pénitence, car « la prière, dans laquelle la petitesse de l’homme s’humilie devant la grandeur de Dieu, se concentre […] sur le point où se font le plus sentir l’insuffisance et l’indignité de l’homme[1]. Joie, car malgré cette insuffisance et cette indignité, nous sommes admis à nous approcher de Dieu.
Signe de Croix
Le signe de Croix, « signe de bénédiction par excellence, […] se dresse comme un portique à l’entrée de la messe »[2] et indique dès l’abord que c’est le sacrifice de la Croix qui va être actualisé, pour rendre gloire à la Sainte Trinité, pour que les chrétiens également y soient associés, afin d’entrer en communion avec la Sainte Trinité. Souvenons-nous en effet que c’est en vertu de son baptême « au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » que chaque fidèle est rendu apte à participer au culte chrétien.
Psaume XLII – Judica me
Suit la récitation du psaume 42, dont la note dominante est donnée par le quatrième verset, repris comme une antienne au début et à la fin de la récitation :
Introibo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat juventutem meam. J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, vers Dieu qui réjouit ma jeunesse.
C’est exactement l’action qui se déroule. En effet, non seulement le prêtre va bientôt monter à l’autel, mais il peut légitimement se présenter ainsi devant Dieu. En effet :
ce à quoi aspirait le psalmiste, n’est devenu vraiment possible que dans la Nouvelle Alliance ; car ce n’est que par le Christ que nous possédons “liberté de parole et d’accès auprès du Père”[3]. L’autel de la Nouvelle Alliance est le lieu où peut le plus pleinement se réaliser ici-bas la rencontre avec Dieu[4].
Il s’agit également de demander à Dieu d’écarter les obstacles à cette rencontre :
C’est pourquoi nous lançons un appel vers lui qui est notre force, pour qu’il fasse briller sa lumière et rende efficace sa fidélité pour nous conduire in montem sanctum, au haut-lieu où va se renouveler le sacrifice du Golgotha[5].
Ainsi, les épreuves causées par ces obstacles n’empêchent la joie de se manifester progressivement au fil du psaume.
Confiteor
Le Confiteor est introduit par le verset : « Adjutorium in nomine Domini. Notre secours dans le nom du Seigneur ». C’est « l’aveu qu’en matière de salut, nous ne pouvons rien sans le secours d’En Haut, lequel, comme l’indique le signe de croix qui l’accompagne, nous a été acquis par la Croix de Notre-Seigneur ».
Le prêtre confesse d’abord seul ses péchés. Il demande pardon à un titre particulier, parce qu’il va célébrer la sainte messe. Remarquons l’humilité signifiée par sa position. Non seulement, il demeure au bas de l’autel, tel Moïse qui demeure au pied de la montagne avant de monter dans la nuée, mais il s’incline profondément et se frappe la poitrine :
Rien n’est plus ancien que cette manière d’exprimer la douleur des péchés. Le publicain frappait sa poitrine en disant à Dieu : ayez pitié de moi qui suis un pécheur. Ceux qui furent touchés d’avoir consenti à la mort de Jésus-Christ s’en retournèrent frappant leur poitrine […]. Mais que signifie le frappement de poitrine ? […] Il signifie que nous voudrions briser notre cœur, afin que Dieu en fit un nouveau qui put lui plaire […]. Il signifie que nous sommes indignés contre ce cœur qui a déplu à Dieu. Les trois coups dont on se frappe la poitrine peuvent être regardés […] conviennent assez aux trois sortes de péchés, de pensée, de parole et d’action dont on s’accuse.
Après l’aveu de ses péchés, à Dieu d’abord, puis aux saints du ciel et à ses frères chrétiens, le prêtre demande aux saints et à ses frères d’intercéder pour lui. En dépit des apparences, le Confiteor n’est pas une répétition : dans la première partie on confesse ses péchés, dans la seconde on implore la miséricorde divine.
Le Misereatur par lequel les assistants répondent à cette demande du prêtre est justement une imploration de la miséricorde divine. Tout chrétien [en état de grâce], parce qu’il est dans l’amitié divine, peut implorer pour les autres et même mériter pour eux au titre de cette amitié : c’est un aspect du mystère de la communion des saints.
C’est au tour des assistants de réciter le Confiteor tandis que le prêtre leur répond par le Misereatur, avant d’ajouter l’Indulgentiam, pour lui et pour les fidèles : “Que Dieu nous donne l’indulgence, l’absolution et la rémission de nos péchés…”. C’est le prêtre en effet qui est médiateur entre Dieu et les âmes.
Si les fidèles peuvent en effet être dits en un sens prêtres puisque par leur baptême il sont rendus capables de s’unir au sacrifice du Christ et de s’offrir avec lui – c’est ce que l’on appelle parfois le sacerdoce baptismal, les prêtres sont quant à eux consacrés à un titre particulier pour renouveler le sacrifice du Christ. C’est le sacrifice ministériel.
Versets, Aufer a nobis
Le dialogue des versets qui suivent reprend l’idée sur laquelle s’est achevé le psaume 42 : le désir de puiser joie et vie nouvelle en Dieu et de voir sa bienveillance se manifester en notre faveur.
Puis le prêtre monte enfin à l’autel en récitant l’oraison Aufer a nobis :
« Enlevez nos fautes, Seigneur, pour que nous puissions pénétrer dans le Saint des Saints avec une âme pure. Par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. »[6]
Cette oraison constitue l’élément le plus ancien des prières au bas de l’autel et en résume les thèmes principaux :
« Elle regarde vers les péchés que nous voudrions laisser derrière nous, et en avant, vers le sanctuaire [sancta sanctorum : le saint des saints] où nous devons pénétrer. »
Oramus te, Baiser de l’autel
Arrivé à l’autel, le prêtre s’incline pour réciter l’oraison Oramus te :
« Nous vous en prions, Seigneur, par les mérites de vos saints dont nous avons ici les reliques et de tous les saints, daignez pardonner tous mes péchés. Ainsi soit-il. »[7]
Au cours de cette oraison, le prêtre baise l’autel. C’est une manière de saluer le lieu où doit s’accomplir le mystère sacré :
« Cette cérémonie est un emprunt à la civilisation antique. Dans l’antiquité, c’était une coutume toute naturelle que de vénérer le temple en en baisant le seuil. On avait coutume aussi de saluer d’un baiser l’image d’une divinité païenne, ou de lui envoyer de loin des baisers […]. De même, on saluait l’autel d’un baiser ; la table familiale aussi semble avoir souvent reçu des baisers, au début du repas, comme un lieu enveloppé d’une consécration religieuse. Aussi était-il naturel que le baiser aux lieux saints restât en usage même en chrétienté, en se contentant de changer d’objet. »[8]
On peut attacher à ce baiser de l’autel deux significations.
Selon la première, il s’agit d’un baiser au Christ lui-même, pierre angulaire[9] et rocher spirituel[10], représenté par l’autel.
Selon la deuxième signification, il s’agit également du baiser du Christ à l’Église. Étant donné la présence des reliques dans l’autel, « baiser l’autel, c’est aussi saluer les martyrs et, d’une façon générale, saluer l’Église triomphante. Aussi Innocent III interprète-t-il le baiser à l’autel de la façon suivante : dans la personne de l’évêque [ou du prêtre] qui baise l’autel, c’est le Christ qui salue sa fiancée[11]. »[12]
Au cours de la messe, le prêtre baise plusiseurs fois l’autel : au début de la messe, en arrivant à l’autel, au début du canon (Te igitur) et pendant le canon (Supplices), à la fin de la messe, avant de quitter l’autel, mais également à chaque fois qu’il doit se retourner pour s’adresser au peuple ou à un assistant.
On peut voir dans ces divers baisers, une adresse aux saints dont les reliques sont présentes dans l’autel, le désir d’être en communion avec eux pendant la célébration du Saint Sacrifice ; ou bien une manière de signifier que c’est du Christ, représenté par l’autel que vient le salut et la paix que le prêtre transmet ; ou encore un renouvellement symbolique de l’union au Christ. Mais, outre ces diverses significations, il faut se rappeler que chacun de ces baisers est d’abord « un hommage rendu au caractère sacré de l’autel. »[13]