D’Aurelio Porfiri, éditeur et écrivain catholique italien, pour le Salon beige:
Beaucoup pourraient penser que les lignes qui suivent ont été écrites sous l’inspiration de la grande chaleur qui accable ma Rome. Ce n’est pas le cas ; elles sont plutôt le fruit d’une réflexion sérieuse sur l’état de la liturgie dite de Paul VI, en particulier en Italie. Mais je crois que mes observations seront également utiles à ceux qui vivent dans d’autres pays.
Comme je l’ai dit, malgré certaines critiques inhérentes à la liturgie de Paul VI (après tout, tout rite peut présenter des points faibles que l’Église est appelée à corriger, si possible sans détruire le rite), je crois qu’il est possible de célébrer ce rite de manière très digne si les prêtres exécutent fidèlement ce que l’Église attend d’eux, sans chercher à se mettre en avant, et si les langages artistiques reçoivent l’espace qui leur est dû et qu’ils méritent certainement. Lorsque cela se produit, même la liturgie de Paul VI peut favoriser la prière et l’adoration, bien que sur un plan différent de la messe dite de saint Pie V ou traditionnelle.
Le problème est que, malheureusement, ces conditions évoquées plus haut, du moins en Italie, sont rarement respectées, nous donnant des liturgies négligées et mal préparées, qui ne favorisent certainement pas notre prière. Cette négligence est désormais si enracinée qu’elle s’est transformée en indolence.
Qu’est-ce que l’indolence ? C’est une tendance à l’apathie, au choix de survivre dans l’inertie.
Comment cela se manifeste-t-il ? Même si bon nombre de prêtres sont conscients de la mauvaise qualité des rites liturgiques dans leurs églises, ils ne parviennent à rien changer ; ils se laissent aller à une « médiocrité inévitable » (du moins est-ce ainsi qu’ils la perçoivent). Pourquoi se donner du mal pour quelque chose qui semble condamné à rester ainsi ? Et pourtant, si nous nous fions à l’Écriture Sainte (comme nous le devons effectivement), nous pouvons lire, dans le livre de Ben Sira, au chapitre 2 :
« Malheur aux cœurs lâches et aux mains indolentes, et au pécheur qui marche sur deux chemins ! Malheur au cœur indolent, car il n’a pas la foi ; c’est pourquoi il ne sera pas protégé. »
Les paroles sont assez claires. Ce n’est sans doute pas un hasard si Dante place les « lâches » dans l’enfer de sa Divine Comédie. Pourtant, cette forme d’indolence ou de lâcheté liturgique, nous la subissons depuis des décennies, sans parvenir à en sortir. On se laisse désormais bercer par la médiocrité ambiante, sans désir d’élever la qualité de ce qui est proposé dans la liturgie. La situation est certainement très triste, et, humainement parlant, elle semble sans issue proche.
Nous pouvons parfaitement lire cette indolence dans la catégorie de l’acédie, une condition d’inertie bien connue des spécialistes de la spiritualité, étant également comptée parmi les sept péchés capitaux. Un grand moine du IVᵉ siècle, Évagre le Pontique, appelait cette condition le « démon de midi », un état qui affligeait certains moines en leur faisant perdre l’enthousiasme de leur vie spirituelle. L’actuel régent de la Maison pontificale, le père Leonardo Sapienza, dans le journal L’Osservatore Romano, fait cette réflexion :
« L’ennemi le plus dangereux de la foi est la négation. Ce n’est pas l’athéisme. Le véritable ennemi est l’indifférence, l’apathie, l’habitude. C’est la maladie spirituelle de notre temps. Notre foi apparaît souvent hésitante, fragile, inconsistante, peu convaincue et peu convaincante. Liée à tant de conditionnements, à des émotions passagères, à des déceptions, à l’habitude… »
Peut-être le père Sapienza a-t-il raison, et il ne fait aucun doute que cette grave tentation s’est également emparée de notre vie liturgique.
Le pape François, lors de l’audience générale du 14 février 2024, commente l’acédie en ces termes :
« Les lecteurs contemporains voient dans ces descriptions quelque chose qui rappelle beaucoup le mal de la dépression, tant d’un point de vue psychologique que philosophique. En effet, pour ceux qui sont saisis par l’acédie, la vie perd son sens, prier devient ennuyeux, toute bataille semble dénuée de sens. Même si nous avions nourri des passions dans la jeunesse, elles nous paraissent aujourd’hui illogiques, des rêves qui ne nous ont pas rendus heureux. Alors on se laisse aller et la distraction, l’absence de pensée, apparaissent comme la seule issue : on aimerait être hébété, avoir l’esprit complètement vide… C’est un peu comme mourir par anticipation, et c’est déplorable. » Face à ce vice que l’on sait si dangereux, les maîtres de la spiritualité envisagent divers remèdes. Je voudrais signaler celui qui me semble le plus important et que j’appellerais la patience de la foi. Si, sous le fouet de l’acédie, le désir de l’homme est d’être “ailleurs”, de fuir la réalité, il faut au contraire avoir le courage de rester et d’accueillir dans mon “ici et maintenant”, dans ma situation telle qu’elle est, la présence de Dieu. Les moines disent que la cellule est pour eux le meilleur maître de vie, parce qu’elle est le lieu qui te parle concrètement et quotidiennement de ton histoire d’amour avec le Seigneur. Le démon de l’acédie veut détruire précisément cette joie simple de l’ici et maintenant, cette crainte reconnaissante de la réalité ; il veut te faire croire que tout est vain, que rien n’a de sens, qu’il ne vaut pas la peine de se préoccuper de rien ni de personne. Dans la vie, nous rencontrons des gens « sous l’emprise de l’acédie », des gens dont nous disons : « Mais qu’il est ennuyeux ! » et nous n’aimons pas être avec eux ; des personnes qui ont aussi une attitude d’ennui contagieuse. C’est l’acédie. »
Malheureusement, la « patience de la foi » est très difficile à exercer lorsque nous sommes confrontés à des liturgies qui ont perdu toute vitalité spirituelle. On pense que cette condition pourrait être corrigée en rendant les liturgies plus « joyeuses », mais ce n’est pas une véritable solution ; c’est même un symptôme du problème, car cela signifie qu’on n’a pas compris de quoi la liturgie a vraiment besoin, à savoir retrouver le sens du sacré, de l’adoration, de la centralité de Dieu. La liturgie a besoin que les langages du véritable art sacré reprennent la parole en son sein. Elle n’a pas besoin de « gaieté », mais de la joie chrétienne, qui est tout autre chose et qui se manifeste aussi dans la gravitas, dans un style de célébration qui soit véritablement le reflet de la conscience d’être en présence d’un mystère surnaturel qui, pour nous tous, doit être ressenti comme d’une importance vitale.





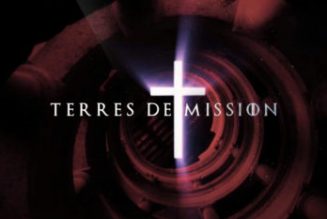

julaurdine
Pour imposer de reléguer le Christ le Dieu vivant et lui tourner le dos, se qui est significatif, sans compter la distribution de la communion dans la main en faisant la queue debout, et les interventions créatives intempestives dites modernistes, dans tous ses détails, la perte de la foi, la médiocrité et la débilité sont inhérentes à la messe conciliaire Paul6.
zongadar
La réponse nous est donnée par les “frères …”: qui nous indiquent comment remonter la pente :
https://www.revueenroute.jeminforme.org/PDF/Plan_maconnique_en_33_points_pour_detruire_l_Eglise_catholique.pdf
julaurdine
Merci Zongadar – Ce plan maçonnique en 33 points est copié collé avec le programme des conciliaires.