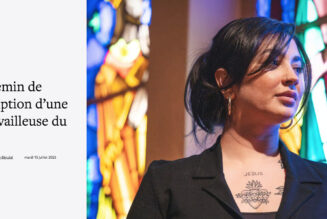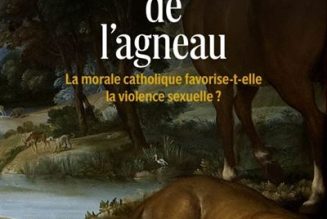Lu sur Politique magazine :
En février dernier, sur la chaîne Fox News, J. D. Vance disait :
« Comme chef politique américain, mais aussi simplement en tant que citoyen américain, votre compassion doit aller d’abord à vos propres citoyens. Cela ne veut pas dire que vous haïssiez les gens extérieurs à vos frontières, mais il s’agit de cette pensée classique – et je pense que c’est une conception très chrétienne, certainement – que vous aimez d’abord votre famille, et puis vous aimez votre voisin, puis vous aimez votre communauté, et ensuite les concitoyens de votre pays, et, après cela, vous pouvez vous concentrer et accorder la priorité au reste du monde » et d’ajouter « une grande partie de l’extrême-gauche a inversé cet ordre-là. »
Ce propos peut étonner dans le climat théologique et pastoral actuel, surtout après la lettre du pape à l’épiscopat américain.
Pour le pape, en effet, « l’amour chrétien n’est pas une expansion concentrique d’intérêts qui s’étendent peu à peu à d’autres personnes et groupes ». Revenant à sa lecture de la parabole du Bon Samaritain (Fratelli tutti), il poursuit : « le véritable ordo amoris [est] l’amour qui construit une fraternité ouverte à tous, sans exception ». Qu’en est-il cependant du côté de la doctrine catholique classique la plus autorisée, celle de saint Thomas d’Aquin ?
Comme toujours, Thomas puise dans la rationalité naturelle de la philosophie gréco-latine et dans la raison théologique interprétative de la révélation. Selon cette tradition conjointe, l’amour chrétien – la charité –, est bien ordonné et même hiérarchisé. À son sommet, pour principe premier, oublié de Vance et du pape, Dieu : l’objet suprême de la charité d’où tout part et retourne. Toutefois, la nature, qui selon l’adage thomiste n’est pas abolie mais élevée par la grâce, ne doit pas être oubliée pour autant.
Charité et communication
La charité, dit Thomas, n’est rien d’autre qu’une amitié faite de bienveillance, de réciprocité et de communication. La bienveillance est vouloir le bien de l’ami et se complaire dans ce bien. Réciproque, l’amitié est établie entre deux personnes qui veulent chacune le bien de l’autre. De ce fait, elle est une communication, un échange ou une communion basée sur une similitude qui crée entre les amis une communauté. Il y a amitié pour Thomas dès qu’il y a communauté, celle-ci comprise comme un regroupement autour d’un bien commun. On parlera donc d’« amitié familiale » ou « politique », par exemple. L’ami est celui avec lequel j’ai partie liée, avec qui j’ai une certaine union de vouloir, une similitude d’acte et d’être. Le contraire de l’ami ici n’est pas l’ennemi mais celui qui n’a pas part à cette communauté de bien : l’étranger, celui qui est extérieur à la famille, à la cité, au pays, etc.
La seule communauté déduite de notre nature humaine, et selon laquelle nous sommes tous « frères » par union de nature, ne suffit pas à cette amitié-là. L’amitié, de fait, vient de la poursuite volontaire d’un bien commun par les membres d’une même communauté. Autrement dit, l’amitié n’est pas uniquement fondée sur la similitude dans l’être mais sur la communion active. L’égalité qui est le fruit de l’amitié n’en est pas le point de départ : un père et un fils sont égaux dans leur nature mais ne le sont pas dans l’œuvre commune à poursuivre : la constitution d’une famille humaine. Aussi il y a pour cette raison une hiérarchie dans l’amitié de charité.
Le premier de tous les biens communs poursuivis est la charité elle-même. Elle doit donc être voulue et aimée pour elle-même. Cet amour doit être en priorité rendu à Dieu, bien suprême, et à la béatitude, jouissance de Dieu. Il s’étend ensuite au prochain dans un acte de même espèce parce qu’on l’aime à raison de Dieu et de Dieu en lui. La charité peut et doit s’étendre à nous-même, et à notre corps, dont la nature est bonne : « l’amour que l’on éprouve pour soi-même est la forme et la racine de l’amitié ; en effet nous avons de l’amitié pour d’autres lorsque nous nous comportons envers eux comme envers nous-même. » Et l’on s’aime comme sujet spirituel en raison de notre âme et on aime notre propre corps, bien que secondairement, parce qu’il est uni à notre âme et qu’il participera à la béatitude.
En ce qui concerne le prochain, la charité nous demande d’aimer nos ennemis non pas parce qu’ils sont nos ennemis mais parce que nous avons avec eux une commune nature. Si cet amour de l’ennemi ne doit pas être en acte constamment, il doit exister comme disposition dans l’âme, en ce sens que nous devons être prêt à aimer tel ennemi, si cela se présentait. Aussi, nous devons être disposés à leur venir en aide si la nécessité le demandait. En dehors de ces cas de nécessité, les bienfaits accordés aux ennemis relèvent de la perfection de la charité qui « veut vaincre le mal par le bien ». Si l’on fait du bien à ses ennemis, c’est dans l’espoir d’en devenir ami.
Thomas présente donc l’étendue de la charité en fonction de la communication de la béatitude. Le principe de la béatitude étant Dieu, il doit être aimé par-dessus tout. Les réalités qui participent de cette béatitude, l’homme et l’ange, doivent être aimées ensuite, soit parce qu’ils ne font qu’un avec nous, soit par association à la même béatitude. Enfin, il est une réalité en qui la béatitude rejaillit, le corps humain. Cette extension de l’amitié de charité présente donc une hiérarchie et un ordre.
Charité et ordre
Pourquoi existe-t-il un ordre de la charité ? Thomas répond : « partout où il y a un principe, il y a un ordre. » Or nous l’avons dit, l’amour de charité tend vers Dieu et la béatitude comme vers ses principes. C’est la communication par Dieu de cette dernière qui fonde l’ordre de la charité. Et cet ordre découle de la relation que les diverses choses ont avec ce principe divin et ce même s’il faut, dans l’acte d’aimer, distinguer deux choses : l’objet aimé et le sujet aimant.
L’objet ultime de la charité, on l’a dit, est la béatitude qui est Dieu. À ce titre Dieu est le premier et le principal objet de la charité. Il doit donc être aimé en premier comme cause de la béatitude en moi et dans mon prochain. Celui-ci participe de la même béatitude. Nous devons aimer Dieu, plus que nous-même, d’abord d’un amour naturel en raison des biens naturels qu’il nous communique, ensuite surtout, d’un amour de charité, en raison des dons de la grâce.
Le sujet aimant, lui, s’aime selon sa nature spirituelle, capable de Dieu :
« Les bons estiment que le principal en eux est la nature raisonnable ou l’homme intérieur, et, par là, ils s’estiment tels qu’ils sont. […] Les bons, qui ont d’eux-mêmes une connaissance vraie, s’aiment vraiment eux-mêmes. »
Aussi, en raison de sa nature spirituelle, qui le fait participer directement à la béatitude divine, l’individu est tenu de s’aimer, après Dieu, plus que quiconque. La participation directe à la béatitude est supérieure à l’association à cette participation, or le prochain est aimé parce qu’il est associé à cette participation. Chaque personne a une participation directe qui justifie qu’elle vienne directement après Dieu dans l’ordre de la charité. En revanche, du point de vue de la nature corporelle de l’homme, il en est autrement. Si notre corps doit être aimé de charité, le prochain a cependant la préséance sur lui. Si nous aimons notre corps, c’est en raison de la spécificité de sa participation à la béatitude, par rejaillisement, or celle-ci est inférieure à la participation par association qui concerne le prochain.
Contrairement à l’opinion qui distinguerait dans la charité l’affection, due à tous, et les bienfaits extérieurs pouvant être distribués de façon inégale, Thomas pense que sous le rapport et de l’affection et des bienfaits, « il faut que notre amour du prochain soit plus grand pour celui-ci que pour un autre. » Selon que celui qui est aimé sera plus ou moins loin ou de Dieu, comme fin de la charité ou de moi qui aime, ma dilection sera plus ou moins grande, et que la nature y soit mêlée n’y change rien puisque la grâce accompagne la nature. Le prochain, par exemple, peut être plus proche de Dieu : celui-là il faut l’aimer davantage en raison de cette proximité. D’autres peuvent être proches de nous par la communauté de bien : famille, ami, coreligionnaire, concitoyen, compatriote, etc. : ceux-là peuvent et doivent être aimés davantage que l’étranger, qui n’est pas, rappelons-le, un ennemi mais celui qui ne participe pas, ou pas encore, à une communion d’amitié. Deux ordres donc règlent la charité, celui de la proximité objective, qui est un ordre d’excellence où l’on aimera davantage ceux qui sont le plus proches de Dieu (les meilleurs, comme dit Thomas), et celui de la proximité subjective, c’est-à-dire selon le sujet aimant, où l’on aimera davantage ceux qui nous sont les plus unis, que la Providence place auprès de nous ; voulant pour les meilleurs un bien plus grand, et pour les proches un bien qui leur convient. Les liens de proximité sont divers et selon leur nature l’on aimera selon celle-ci :
« De la sorte, le fait d’aimer quelqu’un parce qu’il est notre parent, notre proche, ou notre concitoyen, ou pour tout autre motif valable et pouvant être ordonné au but de la charité, peut être commandé par la charité. C’est ainsi que la charité, tant en son activité propre que dans les actes qu’elle commande, nous fait aimer de plusieurs manières ceux qui nous tiennent de plus près. »
Cet ordre exposé par saint Thomas, qui allie si admirablement l’affection naturelle et celle de la charité théologale, subsistera dans le ciel : Dieu sera aimé principalement et absolument, chacun s’aimera soi-même avec une intensité ordonnée à Dieu, on aimera ensuite celui qui sera le meilleur, c’est-à-dire celui qui sera plus proche de Dieu, et ensuite chacun aimera
« celui qui lui tient de plus près… car dans l’âme des bienheureux, demeureront toutes les causes de l’amour honnête ».
Une charité sans ordre ou contre-nature ? Ceci était la doctrine classique et traditionnelle. Il semble cependant qu’elle soit modifiée depuis Fratelli Tutti dont la lettre aux évêques américains est un écho. François y mentionne bien un ordre de la charité mais qui n’a plus rien à voir avec celui du docteur commun.
Il s’agit donc, une nouvelle fois, d’une rupture.
Si « le véritable ordo amoris [est] construire une fraternité ouverte à tous sans exception », il n’y a tout simplement plus d’ordre du tout et plus de hiérarchie. On ôte même le principe de la charité, Dieu, pour ne garder que « la fraternité ouverte ». L’amour premier du prochain-lointain est la fin, presque exclusive, de la charité, ce qui n’a jamais été le cas dans la tradition chrétienne. Escamotée aussi la distinction entre l’ami et l’étranger, celui qui communie avec moi et celui qui ne communie pas de fait. Le pape, utopiste, voit partout des étrangers qui sont, pour cette raison même, des « amis », ce qui n’a pas beaucoup de sens pour Thomas. La prudence et le bon sens nous enseignent que les deux notions ne découlent pas forcément l’une de l’autre et le pape le sait : les peines pour une entrée illégale au Vatican, pour lequel il est bien des « étrangers », ont été durcies. Belle fraternité ouverte !
On dira peut-être que l’ordre exposé par saint Thomas est trop humain, que dans cet humain-là se glisse parfois une pieuse justification de l’ostracisme, qu’il y manque le souffle de la folie de l’amour qui ne connaît ni raisons, ni ordre. La visée de Thomas n’est pas une mystique de l’amour et moins encore celle de l’Utopie égalitaire. L’inégalité dans l’amour peut exister de deux manières, dit Thomas. D’abord du côté du bien souhaité à l’ami. De ce point de vue, nous devons aimer tous les hommes car nous souhaitons pour tous la béatitude. Mais on peut parler, ensuite, de plus grande dilection « en raison de l’intensité plus grande de l’acte d’amour ».
Le « aimez-vous les uns les autres » prononcé au Cénacle, en comité restreint, est le commandement donné aux disciples en priorité. Le cœur du disciple ordonné selon la charité tente, d’une part, d’aimer Dieu par-dessus toute chose, ensuite celui qui lui est uni par une communauté de vie effective, quelle qu’en soit la nature, enfin d’avoir la disposition habituelle d’aimer tous les hommes. « Disposition » puisqu’il n’est pas possible que cet amour soit en acte tout le temps mais cette bienveillance doit nous rendre apte à devenir le proche de quiconque, fût-il étranger. Comme il nous est impossible de faire le bien à tous, nous ne pouvons pas aimer tout le monde selon ce rapport de bienfaisance, mais nous devons les aimer tous selon celui de la bienveillance, ce qui était déjà la doctrine de saint Augustin. Bien que la charité soit universelle, selon l’ordre que l’on a exposé, il serait cependant contraire à la nature et à la charité de négliger celui qui m’est uni par des liens de communauté pour accorder mes bienfaits à ceux qui me sont étrangers.