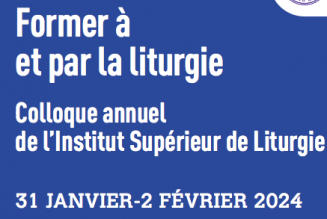Article du Père Louis-Marie de Blignières paru dans le n. 172 de Sedes Sapientiæ en juin 2025, reproduit avec l’aimable autorisation de la Fraternité Saint Vincent Ferrier :
Ayant vécu de près l’épisode des sacres de Mgr Lefebvre en 1988 et celui de la reconnaissance canonique des instituts Ecclesia Dei, je souhaite faire part de diverses critiques par rapport à un article de La Nef paru dans le dossier sur la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX) 1. Une partie de cet article vise les instituts Ecclesia Dei érigés en 1988. En voici l’ouverture :
À ce sujet, puisqu’on parle du respect de la « parole dite », on peut se demander si cette parole romaine n’a pas été extrapolée par certains « traditionalistes ». Nulle part, les papes Jean-Paul II et Benoît XVI n’ont jamais reconnu ni authentifié un « charisme d’exclusivité » rituelle, c’est-à-dire d’exclusion de la forme rituelle communément en vigueur dans l’Église latine.
1. Rappelons d’abord quelle a été l’intention du Saint-Siège lors de la reconnaissance canonique des instituts Ecclesia Dei. Après l’annonce des sacres sans mandat pontifical pour le 30 juin 1988, une Note d’information du Saint-Siège, datée du 16 juin, s’adressait aux catholiques attachés à la liturgie romaine traditionnelle qui ne voulaient pas suivre Mgr Lefebvre, « les assurant que toutes les mesures seront prises pour garantir leur identité dans la pleine communion de l’Église catholique 2 ».
Avec les fondateurs de la Fraternité Saint-Pierre (FSSP), j’étais début juillet 1988 à Rome. Le cardinal Ratzinger nous a dit : « La main que le Saint-Siège a tendue à Mgr Lefebvre reste ouverte pour ceux qui veulent la saisir. » Et le motu proprio Ecclesia Dei du 2 juillet 1988 précisait comment cela se ferait : « en conservant [nos] traditions spirituelles et liturgiques selon (juxta) le protocole signé le 5 mai [1988] par le cardinal Ratzinger et Mgr Lefebvre 3 ». Ce protocole n’a évidemment pu être signé que parce qu’il donnait à la FSSPX la faculté de s’en tenir aux anciens livres, ce qui était d’ailleurs l’intention notoire de cette dernière.
Et les fondateurs des instituts n’auraient pas demandé leur érection canonique s’ils n’avaient été assurés de pouvoir s’en tenir à la célébration selon la liturgie traditionnelle.
2. Cependant, une remarque importante doit être faite : le terme d’exclusivité employé par Pierre Louis paraît assez polémique et inadéquat. L’Église ne l’employait pas pour les ordres religieux qui, comme les dominicains et les grands carmes, étaient pourtant tenus à célébrer selon leur rite propre 4.
Ce terme n’avait donc pas à être mentionné dans les décrets des instituts alors érigés par la Commission pontificale Ecclesia Dei. En revanche, les décrets d’érection et les Constitutions approuvées (éléments essentiels du droit propre) reconnaissaient et garantissaient, conformément à la promesse du 18 juin 1988, une identité incluant le rite traditionnel comme « patrimoine des instituts ».
Il est remarquable que le Code de droit canonique stipule dans le canon 578 :
« La pensée des fondateurs et leur projet, que l’autorité ecclésiastique compétente a reconnus concernant la nature, le but, l’esprit et le caractère de l’institut ainsi que ses saines traditions, toutes choses qui constituent le patrimoine de l’institut, doivent être fidèlement maintenus par tous. »
Le « par tous » de cet important canon désigne aussi bien les membres des instituts que ceux qui n’en font pas partie, par exemple un publiciste catholique, l’ordinaire du lieu, un chef de dicastère ou même le pape 5.
La position soutenue dans l’article me semble relever d’un positivisme 6 qui va à l’encontre de la pratique et de l’esprit de l’Église. Comme si un entraîneur mal luné obligeait des footballeurs à jouer du ballon ovale, au motif que nulle part le règlement du club de football n’exclut de jouer au rugby… Pourquoi transformer une abstention respectueuse en une sorte d’exclusion agressive ? On peut évidemment s’abstenir de faire une action, sans estimer pour autant qu’elle est en soi illicite.
3. Pierre Louis cite le motu proprio Ecclesia Dei qui évoque « une symphonie que, sous l’action de l’Esprit Saint, l’Église terrestre fait monter vers le ciel ». Et il commente :
« On se situe bien là dans l’axe d’une pluralité et non d’un repliement unilatéral sur une forme liturgique donnée. »
L’auteur est sur ce point dans un malentendu. Il s’agit ici d’une diversité et d’une richesse qui sont vécues au niveau de l’Église universelle, non pas des individus ni des communautés particulières.
L’orchestre est diversifié, mais chacun joue de son instrument propre. Confondre l’unité et l’uniformité est une tentation moderne, mais qui n’est guère « catholique » (kath olon), le mot évoquant une unité de membres divers.
4. Lorsque Pierre Louis cite Benoît XVI dans sa Lettre accompagnant le motu proprio Summorum Pontificum (« L’exclusion totale du nouveau rite ne serait pas cohérente avec la reconnaissance de sa valeur et de sa sainteté »), il fait une confusion. Exclure par principe la célébration d’un rite, c’est soutenir que sa célébration est illicite. On ne saurait dire que des prêtres qui, comme ceux de la FSSP et de la FSVF, assistent à la messe chrismale et y communient, sont dans ce cas 7. Sans « exclure par principe », on peut faire valoir la liberté de s’en tenir au rite reconnu comme le patrimoine de son institut.
Dans une lettre adressée le 22 septembre 2006 à l’abbé John Berg, supérieur général de la FSSP, le cardinal Dario Castrillon Hoyos, président de la Commission pontificale Ecclesia Dei, précisait :
« On ne saurait obliger un prêtre à célébrer ou concélébrer selon ce rituel [le rite romain actuellement en vigueur] quand il appartient à une société dont le patrimoine et la mission est de mener son apostolat selon la forme extraordinaire du même rite, celle dite de saint Pie V. »
Analogiquement, les prêtres célébrant le nouveau rite ne peuvent pas, sans cesser d’être catholiques, exclure par principe (c’est-à-dire considérer comme illicite) la célébration du rite romain traditionnel. Mais il ne serait pas juste d’exiger d’eux de le célébrer de fait, actu, pour prouver qu’ils ne l’excluent pas.
5. « Tout abonde – dit Pierre Louis – dans le sens d’une non-reconnaissance ecclésiale de la dite exclusivité/exclusion. » Mais ce qui est en cause, ce n’est pas un « droit d’exclure », c’est un droit de s’en tenir à son propre rite.
Pierre Louis, on l’a vu, insinue que la « parole romaine » a « été extrapolée par certains “traditionalistes” ». Les Constitutions de la FSVF, approuvées provisoirement le 28 octobre 1988, puis définitivement le 5 avril 1995, montrent qu’il n’y a aucune extrapolation :
« Dans la célébration de la Sainte Messe et de l’Office divin, les membres de la Fraternité sont tenus d’utiliser leurs livres liturgiques propres et approuvés, selon la norme du décret d’érection de la Fraternité (n. 4) 8. »
Pour le cas particulier de la concélébration, dans une lettre adressée le 2 février 2000 à l’abbé Joseph Bisig et à moi-même, le cardinal Ratzinger, tout en nous « recommandant de façon instante » de concélébrer, a affirmé très clairement que nous pouvions nous en tenir à la façon traditionnelle de manifester la communion ecclésiale :
« Sans aucun doute, vous avez raison (Sie haben ohne Zweifel recht) sur le fait que, en soi, assister à la messe chrismale en habit de chœur et communier de la main de l’évêque est suffisant comme signe de communion. »
Un souhait, une recommandation, même pressante, n’est pas une obligation. Les autorités romaines ont certes exprimé le souhait que les traditionalistes célèbrent le nouveau rite occasionnellement. Elles n’en font pas une condition à la communion ou à la reconnaissance canonique, sinon le protocole du 5 mai 1988 eût été un mensonge ou un piège. La personnalité de ce prélat parfaitement droit qu’a été le cardinal Ratzinger empêche d’adhérer à une telle supposition.
Le Saint-Siège est resté fidèle à la promesse de « garantie de leur identité » donnée il y a trente-sept ans aux traditionalistes fidèles à Rome. Cela contrairement aux pronostics de Mgr Lefebvre en 1988 9.
6. Pierre Louis écrit aussi :
« Les prêtres et les fidèles de la mouvance ex-Ecclesia Dei doivent veiller à conjurer la tentation de reconstituer, sous prétexte de cohérence entre la pastorale et la liturgie, des apostolats parallèles ou autonomes dans des milieux ecclésiaux séparés. »
Certes, la tendance au séparatisme est malheureusement toujours vivante durant les périodes de crise. Mais les supérieurs de la FSSP et de la FSVF ont largement donné, depuis l’érection canonique de leurs instituts, par leurs écrits et par leurs actes, la preuve qu’ils refusaient l’esprit de séparatisme.
Pour vivre leur charisme propre dans la communion hiérarchique avec le Saint-Siège et les diocèses, ils ont parfois payé et ils payent encore le prix fort 10. Mais ils n’avaient pas et ils n’ont pas la faculté d’offrir aux fidèles autre chose que ce pour quoi ils ont été fondés. Ni celle de déployer l’apostolat des membres de leurs instituts autrement que dans le respect des Constitutions sur lesquelles ils se sont engagés devant Dieu. Agir autrement constituerait un grave abus de pouvoir.
Pour cela, le respect des promesses faites en 1988 aux traditionalistes fidèles au Saint-Siège de « garantir leur identité » constitue la base indispensable. Cette identité comporte, selon le motu proprio Ecclesia Dei, l’ensemble des pédagogies traditionnelles de la foi : liturgie, spiritualité, apostolat, discipline…11 Il importe qu’elles puissent s’exercer paisiblement dans la communion hiérarchique, ce qui est quasiment impossible sans un cadre juridique. C’est à cela que servent les propositions de structures canoniques, comme l’administration apostolique personnelle instituée pour Campos en 2002, et comme l’idée relancée récemment d’une circonscription ecclésiastique dédiée au rite latin ancien 12.
Il est curieux que Pierre Louis ne voie pas l’importance de la « cohérence entre la pastorale et la liturgie », cette donnée ecclésiale fondamentale, explicitement reconnue dans le cas qui nous occupe par le motu proprio Ecclesia Dei 13. Il est étonnant aussi qu’il taxe d’« apostolats parallèles » des activités exercées selon un charisme enfin reconnu par la hiérarchie en 1988, après vingt ans de difficultés. Est-ce que l’Administration apostolique personnelle de Campos est un « apostolat parallèle » ?
Il faut enfin remarquer que, partout où les ordinaires des lieux se montrent des pasteurs bienveillants, l’apostolat des prêtres Ecclesia Dei, loin d’être un « apostolat parallèle », se déroule en harmonie avec les structures des diocèses et en bonne entente avec les prêtres diocésains. L’identité reconnue favorise et nourrit l’authentique communion :
Pour avoir une vision plus complète de cet aspect de la communion ecclésiale – unité dans la diversité–, il faut considérer qu’il existe des institutions et des communautés établies par l’Autorité Apostolique pour des tâches pastorales particulières. En tant que telles, elles appartiennent à l’Église universelle, leurs membres étant cependant aussi membres des Églises particulières où ils vivent et travaillent. Cette appartenance aux Églises particulières, caractérisée par la flexibilité, a des expressions juridiques diverses. Ce fait, loin d’entamer l’unité de l’Église particulière fondée sur l’Évêque, contribue au contraire à donner à cette unité la diversité interne qui est le propre de la communion 14.
7. À la fin de son article, Pierre Louis écrit :
« Il ne convient pas de faire dire à cette parole plus que ce qu’elle a promis et l’Église n’a jamais permis que l’on pût suspecter la réforme liturgique jusqu’à refuser d’en célébrer la messe et les autres sacrements. »
Ici, il y a deux erreurs, qui d’ailleurs mélangent deux plans distincts. D’abord, sur le plan spéculatif, les instituts ex-Ecclesia Dei ont signé le protocole d’accord du 5 mai 1988, qui n’exigeait d’eux que la reconnaissance de la validité des livres liturgiques réformés 15, et qui laissait la place à une critique non polémique 16. Ensuite, sur le plan pratique, comme nous l’avons montré, et contrairement à ce que dit Pierre Louis, les instituts ne vont nullement au-delà de la promesse du Saint-Siège lorsqu’ils s’en tiennent à leurs « livres liturgiques propres et approuvés ».
Le Saint-Siège dit en substance : « Si vous avez des difficultés et des critiques (on ne préjuge pas de leur contenu), communiquez-les, sans polémique. » Pierre Louis, de son côté, en rajoute. Il invente un curieux concept de « critique qui va jusqu’à ne pas célébrer ». Il télescope doctrine etpratique et rejoint ainsi malencontreusement le concept moderne très confus de la « communion 17 ».
Lorsqu’il parle de « suspecter la réforme liturgique », Pierre Louis emploie un terme inadéquat et polémique. Une critique exprimée clairement peut être parfaitement respectueuse de la validité du rite, de l’autorité qui l’a promulgué, de ceux qui le célèbrent ou le pratiquent. Dans l’Église, il y a d’ailleurs eu nombre de critiques du Novus Ordo Missæ (NOM) émises même par des célébrants de cette forme liturgique 18. Et il ne faut pas oublier que d’innombrables critiques ont été émises et sont encore émises contre l’ancien rite latin de la messe par ses opposants.
La hiérarchie a tenu compte de certaines des critiques émises à propos du NOM en modifiant l’Institutio generalis en 1970 et en corrigeant des traductions qui, au jugement d’Étienne Gilson et de Jacques Maritain notamment, favorisaient l’hérésie.
Le raisonnement de Pierre Louis paraît fondé sur deux positions erronées. La première est une thèse spéculative : l’impossibilité absolue qu’un pape puisse instituer une réforme qui, malgré sa valeur sacramentelle et sa sainteté, comporterait de sérieuses déficiences dans l’être liturgique 19. La deuxième est une attitude pastorale contraire à la pratique de l’Église : l’unique moyen pour les prêtres de prouver la vérité de leur communion ecclésiale serait de célébrer ou de concélébrer un rite qui ne correspond ni à leur histoire ni à leur droit propre.
Ce positionnement exige étonnamment des prêtres Ecclesia Dei ce que ni la théologie catholique de la communion ni la pratique du Saint-Siège ne requiert. Pierre Louis est-il plus catholique que le pape ?
Fr. Louis-Marie DE BLIGNIERES
1 Pierre Louis, « Traditionis custodes justifie-t-il a posteriori les sacres de 1988 ? », La Nef, n° 378, mars 2025, pp. 28-29.
2 Documentation Catholique, n° 1967, p. 739.
3 Ecclesia Dei, n° 6a, Documentation Catholique, n° 1967, p. 789.
4 Le droit propre de l’Ordre des prêcheurs rendait obligatoire partout l’usage du rit dominicain (Constitutions Gillet, 1954, n. 561). De même, le rite propre des carmes de l’antique observance devait « être observé par tous les religieux appartenant à cet Ordre, sans excepter ceux qui étaient choisis pour diriger des paroisses » (Décret de la Congrégation des rites, 24 mai 1905).
5 Cf. L.-M. de Blignières, « Le pape et le droit propre des religieux », Sedes Sapientiæ, n° 159, mars 2022, pp. 3-9.
6 Le positivisme est l’idée que le droit tire sa source de la seule volonté du législateur, telle qu’elle s’exprime dans une norme portée par l’autorité.
7 Cf. abbé Pierre Olivier, « Accueillir Summorum Pontificum. Libres réflexions », Sedes Sapientiæ, n° 101, septembre 2007, pp. 23-36.
8 Constitutions FSVF n. 24. Nous avions pris soin d’attirer spécialement sur ce point l’attention du cardinal Mayer, président de la Commission pontificale Ecclesia Dei, avant l’approbation des Constitutions.
9 L’abbé Joseph Bisig se fait l’écho de ses prédictions, partagées par lui au début et démenties par les faits : « Je n’excluais pas du tout l’hypothèse, défendue par Mgr Lefebvre et de nombreux anciens confrères, que le motu proprio ne fût qu’un piège de Rome pour diviser et affaiblir la FSSPX, et que la nouvelle Fraternité sacerdotale Saint-Pierre (FSSP) serait supprimée au plus tard après trois ans » (« Les origines de la Fraternité Saint-Pierre : le témoignage d’un fondateur », Tu es Petrus, n° XXXIII, hiver 2022, pp. 39-40).
10 Jusqu’à perdre des apostolats florissants plutôt que de les continuer en dehors de la communion hiérarchique avec les ordinaires des lieux.
11 Le motu proprio Ecclesia Dei mentionne trois fois la liturgie (nn° 5c, 6a et 6c) ; deux fois la spiritualité (n° 5a et 6a) ; une fois l’apostolat (n° 5a) et une fois la discipline (n° 5c).
12 Cf. L.-M. de Blignières, « Une circonscription ecclésiastique dédiée au rite latin ancien », Sedes Sapientiæ, n. 165, septembre 2023, pp. 17-44 ; A.-M. de Araujo, « L’ordinariat traditionnel ; un risque de cloisonnement ? », Sedes Sapientiæ, n. 170, décembre 2024, pp. 24-27.
13 On peut aussi se reporter à ce que disait le cardinal Castrillon Hoyos : « Je n’aime pas les conceptions qui veulent réduire le “phénomène” traditionaliste à la seule célébration du Rite ancien, comme s’il s’agissait d’un attachement nostalgique et obstiné au passé. Cela ne correspond pas à la réalité qui se vit à l’intérieur de ce groupe de fidèles. En réalité, nous sommes ici souvent en présence d’une vision chrétienne de la vie de foi et de dévotion – partagée par beaucoup de familles catholiques, souvent riches de nombreux enfants – qui possède ses propres particularités » (Entretien à la revue The Latin Mass le 5 mai 2004).
14 Cf. Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la foi Communionis notio, aux évêques de l’Église catholique, sur certains aspects de l’Église comprise comme communion, 28 mai 1992, n° 16.
15 Partie doctrinale, Point n. 4 : « Nous déclarons en outre reconnaître la validité du sacrifice de la messe et des sacrements célébrés avec l’intention de faire ce que fait l’Église et selon les rites indiqués dans les éditions typiques du missel et des rituels des sacrements promulgués par les papes Paul VI et Jean-Paul II. »
16 Protocole d’accord, Partie doctrinale, Point n. 3 : « À propos de certains points enseignés par le concile Vatican II ou concernant les réformes postérieures de la liturgie et du droit, et qui paraissent difficilement conciliables avec la Tradition, nous nous engageons à avoir une attitude positive d’étude et de communication avec le Siège apostolique, en évitant toute polémique. »
17 Cf. L.-M. de Blignières, « La communion dans tous ses états. Pour une “communion dans la vérité” au service de l’évangélisation », Sedes Sapientiæ, n° 130, décembre 2014, pp. 9-29.
18 Celles de Louis Bouyer, Joseph Ratzinger et Klaus Gamber sont célèbres. Moins connue est celle de Jean-Marie Lustiger, Le Choix de Dieu, Paris, Éd. de Fallois, 1987, pp. 333-338.
19 Contre cette opinion, cf. Pie XII, Discours aux participants du Congrès international de pastorale liturgique, 22 septembre 1956 ; Concile Vatican II, Unitatis redintegratio, n° 6 ; Sacrosanctum concilium, n° 21.