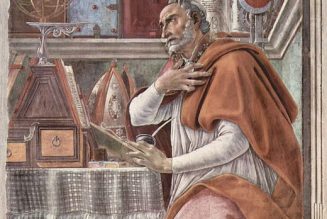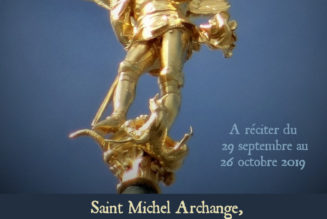De Cyril Farret d’Astiès pour les lecteurs du Salon beige :
Double page de La Croix le 11 juillet consacrée au silence dans la liturgie et au chant grégorien ! Ne boudons pas notre plaisir et réjouissons-nous ! Bravo la Croix ! Merci La Croix !
A présent que nous nous sommes bien réjouis, émettons tout de même une ou deux remarques amicales en passant.
Ces deux articles, dont les thèmes et l’idée générale font plaisir à lire, sont toutefois empreints d’un esprit liturgique qui nous semble profondément blessé et dénaturé. La réforme liturgique a atteint son but. Non pas en rendant plus claire les vérités de la foi et en obtenant une pleine efficacité pastorale (les deux ont échoué), mais en faisant de la participation le critère d’interprétation de l’action cultuelle (peut-on encore dire sacré ? je renvoie ici à une tribune récente de Jean-Pierre Maugendre. Dans les deux articles on nous invite une fois encore à participer : par le silence et par la pratique du chant grégorien.
Que l’on me permette quelques développements puisque nous avons un peu plus de temps en ce beau mois de juillet de canicule tiède et pluvieuse.
Le premier article débute par cette immense blague que l’auteur croit probablement très sincèrement :
« On observera aussi en son temps un silence sacré ». Par ces quelques mots le concile Vatican II introduit une nouveauté dans la liturgie (…).
La réforme liturgique est épouvantablement bavarde, elle a éradiqué le silence liturgique, véritablement liturgique. Car l’authentique silence liturgique est tout sauf une pause, une inaction dédiée à la contemplation ou à la méditation (très recommandables par ailleurs). La liturgie est une œuvre, un culte public qui ne cesse, par des paroles et des actes codifiés, de louer Dieu (elle est publique même quand le prêtre est seul à célébrer ou à prier avec son bréviaire). Le silence de la liturgie traditionnelle est encore prière publique et action de louange. Tout l’offertoire (éradiqué) est pour les laïques une prière silencieuse de participation à l’unique sacrifice. Le canon (et plus encore la consécration) sont toujours silencieux mais pas muets. La messe basse (disparue) est une action liturgique admirable quasiment silencieuse (ou qui devrait l’être) qui avait tant impressionné le cardinal Ratzinger lors d’un séjour à Fontgombault.
Dans les églises où est habituellement célébrée la nouvelle messe il est très fréquent de compter pas moins de quatre micros qui enlaidissent le chœur : un pour le prêtre à son siège, un à l’autel, un à l’ambon, un pour l’animateur des chants de l’assemblée. La nouvelle messe qui est fondée sur un très fort besoin communautaire donne une place extrêmement importante aux monitions, commentaires, mots d’accueil, avis… Les monitions proposées sont nombreuses et même difficiles à dénombrer avec certitude, les textes officiels invitent partout à la prise de parole : accueil de la communauté, avant la liturgie de la parole, avant et après la prière universelle, avant et après la communion… on peut également donner des indications sur les attitudes à observer. La fonction de commentateur est même définie comme ministérielle (Présentation générale du missel romain n° 105).
L’intériorité, le calme et le véritable silence de la liturgie traditionnelle ont disparu. Ce cœur à cœur dans le chuchotement a fait place à une célébration presque entièrement à voix haute afin de favoriser le dialogue et la participation. Irrépressible besoin volontariste d’activité et de partage, ancré au cœur du nouveau missel. Les temps réservés de silence de la nouvelle messe constituent une pause dans ce courant d’activisme, d’agitation et de papotages permanents. Comme personne ne sait jamais combien dureront ces pauses, il est d’ailleurs impossible d’en faire jaillir la moindre pensée méditative profonde. La pause silencieuse qui suit le sermon est probablement bien plus souvent mise à profit par les mères de famille (il en reste) pour tenter de se souvenir du temps de cuisson du rôti de bœuf…
Le second article consacré au grégorien avoue qu’il ne s’agit pratiquement plus que d’une pratique culturelle et non plus cultuelle : « Fondateur en 1974 du Chœur grégorien de Paris, (Louis-Marie Vigne) soutient sa conservation en tant que patrimoine culturel. » Si la suite de l’article entre davantage dans l’incomparable forme de prière que constitue le chant propre de l’Église, on sait en réalité qu’il est pratiquement incompatible avec l’application de la réforme.
Dans toute la Présentation générale du missel romain (84 pages au format A4), on trouve une fois, une seule malheureuse fois ! mention du chant grégorien au n° 41 pour rappeler avec Vatican II que le « chant grégorien, en tant que chant propre de la liturgie romaine, doit, toutes choses égales d’ailleurs, occuper la première place. » Ceci étant dit, on s’empresse de l’oublier au profit du chant polyphonique et de toutes les musiques qui pourront accompagner la messe. Jusqu’au n° 399 qui clôt la présentation générale on ne reparlera plus jamais du grégorien. Ce n’est pas très étonnant car le chant grégorien s’adapte mal à la nouvelle messe. Le grégorien c’est l’anti-choix, son exigence rebute l’homme moderne, tout comme son intériorité et son orientation. Fondé principalement sur l’ornementation chantée de la parole divine, il est monodique ce qui protège du sentiment que sait susciter la polyphonie – parfois à bon escient. Sa technique vocale nécessite une exécution par un chœur dédié, ce n’est pas une ritournelle démocratique et cet esprit va donc à l’encontre de l’esprit participatif ; pourtant, par son âme, le grégorien favorise la véritable participation, l’union intérieure de l’assemblée au mystère et à la louange. Si la liturgie n’est pas orientée vers Dieu mais vers l’homme, il est malheureusement logique que le « chant propre » de l’Église ne trouve plus sa place ; ni la « première », ni même un simple strapontin. Un moine bénédictin écrivait : « Avec lui, nous sortons du domaine proprement esthétique, artistique et musical. Si l’art est chez lui réel, il est tellement simple et spontané qu’il s’efface devant son objet. L’art grégorien n’a pas sa fin en lui-même. Il est essentiellement en fonction d’autre chose. Il est avant tout prière, il n’est que prière. C’est à Dieu seul qu’il s’adresse, et non pas même aux fidèles, sinon secondairement et comme par surcroît. » En cela on voit bien que le chant grégorien est entièrement liturgique.
Ce qui est déroutant dans ces deux articles débordants de bonne volonté et aspirant à une liturgie plus liturgique, c’est,d’une part, l’incapacité à voir le réel (je pense ici aussi au fameux livre de l’abbé Nadler), d’autre part la résolution farouche à ne surtout pas découvrir la liturgie traditionnelle qui étancherait pourtant la soif spirituelle des auteurs. C’est dommage mais ce n’est pas désespéré.
Rendons à Dieu, mais réellement et totalement ! le culte qui lui est dû par la liturgie traditionnelle.
Cyril Farret d’Astiès