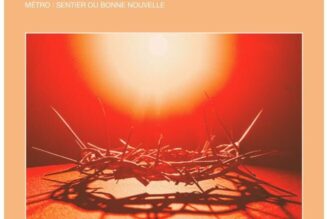Texte proposé par Rémi Fontaine pour Le Salon beige :
Selon le président de la Conférence des évêques de France répondant à un séminariste, s’il y a un problème avec les « traditionalistes », ce serait donc surtout une question de théologie politique et de rapport au monde :
« Le décret de Vatican II sur la liberté religieuse est très clair. Le Christ n’est pas venu bâtir des nations catholiques mais il est venu fonder l’Eglise. Ce n’est pas la même chose. A force de traîner la nostalgie d’un Etat catholique, on perd notre énergie pour l’évangélisation. »
Et d’évoquer notamment le pèlerinage de Chartres…
Dans un opuscule intitulé Dix dialogues sur la crise de l’Eglise (DMM, 1983), d’une actualité et d’une (post)modernité étonnantes, Louis Salleron lui avait pour ainsi dire déjà répondu à la manière d’un Socrate chrétien. Il s’agit du sixième dialogue sur la politique de l’Eglise mais tous les autres dialogues mériteraient d’être (re)lus en ces nouveaux temps de crise (en particulier ceux sur la messe, la morale, l’avenir de l’Eglise, le pape…). Ils offrent cette richesse de donner à réfléchir pour son interlocuteur (ou son lecteur) catholique sans trancher, selon une maïeutique propre mettant en relief des paradoxes qui n’auraient certainement pas déplu à Chesterton.
Je ne peux ici qu’en tirer un seul (paradoxe) avec quelques bribes déjà éloquentes :
« Un poison permanent de l’Eglise, c’est la politique. Mais on n’y peut rien. Du fait que l’Eglise est société, elle est politique… A cet égard elle a des activités secondaires et subordonnées à sa mission propre. »
Jusque-là Mgr de Moulins-Beaufort pourrait sans doute adhérer au propos. Comme à celui cité du P. Bruckberger :
« Jour heureux où, par la force des choses, l’Eglise sera réduite à sa mission essentielle : gardienne infaillible de l’Evangile, du dépôt de la foi, de l’intégrité des sacrements, annonciatrice de Celui qui vient ! »
Sauf que Bruckberger, précise Salleron, évoquait prophétiquement le « choix tragique » auquel les papes, selon lui, seront bientôt aculés : ou bien adjurer le Christ et passer à l’ennemi pour garder les « défroques » du césaro-papisme ; ou bien rejeter définitivement tout rôle politique, pour assurer uniquement, fût-ce par le martyre, la fonction du Vicaire du Christ et de pasteur des âmes (Toute l’Eglise en clameurs, Flammarion, 1977, p. 68).
Il semblerait qu’entre les deux termes de l’alternative, l’Eglise post-conciliaire n’ait pas encore vraiment choisi, étant plus dépendante de la politique qu’elle ne le croit, d’avantage en tout cas ou d’une autre manière plus « empoisonnée » ou sournoise que les « traditionalistes » qu’elle stigmatise caricaturalement. Les plus politisés (au sens d’une confusion du spirituel et du temporel) ne sont pas forcément ceux qu’on imagine ! « Entre une Eglise de chrétienté et une Eglise des catacombes, pensent aujourd’hui nos évêques libéraux, il doit bien y avoir place pour une Eglise libre dans une société qui l’admette sans la reconnaître pour autant comme seule et unique détentrice de la vérité. Dans une société de ce genre, l’Eglise ne peut s’abstenir de tout rôle politique. » Sans doute, mais « la question est alors de savoir ce que doit être ce rôle politique et l’importance à lui accorder ». Le résultat est loin d’être satisfaisant : n’y voit-on pas trop souvent s’exercer le reliquat (« les défroques ») d’un pouvoir clérical ancien qui, pour exister et se survivre, s’auto-sécularise, c’est-à-dire fait passer le social, l’écologie, la politique… avant sa mission surnaturelle devenue secondaire ? Nous retrouvons là un peu le mauvais « esprit de Vatican II ». Et ses prolongements. Mais aussi son « aporie » ainsi expliquée par le cardinal Ratzinger dans Eglise, œcuménisme et politique, que Louis Salleron ne cite pas et pour cause (Fayard, 1987, p. 288) :
De l’aporie du cardinal Ratzinger…
Il y a incompatibilité entre la prétention pluraliste de l’Etat démocratique moderne et la prétention de l’Eglise à en appeler à une vérité plus grande ou plus haute. Or, d’une part, le nouveau droit à la liberté religieuse (hérité de Vatican II) reconnaît la légitimité d’un Etat dit pluraliste, soi-disant « incompétent » en matière religieuse (1). D’autre part, l’Eglise est le « lieu d’une dimension publique absolue, qui dépasse l’Etat, par la prétention de Dieu qui la rend légitime » (Robert Spaemann). Sa prétention de vérité de la foi, comme telle, est une revendication publique à laquelle ne peut échapper l’Etat, qui doit aussi rendre à Dieu ce qui est à Dieu. D’où le paradoxe énoncé cette fois par le Cardinal :
« Si l’Eglise renonce à cette revendication, elle ne fait pas pour l’Etat ce dont celui-ci a justement le plus besoin. Mais si l’Etat assume cette prétention, il s’élimine lui-même en tant qu’Etat pluraliste, et l’Eglise et l’Etat se perdent eux-mêmes. »
Il faut donc sortir de ce mauvais dilemme. Mais comment ?
On saisit la double impasse de cette aporie qui pèche au niveau de sa majeure commune comme le raisonnement de l’archevêque de Reims lui-même (successeur de saint Rémi !) : non, il n’y a pas forcément incompatibilité entre les deux prétentions (temporelle et spirituelle). L’Eglise n’est pas réduite, comme on le voit maintenant en France, à devenir une simple partie de l’ensemble des « forces sociales », au risque de renoncer à sa mission divine d’enseigner avec autorité la vérité et les valeurs universelles dont elle est la gardienne. C’est-à-dire au risque d’aliéner ou de dissoudre sa Révélation et de se perdre également par une intégration « dans le panthéon de tous les systèmes de valeurs possibles » (dictature du relativisme). Et de perdre pour le coup son énergie pour l’évangélisation à force de traîner dans l’utopie d’un Etat neutre soi-disant a-confessionnel, alors même que celui-ci professe le plus souvent le culte de l’homme sans Dieu (2). L’Etat n’en est pas plus condamné à devenir théocratique (indistinct du religieux) dans l’hypothèse (pour l’instant improbable) où il reconnaîtrait le droit supérieur de l’Eglise en matière religieuse et morale, qui n’empêche pas une certaine tolérance et pluralité religieuses.
… à l’alternative du Père Bruckberger
L’histoire et la tradition, avec la chrétienté et les nations catholiques, offrent le principe d’une juste solution, qui, si elle n’est pas sans trébuchements et dérives (toujours le « poison » de la politique ou du « cléricalisme »), se résume dans la théorie classique de la double souveraineté des pouvoirs (temporel et spirituel). L’encyclique Quas primas précise : « Les hommes ne sont pas moins soumis à l’autorité du Christ dans leur vie collective que dans leur vie privée. » Pas moins mais d’une manière autre évidemment (comme on feint de ne pas le comprendre), son Royaume n’étant pas de ce monde. Mais quand, par la force des choses, la sécularisation et l’apostasie galopantes, l’entrecroisement des cultures, tout cela n’est de fait plus possible ? La distinction, enseignée par l’Eglise pour unir, mérite assurément une nouvelle réflexion selon le principe de réalité qui ne retire rien au principe doctrinal, comme le proposait Benoît XVI en théologien politique et avec son herméneutique de la continuité.
Bien sûr la communauté surnaturelle de personnes qu’est l’Eglise fondée par le Christ n’est pas la même chose que la société temporelle de familles qu’est la nation (voulue par le Créateur) et que l’Eglise doit informer (au sens philosophique) quelque soit l’unité ou la division de croyances en place. Mais si elle ne peut plus y trouver une certaine correspondance culturelle, l’Eglise devra forcément agir en contre-culture, comme pour les premiers chrétiens, avec ce que le pape émérite appelait des « minorité créatrices » ou des « îlots de chrétienté ». L’énergie pour l’évangélisation, qui va des catacombes à la chrétienté en passant par la mission, ne doit pas s’étioler et se perdre en sens inverse dans le nouveau panthéon de l’Etat moderne. On en revient ainsi à l’exclamation du P. Bruckberger (« Jour heureux… »). Ou bien à Péguy, dont le pèlerinage de Chartres à la Pentecôte reprend justement l’énergie pour la nouvelle évangélisation avec la grâce des nouveaux commencements : « Il faut que France et chrétienté ressuscitent ! » Charles Péguy, dont Jean Madiran redonne aussi l’esprit en le paraphrasant :
– Car, voyez-vous Monseigneur, c’est un grand mystère, il ne suffit pas d’avoir la foi. Nous sommes faits pour vivre notre temporel en chrétienté. Ailleurs quand ce n’est pas le martyre physique, ce sont les âmes qui n’arrivent plus à respirer.
Rémi Fontaine
(1) Etrange nœud gordien que ce nouveau droit à la liberté religieuse que l’Eglise post-conciliaire, dans une sorte de contradiction interne, prétend reconnaître sinon imposer civilement à des Etats devenus en principe incompétents en matière religieuse ! L’Eglise enseigne à l’Etat que l’Eglise renonce à toute préséance religieuse vis-à-vis de l’Etat qui doit l’accepter religieusement comme un droit politique pour tous, dont l’affirmation repose sur la non-reconnaissance par l’Etat de l’enseignement de l’Eglise ! Mais à quel titre alors et de quel droit ?
(2) Cf. Ni laïque ni musulmans (2010), Sous le signe d’Antigone (2012) ou Après la Chrétienté (2023) aux éditions Contretemps.