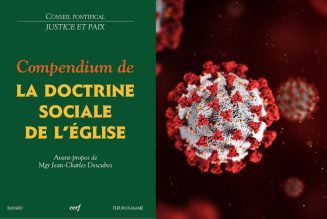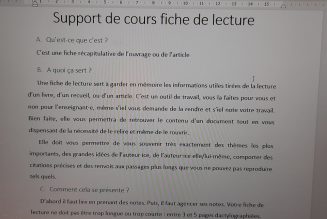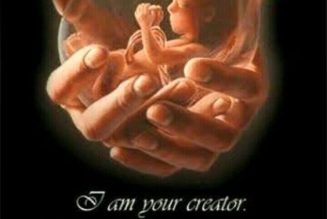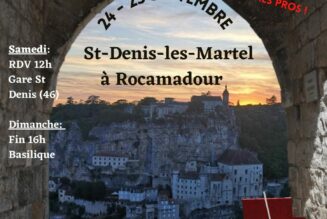Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.
Antoine Blanc de Saint-Bonnet, écrivain catholique et royaliste du XIXe siècle, dont l’aura aujourd’hui est presque raison inverse du succès obtenu par certains de ses ouvrages à l’époque, est parfois considéré comme l’un des fondateurs des « sciences économiques » en France.
D’aucuns parleraient d’« économie » tout court. Lui disait l’« économique », modelant ce terme sur celui de « politique ».
Or, à l’occasion d’une récente réédition (Antoine Blanc de Saint-Bonnet, La Restauration française, Larroque-Engalin, Éditions du Drapeau blanc, « Collection de la Légitimité » », 2022) de son livre à succès de 1851, La Restauration française. Mémoire présenté au clergé et à l’aristocratie, il semble opportun de se pencher sur les thèses économiques que l’auteur prodigua avec étendue dans cet ouvrage paru après la révolution de 1848, qui fut aussi l’occasion d’une crise économique aiguë – peut-être la première vraie dépression capitaliste en France ?
Les « économistes » actuels riraient sans doute beaucoup de Blanc de Saint-Bonnet : tout ce que lui critique (ou presque tout), c’est exactement, non ce qu’ils préconisent eux, mais ce qu’ils prennent pour des axiomes irrécusables – des principes qu’ils n’auraient jamais pensés remettre en cause ou ne serait-ce qu’interroger.
Saint-Bonnet se fait l’apôtre d’une économie traditionnelle, caractérisée par le catholicisme (donc pas de prêt à intérêt), l’agriculture et la vie domestique. Nos contemporains le trouveraient archaïque… et c’est ce qui doit déjà nous indiquer a priori la grande valeur de son point de vue, quand on a des yeux pour voir les ravages des économies dites modernes ou avancées.
Et Antoine Blanc de Saint-Bonnet révulserait encore nos économistes contemporains de plateaux en fondant d’abord la science économique (entre autres choses), non sur de prétendus faits, mais sur le dogme :
« Selon les faits ! c’est-à-dire, selon ce que l’homme a voulu faire ! Car, selon le dogme, ce serait un abominable piège de prétendre que l’erreur est un commencement de vérité. La vérité est absolue, deux et deux ne feront jamais cinq : son premier droit, sa première vertu est nécessairement l’intolérance. Seulement, en venant à l’homme, la pratique rencontre la charité » (p. 424 de la réédition).
1. Sur la bourgeoisie
Bourgeois aristocratique (si l’on peut dire), Blanc de Saint-Bonnet reconnaît comme Karl Marx (et beaucoup d’autres) que la révolution de 1789 fut une révolution bourgeoise, menée par des bourgeois (mais pas par tous les bourgeois). Le royaliste n’entend pas condamner les bourgeois en tant que tels, ni ne veut les faire disparaître – à moins de les porter peu à peu, naturellement, comme cela se faisait sous l’Ancien Régime, vers l’aristocratie, la noblesse. L’un de ses objectifs était donc de convertir, pour ainsi dire, les bourgeois, afin qu’ils portassent un vent de vérité et non plus d’erreur : si de voltairiens ils devenaient chrétiens, et si de cupides ils devenaient terriens, le tour était joué. Sans cela, les bourgeois condamneraient irrémédiablement la France, et eux aussi par la même occasion, ce dont 1848-1849 fut un premier avertissement :
« La cupidité poussa la bourgeoisie jusqu’à se détruire elle-même ; ses membres se devaient mutuellement leurs faillites. Par le principe de la concurrence, ils abattaient parmi eux les petits capitaux, sans voir qu’ainsi leurs rangs s’éclaircissaient. Jamais la noblesse dans ses usages, ni le peuple parmi les siens, n’offrit un tel exemple » (p. 133).
Ce constat n’est pas sans ressemblance avec la situation actuelle, où le degré qualitatif serait plus élevé et l’échelle désormais mondiale : il ne resterait plus que la bourgeoisie du CAC 40 ou de la finance internationale, et leurs sbires immédiats – un phénomène souvent décrit par les sociologues et politologues, en France, comme correspondant à la disparition progressive de la classe dite « moyenne ».
Le goût pour le luxe de la Cour au XVIIIe siècle est passé, avec un peu moins de bon goût et d’élégance, chez les bourgeois d’après 1789, en fonction de leurs moyens (petite bourgeoisie, moyenne bourgeoisie ou grande bourgeoisie). Cet amollissement est le malheur de cette « classe », et, par elle, de toute la France qui se calque dessus :
« Sans être prophète pour se prononcer sur la France, on peut prédire qu’en cet état nous périssons. Il faut que, remontant le cours d’un siècle à la nage, sa bourgeoisie s’ennoblisse, et qu’à son tour la noblesse se sanctifie.
Il ne s’agit plus seulement de l’épée, le territoire est formé ; il ne s’agit plus seulement de richesses, le capital est fondé. Ni l’épée ni la richesse ne suffiront à fonder la nouvelle aristocratie. Ce qui nous manque pour vivre, c’est la vertu » (p. 298).
Ce n’est donc que par la vertu que la bourgeoisie aurait pu et pourrait entrer en bien dans l’Histoire, et ce n’est que par la vertu, également, que la France peut se sauver.
2. Sur le crédit et le papier-monnaie
L’histoire du papier-monnaie n’est pas bien glorieuse : l’universitaire et économiste Antony C. Sutton a pu, au siècle dernier, en retracer les désastres (La Guerre contre l’or, Barcelone, Éditions Ethos, 2022), depuis la Chine du temps de Marco-Polo jusqu’à l’hyperinflation allemande (au moins), en passant par le dollar continental, les assignats et bien autres exemples. Et pourtant, la monnaie est toujours plus virtualisée, de crise en crise…
Il aurait été étonnant qu’un Blanc de Saint-Bonnet tenant à la terre et à la production réelle ne s’inscrivît pas dans la tradition du concret, d’autant mieux d’ailleurs qu’il ne rapporte pas tout aux métaux précieux, mais bien plutôt au capital (le vrai), richesse réelle, que son esprit rural et agricole lui faisait saisir comme naturellement :
« On ne crée du papier que quand on n’a plus d’argent : donc il représente notre misère ! On ne demande du crédit que quand on n’a plus de ressource : donc il achève ce qui reste du capital ! S’il était possible d’en créer par des lois, vous sentez que pas un peuple n’aurait péri sur la terre…
Visitez toute la terre, vous n’y trouverez pas de place préparée pour le vice ; mettez le luxe sur un point, vous ferez le paupérisme sur les autres. Retournez tant et plus le sol, vous n’y rencontrerez que ces deux lois faites pour l’Infini : le produit ne peut dépasser le travail, le capital ne peut dépasser la vertu » (p. 136).
Dans ces derniers mots se trouve peut-être le cœur de la philosophie économique de Saint-Bonnet : la vertu est à la racine du capital authentique, et donc de toute richesse méritant ce nom – et, par la même occasion, de l’ordre social.
Tenant que les erreurs politiques ont pour origine des erreurs religieuses, Antoine Blanc de Saint-Bonnet pense la même chose des erreurs économiques. Or, en matière spirituelle, la première de toutes les erreurs, le premier de tous les péchés, ce fut celui d’orgueil, le péché même de Lucifer. C’est le même orgueil qui fait des ravages en politique et en économique :
« Bientôt, plus de commune, plus de service public, plus de défense, plus d’abri ; ni grande ni petite propriété, ni foyer domestique, ni semailles, ni récoltes : l’orgueil, dans sa rage, brûle, ravage ses propres ressources, dévastant tout, même le sol ! Ère effroyable, d’où rien ne se sauvera, que ce que Dieu aura résolu de sauver… » (p. 420).
3. Le primat de l’agriculture
Certes, le terme agriculture a des relents de technicisme, visibles dans l’usage courant du nom de métier « agriculteur » ayant remplacé le bon vieux paysan de jadis. Blanc de Saint-Bonnet préfère ainsi parler d’« état agricole » plutôt que d’« agriculture » à la sauce contemporaine.
La pensée de Saint-Bonnet en la matière paraît très fénelonienne. On la croirait descendre de certaines belles pages des Aventures de Télémaque. Et l’argumentation du philosophe est de soi imparable, aussi bien pour le pire arriéré que pour le capitaliste qui devrait désirer l’amélioration et l’accumulation du capital (mais il y préfère bien souvent ses plaisirs et le luxe) :
« Voici le point d’où il faut partir. L’homme sera toujours apte à consommer plus qu’il ne peut produire. Dans quel état, et par quel moyen, est-il amené à produire plus qu’il ne consommera ? Telle est la vraie question en politique.
Cet état est l’état agricole ; ce moyen est le sol, qui reçoit tout et ne rend qu’à mesure. La terre végétale est la grande Caisse d’épargne tenue par le Créateur » (p. 144).
La Révolution a bouleversé la société française, profondément catholique d’abord, et rurale aussi, en dilapidant et gâchant le capital agricole accumulé jusque-là, après l’avoir spolié. Cet état de fait est encore observable de nos jours, et ce n’est peut-être qu’en vertu des engrais et pesticides chimiques que l’agriculture continue de survivre, en attendant peut-être que la chute finale soit plus violente que jamais par cela même :
« Depuis 89, en France on a fait pire encore, on a détruit les bois pour faire de l’argent. L’atmosphère et le sol sont privés de leur précieuse action. On est allé jusqu’à défricher les pentes rapides. Les sommets se dénudent, et la terre en est descendue. Les eaux pluviales, au lieu de s’infiltrer le long des troncs et des racines pour produire des sources au pied des monts, courent sur le sol et amènent les inondations ! La dénudation des montagnes amènera la destruction d’une partie du territoire français » (p. 266).
Plutôt que les « agriculteurs », Saint-Bonnet fustige les « paysans endimanchés », fruit malsain de l’égalitarisme mettant (quasiment) au même niveau une foultitude de petits propriétaires en compétition et envieux les uns des autres, sans bénéficier de l’ascendant tempérant de la grande propriété : « Sans la grande propriété qui, pendant tant de siècles a conservé nos bois, préservé nos champs et contenu les populations [c’est-à-dire en empêchant l’exode rural], le paysan eût détruit la France. Et c’est le sort que lui réservent tant de paysans endimanchés dont le nombre s’accroît par tous les négoces faciles » (p. 266).
4. Sur la technocratie
Évidemment, le mot technocratie n’apparaît point sous la plume d’Antoine Blanc de Saint-Bonnet, qui précède de plus d’un siècle l’Union européenne. L’idée naissait cependant, sous sa forme antérieure : le début du management, soit la manie de tout organiser, un produit dérivé du contrat social, inhérent au socialisme utopique et, tout compte fait, à toute forme de matérialisme. C’est avec un certain humour que Saint-Bonnet s’attaque à cette maladie de l’institutionnalisme ou organisationnalisme :
« La profession de foi du premier journal venu, vous donnera le programme des doctrines de l’époque. Il en est qui vous proposeront de quinze à vingt Institutions fondamentales.
Et avant tout : Institution du crédit, pour que ceux qui n’ont jamais fondé du capital, en disposent ; Institution des banques hypothécaires, pour que les malheureux qui n’ont pas assez emprunté, continuent ; Institution pour la presse, parce que la parole est inviolable et qu’elle n’a pas encore assez produit de mal ; Institution pour la liberté des Cultes, pour que tous ceux à qui la loi de Dieu déplaît, en puissent établir une autre ; Institution pour l’éducation gratuite, parce qu’il n’y a pas assez d’hommes déclassés et qu’il convient de multiplier les révolutionnaires ; Institution pour l’instruction professionnelle, parce qu’il n’y en a pas assez qui laissent la carrière de leur père pour mourir de faim ou vivre dans la honte ; Institution pour la justice gratuite, parce qu’il n’y a pas assez de procès, et que la chicane doit être un droit du pauvre ; Institutions gratuites des sciences et arts, parce qu’on ne quitte point assez la charrue pour l’industrie et l’agiotage ; Institution assurant le capital exposé, pour que l’État garantisse la paix à l’ambition et à l’imprévoyance ; Institution pour reporter tout l’impôt sur les riches, afin d’étouffer le capital au moment où il peut se former et prendre son essor ; Institution pour l’avènement du faible à la liberté absolue, à la fraternité sociale, à la science universelle, à l’émancipation des nécessités physiques, enfin à la réalisation de tous les droits ! » (p. 169).
Plus sérieusement, cet esprit organisateur se traduit dans le régime politique en vigueur, animé par le socialisme :
« La Société aurait tous les devoirs, laissant à l’homme tous les droits, mettant l’institution à la place de la conscience, remplaçant la nature humaine par les prévisions de la loi, comme si c’était la Société, et non l’homme, qui dût gagner le ciel ! » (p. 195).
Un simple retour de balancier, et le mécanisme s’inverse… Nous y sommes : l’État a tous les droits, son sujet n’en a plus que de factices et de faux.
*
Il ne tient qu’à nous de reprendre la main sur nos devoirs et d’alléger notre conscience là où le joug est suave, afin d’avoir notre place auprès du Créateur.
Jean de Fréville (Vexilla Galliae)