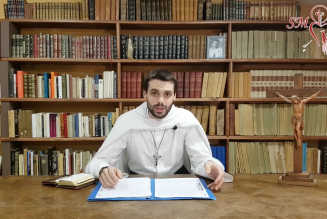De Cyril Farret d’Astiès :
A l’occasion de leur pèlerinage jubilaire, le pape François a reçu il y a peu les recteurs des derniers séminaires français. Il leur a adressé quelques mots au sujet de leur lourde tâche.
Je ne m’arrête pas au coup de griffe du Souverain Pontife à l’encontre de ceux qui persistent à se faire appeler « Monsieur l’abbé ». Depuis bientôt douze ans, nous sommes habitués à ces saillies pontificales, nous n’y prêtons presque plus attention. Nous avons appris à connaître notre pape, c’est ainsi, il ne peut pas s’en empêcher, faisons avec… Nous connaissons tous de vieux oncles bougons et irascibles ; de jeunes neveux facétieux prennent d’ailleurs plaisir à leur tirer les moustaches pour voir un peu ; c’est aussi le charme des grandes familles.
Le reste du discours est autrement intéressant alors que les séminaires ferment les uns après les autres, en France en particulier : quels conseils de formation donne-t-il, comment former les séminaristes, et in fine, qu’est-ce qu’un prêtre ?
Il ne s’agit pas de rejeter ce qu’indique le pape aux recteurs quand il parle psychologie, discernement, formation intégrale, respect de la liberté intérieure des candidats… Ce qui frappe cependant c’est l’image du prêtre qu’il dessine. Pour le pape « l’objectif du séminaire est de former des disciples missionnaires (…) » ; il affirme de manière très insistante (à trois reprises) que le « prêtre est toujours pour la mission. » Le pape précise encore qu’on « ne devient pas (prêtre) pour soi, mais pour le peuple de Dieu, pour lui faire connaître et aimer le Christ. »
Il y a là me semble-t-il, et ce n’est pas neuf, l’écho d’une compréhension parcellaire du sacerdoce. Pas fausse évidemment, loin de là, mais partielle, j’oserais presque dire amputée, secondaire, trop humaine, quasi sociale, une myopie. On aimerait tant que le pape parle davantage de vie intérieure, de vie liturgique, de l’office divin, des sacrements, de l’étude intellectuelle des grandes vérités de la foi pour mieux les contempler et mieux les transmettre ! Tout ce qui est propre au prêtre, tout ce qu’il ne peut déléguer, tout ce pourquoi Dieu a voulu se réserver des lévites. Tout ce d’ailleurs que les jeunes gens de 18 ans qui entrent au séminaire viennent chercher, eux qui ne sont pas fait pour le plaisir mais pour l’héroïsme comme le disait Claudel. Quelle différence entre le discours trop prosaïque du Pape et la belle allocution donnée par le cardinal Sarah pour la troisième Conférence internationale du clergé catholique le 15 janvier : « La beauté et la mission du prêtre. » En ce qui concerne la direction des séminaires, le dernier ouvrage de l’abbé Barthe me semble également bien plus roboratif.
Cette perception limitée du pape sur le sacerdoce est aujourd’hui très partagée. Sur les pages internet du diocèse de Paris consacrées à la vocation sacerdotale, on peut lire cette surprenante définition du prêtre diocésain inscrite en très bonne place et en gras : « Le prêtre diocésain est d’abord le collaborateur avisé de son évêque. Il est associé au ministère de l’évêque d’une manière particulière. » Et si l’on en croit toujours ce site destiné à attirer des vocations sacerdotales, ce ministère consiste à « prendre soin du peuple de Dieu, à être attentif aux pauvres et aux malheureux, à ramener dans la maison de Dieu ceux qui sont égarés ». Qu’est-ce qui, dans ces quelques lignes, fait la spécificité du prêtre par rapport au simple baptisé ? Moi aussi je veux et je dois par mon baptême annoncer l’Évangile sans relâche, prendre soin du peuple de Dieu, être attentif aux pauvres et aux malheureux, ramener dans la maison de Dieu ceux qui sont égarés… Le notaire diocésain et le chargé de communication de l’évêque sont, eux aussi, les collaborateurs avisés de l’évêque.
Tu es sacerdos in aeternum. L’Église a pourtant toujours eu une compréhension bien plus haute, plus surnaturelle de la nature du sacerdoce.
Le catéchisme du concile de Trente enseigne que « les fonctions du Prêtre sont d’offrir à Dieu le Saint Sacrifice de la Messe et d’administrer les sacrements de l’Église. » En 1959, dans une lettre mettant fin à l’expérience des prêtres ouvriers, le cardinal Pizzardo, secrétaire du Saint-Office, rappelait à l’assemblée des cardinaux et archevêques français :
« C’est essentiellement pour exercer des fonctions sacrées que le prêtre est ordonné : offrir à Dieu le Saint Sacrifice de la messe et la prière publique de l’Église, distribuer aux fidèles les sacrements et la parole de Dieu. Toutes les autres activités du prêtre doivent être ordonnées en quelque manière à ces fonctions ou en découler comme des conséquences pratiques (…). »
Le catéchisme de l’Église catholique est un peu moins limpide, l’article consacré au sacerdoce commence par cette définition qui semble tourner en rond (n° 1536) :
« L’Ordre est le sacrement grâce auquel la mission confiée par le Christ à ses Apôtres continue à être exercée dans l’Église jusqu’à la fin des temps : il est donc le sacrement du ministère apostolique. »
Au n° 1566 en revanche, on retrouve cette précision classique :
« C’est dans le culte (…) que s’exerce par excellence leur charge sacrée (…). De ce sacrifice unique, tout leur ministère sacerdotal tire sa force. »
Depuis plusieurs décennies, la conviction que le prêtre est d’abord l’homme de l’autel a perdu de son évidence. L’esprit managérial détestable qui consiste à imposer des solutions techniques, des process d’organisation, une gouvernance en vue d’améliorer le résultat quantifiable de la mission, s’est infiltré jusque dans le sanctuaire de l’Église. D’où le succès déconcertant de sociétés de coaching comme https://www.talentheo.org/ . On trouve les métastases de cette mentalité naturaliste répandues partout : dans les séminaires, les diocèses mais aussi les communautés religieuses… Cette pensée utilitariste et fonctionnelle éclipse lentement l’inutilité, la gratuité, mais aussi la lenteur, la saine oisiveté — quand elle est méditation et non paresse —, l’otium pour utiliser un mot cher à Marc Fumaroli.
L’ancien missel montre bien combien le prêtre, du moins au cours de l’action sacrée, est un homme à part dont la vocation est de sacrifier. L’ordre qui, le jour de leur ordination, marque les prêtres d’un caractère indélébile et surnaturel leur permet d’agir à notre profit, in persona Christi. Ce caractère demeure en dehors de l’action sacrée et doit se voir dans le comportement du prêtre – par la retenue et l’habit notamment – et dans le respect des fidèles – déférence, vouvoiement… Ce caractère indélébile perdurera au Ciel. Dans la Jérusalem céleste, dans la belle diversité des ordres mineurs et majeurs, les clercs participeront à la liturgie éternelle qui sera notre récompense commune. Il ne sera plus question de mission, le sacerdoce n’en poursuivra pas moins son œuvre essentielle de louange.
Cyril Farret d’Astiès