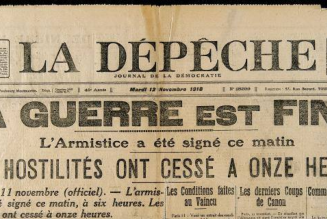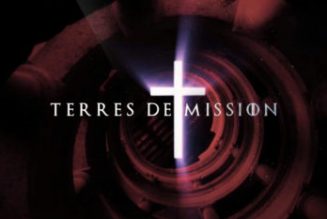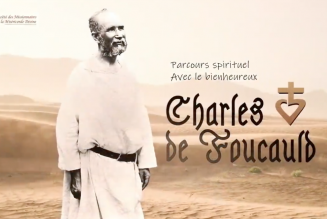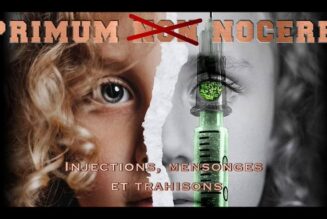Revenu au milieu de l’autel, le prêtre entonne certains jours le Gloria in excelsis, aussi appelé « grande doxologie », par opposition à la « petite doxologie », le Gloria Patri[1].
1. Histoire et usage
Initialement, cette hymne d’origine grecque n’a pas été composée pour la messe, mais elle y sera progressivement intégrée.
Pendant un temps assez long, il ne fut permis de le chanter qu’à la Messe de minuit à Noël[2], en référence à ses premiers mots. Puis, au début du VIe siècle, on l’autorisa les dimanches et aux fêtes des martyrs, et ce seulement pour les évêques, les prêtres ne pouvant le réciter qu’à Pâques. À la fin du XIe siècle, il n’y avait plus de limitation pour les prêtres et la règle actuelle se généralisait : « on récite le Gloria à chaque messe dès qu’elle a un caractère de fête. »[3]
Concrètement, il s’agit des dimanches – hormis ceux de l’Avent et du Carême – des fêtes de Notre-Seigneur, de la Bienheureuse Vierge Marie et des saints, ainsi que des féries du temps de Noël et du temps pascal.
2. Attitudes rituelles
En entonnant le Gloria, le prêtre étend et élève les mains, avant de les rejoindre :
« C’est un geste que l’amour des choses célestes a toujours fait faire, pour montrer qu’on voudrait les embrasser et les posséder. »[4]
On s’incline à plusieurs reprises pendant la récitation du Gloria, pour témoigner la révérence envers Dieu, et notamment en disant Deo, « par respect pour le saint nom de Dieu », également au nom de Jésus, de même que pendant le reste de la messe :
« Comme le crucifix [placé au centre de l’autel] représente l’homme Dieu, et non pas la personne du Père et du Saint-Esprit, le prêtre ne s’incline qu’aux [noms] de Dieu ou de Jésus-Christ, et non pas quand il prononce le nom du Père ou du Saint-Esprit. »[5]
Le Gloria s’achève par un signe de croix.
3. Structure
On peut discerner trois parties dans le Gloria[6] :
1° – le chant des anges dans la nuit de Noël [de Gloria à bonae voluntatis] ;
2° – la louange à Dieu [de Laudamus te à Deus Pater omnipotens] ;
3° – l’invocation du Christ [à partir de Domine Fili unigenite].
| 1°
Chant des anges |
Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. | Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. |
| 2°
Louange à Dieu |
Laudámus te. Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te. Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. Dómine Deus, Rex cœléstis, Deus Pater omnípotens. | Nous vous louons, nous vous bénissons, nous vous adorons, nous vous glorifions et nous vous rendons grâces pour votre gloire immense, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu Père tout-puissant. |
| 3°
Invocation du Christ |
Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus Altíssimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. Amen. | Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, vous qui enlevez les péchés du monde ayez pitié de nous, vous qui enlevez les péchés du monde accueillez notre prière, vous qui siégez à la droite du Père, ayez pitié de nous. Car c’est vous le seul Saint, vous le seul Seigneur, vous le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Ainsi soit-il. |
Ainsi, le Gloria tout entier est un développement des deux thèmes essentiels du chant des anges qui en constitue la première partie :
– à Dieu, la gloire : dans la deuxième partie, nous faisons chœur avec la louange chantée par les chœurs angéliques ;
– aux hommes, la paix : dans la troisième partie, nous nous adressons à Celui en qui la paix du ciel est venue à nous, le suppliant d’achever son œuvre[7].
4. 1re partie : Le chant des anges.
« Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. » (Lc 2, 14)
Est-ce un souhait ou un fait ?
« … le cantique des anges ne renferme pas seulement un souhait, mais exprime la situation de fait : voici que gloire est donnée à Dieu et paix aux hommes.
C’est, simplement à une autre phase de son développement, le fait que Notre-Seigneur décrit lui-même à la fin de sa vie dans sa prière sacerdotale, en ces mots : “Je t’ai glorifié sur terre, j’ai accompli l’œuvre que tu m’avais chargé d’accomplir.”[8]
Mais justement parce que la glorification de Dieu et le salut de l’humanité ne seront “accomplis” que par le sacrifice de la Passion du Seigneur et parce que ses fruits auront encore à mûrir et mûriront jusqu’à la fin du monde, il reste exact que le cantique des anges dans l’Évangile ne célèbre pas encore l’événement effectif, mais le plan de salut, le dessein, ce qui doit maintenant se réaliser graduellement : gloire soit à Dieu là-haut et paix aux hommes de sa grâce.
Ceci s’applique à plus forte raison au cantique tel que nous le répétons pendant la vie terrestre de l’Église. Chaque jour de la vie de l’Église, chaque fois qu’elle rassemble ses enfants pour la prière, et surtout pour la célébration de l’Eucharistie, une lumière nouvelle se répand dans le monde ; elle voit avec une exaltation joyeuse, mais en même temps avec une nostalgique impatience, le royaume de Dieu approcher ; elle voit approcher, en dépit de toutes les résistances, la réalisation du dessein grandiose gloire à Dieu, et, aux hommes qu’il a élus, paix et salut. »[9]
De quelle « bonne volonté » s’agit-il ?
Les commentateurs sont partagés sur un point : la bonne volonté – eudokia en grec – évoquée ici est-elle celle celles des hommes, ou bien celle de Dieu ?
Pour les uns, ce mot doit s’entendre d’un sentiment humain, en sorte que le sens du texte, sans nier la grâce, toujours nécessaire pour que la volonté humaine soit bonne, « constate simplement que la paix sera le partage des hommes bien intentionnés »[10].
Pour d’autres, « [bona voluntas] n’est pas la bonne volonté des hommes, mais la bonne volonté de Dieu, sa complaisance, sa faveur et sa grâce. Les [homines bonae voluntatis] sont donc les hommes de sa grâce, de son choix, les hommes à qui est apporté l’annonce du royaume de Dieu. »[11]
5. 2e partie : La louange à Dieu
« Laudámus te.
Benedícimus te.
Adorámus te.
Glorificámus te.
Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.
Dómine Deus, Rex cœléstis, Deus Pater omnípotens. »
L’accent fondamental de cette louange est l’« hommage adressé à un Dieu si grand ». Même lorsqu’il s’agit de rendre grâces [grátias ágimus tibi], le motif de cette action ne réside pas d’abord dans les bienfaits reçus, mais dans la gloire de Dieu elle-même [propter magnam glóriam tuam]. Ainsi, l’hommage rendu à Dieu va jusqu’à le remercier de sa grande majesté
On ne prétend pas « calculer le tribut dont la créature est redevable à Dieu, ni lui rendre grâces en reconnaissance des seuls bienfaits reçus. […] le regard se fixe d’abord sur la gloire et la beauté de Dieu ; nous sommes heureux de pouvoir louer sa majesté »[12]
À cette louange contribue la liste des noms divins : Seigneur, Roi du ciel, Dieu, Père, Tout-Puissant.
6. 3e partie : L’invocation du Christ
« Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus Altíssimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. Amen. »
Le regard qui s’est élevé vers la gloire de Dieu se porte ensuite sur le Christ, en qui cette gloire s’est révélée et communiquée à nous. Le plan est le suivant : adresse de louange ; triple invocation en forme de litanie ; triple confession par Tu solus ; conclusion trinitaire.
Adresse de louange et triple invocation
Parmi les titres employés, on notera particulièrement celui d’« Agneau de Dieu » [Agnus Dei], agneau du sacrifice, venu de Dieu, auquel font références les deux premières des trois invocations qui suivent [Qui tollis peccat mundi…] :
« Ce n’est pas un hasard si le titre d’Agneau de Dieu, expression la plus profonde de la miséricorde de Notre-Seigneur, [est uni] à l’appel à sa pitié. […] l’appel à l’Agneau de Dieu est suivi d’une courte litanie. […] elle est à la fois hymne de louange et invocation suppliante reprenant les mots de saint Jean-Baptiste, nous rappelons au Seigneur, par une discrète allusion, l’humiliation volontaire qu’il a prise sur lui en tant qu’Agneau de Dieu, la Passion expiatrice par laquelle il a “enlevé” les péchés du monde, mais aussi son triomphe et son exaltation “à la droite du Père”, où, précisément comme Agneau de Dieu, il reçoit des élus la jubilation du chant des noces. Alors peut éclater dans l’hymne angélique, comme auparavant dans le Kyrie, l’appel à la miséricorde : “Aie pitié de nous, agrée notre supplication !” »[13]
Triple confession (Tu solus) – Conclusion trinitaire
« À l’origine de notre hymne, on a sûrement perçu très vivement dans ces déclarations l’opposition aiguë aux cultes païens avec leurs attributs divin prodigués à la légère, leur foule de [seigneurs] et en particulier leur culte de l’empereur. Au-dessus de tous ces produits de l’imagination humaine se dresse, rayonnant de grandeur, Jésus-Christ, le Seigneur “unique” [Tu solus]. »[14]
La conclusion trinitaire nous ramène à la gloire de Dieu qui est à l’origine et à la fin de toutes choses.
7. Le Gloria et les fins de la messe
Concluons en observant que le Gloria explicite les quatre fins du Saint-Sacrifice de la messe :
– L’adoration, la glorification de Dieu en raison de son excellence même : laudamus te, adoramus te, benedicimus te … propter magnam gloriam tuam.
– L’action de grâce, la reconnaissance pour les bienfaits reçus : gratias agimus tibi…
– La propitiation, le pardon de nos péchés : qui tollis peccata mundi, miserere nobis…
– La supplication, la demande de nouveaux bienfaits : suscipe deprecationem nostram…
8. Le nom de « collecte »
Nous avons déjà évoqué la distinction entre l’ordinaire et le propre. Ce dernier contient en particulier trois oraisons qui se distribuent au début, au milieu et à la fin de la messe. La première d’entre elles, qui arrive après le Gloria (ou le Kyrie, si l’on n’a pas chanté le Gloria), n’a pas de nom particulier dans le missel, où elle est tout simplement appelée « oraison ». Mais l’usage veut que l’on appelle cette oraison « collecte », pour la distinguer des deux autres oraisons, à savoir, la secrète et la postcommunion.
Ce nom vient du verbe latin colligere qui signifie « rassembler » et a donné en français le verbe « collecter ». En effet:
Cette oraison est appelée collecte car elle rassemble en un résumé concis les demandes que l’on doit adresser à Dieu. »[15]
La collecte est, de fait, la prière où le prêtre résume et présente à Dieu la prière du peuple. Ceci est particulièrement sensible à la grand-messe, où la collecte est la première occasion où le célébrant prend solennellement la parole au nom de l’assemblée réunie. Ce qui précède en effet, se compose soit de chants qui, hormis l’intonation du Gloria, sont confiés à la chorale, soit de prières que le prêtre récite avec ses assistants pendant l’exécution des chants.
9. Dominus vobiscum et Oremus
Conformément à ce rôle, la collecte est introduite par une invitation à prier – « Oremus » [« Prions »] – et précédée d’une salutation adressée au peuple : « Dominus vobiscum » [« Le Seigneur soit avec vous »] :
Au moment même où le prêtre présente à Dieu la prière de tous, [le prêtre souhaite que] le Seigneur soit proche d’eux, et que la grâce de Dieu accompagne leur prière. »[16]
Mais il y a plus, car « le Dominus vobiscum revient à chaque fois qu’une invitation ou un avis doit être adressé au peuple : invitation à s’unir en esprit à la prière du prêtre, […] annonce de la fin, […] »[17].
Le Dominus vobiscum remplit donc la fonction d’une interpellation, qui a d’abord pour but d’attirer l’attention sur l’avis qui va être adressé au peuple (en l’occurrence, l’invitation à la prière) et qui signale chaque fois un point important dans le déroulement de la liturgie[18]. En effet :
Avec [la collecte] nous atteignons un premier sommet dans le cours de la messe. Le rite d’entrée s’achève par l’oraison du prêtre, comme la présentation des offrandes [l’offertoire] et la réception de la communion par la secrète et la postcommunion. »[19]
Quant aux formules employées pour le salut – « Dominus vobiscum » – et la réponse – « Et cum spiritu tuo » –, elles remontent aux origines chrétiennes et même au-delà[20].
« Dominus vobiscum » ou, au singulier « Dominus tecum » est une salutation que l’on retrouve dans l’Ancien Testament et dans le Nouveau, par exemple, dans le livre de Ruth, Booz salue les moissonneurs d’un « Dominus vobiscum »[21]. C’est également la formule employée par l’ange Gabriel à l’Annonciation : « Dominus tecum benedicta tu in mulieribus »[22], ou encore par saint Paul s’adressant aux Thessaloniciens : « Que le Seigneur soit avec vous tous. » [Dominus cum omnibus vobis.][23]
La réponse se trouve chez le même apôtre, s’adressant par exemple à Timothée : « Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. » [Dominus Iesus cum spiritu tuo.][24]
Par « ton esprit » [spiritu tuo], il faut simplement entendre « ta personne », c’est-à-dire « toi ». Tel est le naturel de la réponse : « Quel le Seigneur soit aussi avec toi. » Toutefois, il n’est pas interdit, avec saint Jean Chrysostome, d’appliquer « ton esprit » au Saint-Esprit habitant dans l’âme de celui à qui l’on s’adresse[25]. Le saint docteur voit même dans le mot « Esprit » l’indication que le prêtre accomplit le sacrifice par la vertu du Saint-Esprit[26].
Quoiqu’il en soit, « la meilleure interprétation de l’Et cum spiritu tuo est celle qui y voit l’assemblée non pas d’abord comme conférant au prêtre un pouvoir ou une délégation, mais reconnaissant en lui le porte-parole qui doit la conduire et auquel elle veut s’unir pour s’approcher de Dieu. »[27]
10. Attitudes rituelles : orientation de la prière et position des mains
En récitant l’oraison, le prêtre se tient debout, tourné vers l’orient [liturgique], les mains levées.
Tourné vers l’orient…
Nous avons déjà eu l’occasion de signaler l’importance symbolique des points cardinaux dans la liturgie. Dans ce domaine, ce n’est pas le nord qui tient lieu de référence, mais l’est, l’orient.
C’est en effet la direction du soleil levant (oriens en latin), symbole du Christ, ainsi que le suggère l’antienne à Magnificat des vêpres du 21 décembre (solstice d’hiver) :
Ô soleil levant, splendeur de la lumière éternelle et soleil de justice, venez et illuminez ceux qui sont assis dans les ténèbres et les ombres de la mort.
D’après l’évangile selon saint Matthieu, c’est également de l’orient que le Christ doit revenir[28].
Ainsi, l’orientation de la prière et, par conséquent, des églises prit dès les Ve et VIe siècles une grande importance.
Si les premières églises, du moins certaines d’entre elles, étaient orientées à l’occident, c’est qu’elles reprenaient le modèle des temples païens, qui permettait au soleil de passer par l’entrée le matin et d’éclairer la statue du dieu. C’est encore le cas de certaines basiliques romaines, comme Saint-Pierre de Rome. Dans ces églises donc, le célébrant, faisant face à l’orient, faisait donc matériellement face au peuple. Mais il ne s’agissait pas de se tourner vers le peuple, mais bien de se tourner vers l’orient. D’ailleurs, le peuple lui-même se tournait vers l’orient à différents moments de la messe : Gloria, collecte, préface, …
Toutefois, l’orientation des églises vers l’orient devint la règle si bien que lorsque, pour une raison quelconque, cette orientation n’est pas respectée, on considère tout de même que, dans l’église c’est l’autel qui indique l’orient « liturgique » vers lequel le prêtre et tous les fidèles se tournent.
… les mains levées
[Citation] Quant à l’élévation des mains, elle accompagne la parole qui monte vers Celui qui réside dans les cieux. [Elle est susceptible d’exprimer], selon l’accent de la prière, aussi bien l’imploration passionnée que la vénération et le respect.[29]
On en trouve des exemples dans l’Ancient Testament, ainsi le prophète Jérémie :
Élevons nos cœurs avec nos mains vers le Seigneur, dans le ciel. »[30]
[On reconnaît également], dans cette position de l’orant, l’image du Crucifié, au nom de qui le chrétien se présente devant Dieu.[31]
Tertullien et saint Cyprien invitent le prêtre à ne pas exagérer ce geste : l’extension et l’élévation des mains doivent être mesurées et stylisées[32].
Cette attitude, est adoptée par le prêtre pour les plus anciennes prières de la messe : oraisons, préface, canon et Pater noster. Une autre attitude rituelle, empruntée à la tradition germanique, accompagne les prières plus récentes : les mains jointes.
Notons que l’invitation à la prière – Oremus, « Prions » – est dite par le prêtre qui étend et rejoint les mains en s’inclinant vers la croix : comme pour rassembler les prières diverses en une. Ce même geste de rejoindre les mains accompagne la conclusion de la collecte.
11. Forme et contenu de la collecte
Structure
La collecte suit généralement une structure précise, dont saint Thomas d’Aquin[33] nous explique qu’elle correspond à la nature même de la prière.
Trois conditions, enseigne-t-il, sont requises à la prière :
1° – Il faut s’approcher de Dieu que l’on prie. C’est ce que signifie le mot “oraison” [oratio], puisqu’il désigne l’élévation de l’esprit vers Dieu.
2° – Il faut aussi demander : ce qu’exprime les mot “postulation” [postulatio] ou “supplication” [supplicatio].
3° – Il faut enfin un motif d’obtenir ce qu’on demande, et on le prend du côté de Dieu et du côté de celui qui prie :
– du côté de Dieu, c’est sa sainteté, à raison de quoi nous demandons d’être exaucé : c’est le rôle de l’ “obsécration” [obsecratio], qui implore au nom de réalités saintes ;
– du côté de l’homme, la raison qu’il peut avoir d’obtenir ce qu’il demande, c’est l’ “action de grâce” [gratiarum actio] : « En rendant grâce pour les bienfaits reçus, puissions-nous en recevoir de plus grands », dit une oraison du missel.
Ces quatre éléments se retrouvent dans la plupart des collectes. Prenons par exemple celle de la fête de la Trinité,
| Oraison | Omnípotens sempitérne Deus, | Dieu tout-puissant et éternel, |
| Action de grâce | qui dedísti fámulis tuis in confessióne veræ fídei, ætérnæ Trinitátis glóriam agnóscere, et in poténtia maiestátis adoráre Unitátem : | qui avez donné à vos serviteurs, dans la confession de la vraie foi, de reconnaître la gloire de l’éternelle Trinité, et d’adorer une parfaite Unité en votre majesté souveraine : |
| Postulation / Supplication | quǽsumus ; ut, eiúsdem fídei firmitáte, ab ómnibus semper muniámur advérsis. | accordez, nous vous en prions, qu’affermis par cette même foi, nous soyons constamment munis contre toutes les adversités. |
| Obsécration | Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. | Par Notre-Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui avec vous vit et règne dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. |
C’est la postulation ou supplication qui constitue l’élément principal de ces oraisons : ce sont des prières de demande.
Que demande-t-on ?
« Beaucoup d’oraisons [de collecte] ne contiennent aucune demande précise autre que de voir exaucer les intentions des fidèles.
Ailleurs, on formule l’une ou l’autre des intentions permanentes et sans cesse renouvelées :
on demande le secours du bras divin,
la victoire sur l’erreur et le danger,
l’ardeur pour le bien,
la rémission des péchés,
l’obtention du salut.
On voit aussi apparaitre, dans les oraisons, les puissances qui s’affrontent dans le combat spirituel ; et cela spécialement sous la forme d’antithèses, représentant les courants opposés, qui se disputent notre route terrestre :
le corporel et le spirituel,
la pensée et l’action,
le poids de notre responsabilité et l’intercession des saints,
l’abstinence et le jeûne de nourriture et de péché,
la libération du mal et le service du bien,
la vénération et l’imitation,
la foi et la réalité,
vie terrestre et béatitude éternelle.
Particulièrement fréquente est la profonde opposition entre, d’une part, l’action extérieure, le service temporel, le don de soi dans la foi et, d’autre part, la réussite intérieure, le salut éternel, la réalité sans fin ; un peu comme l’exprime la collecte du XXIIe dimanche après la Pentecôte :
“ut quod fideliter petimus – efficaciter consequamur : ce que nous implorons avec foi, puissions-nous un jour dans la réalité y parvenir.” »[34]
Qui prie ?
« C’est l’Église qui prie : Ecclesia tua, populus tuus, familia tua, famuli tui, fideles tui, [ton Église, ton peuple, ta famille, tes fidèles] ainsi est désigné, dans l’oraison, l’être qui prie et le bénéficiaire des dons divins.
Dans tous les cas, le sujet est un “Nous” : quaesumus, rogamus, deprecamur. […] Si réduite que soit l’assemblée groupée autour du prêtre à l’autel, ce ne sont pas seulement quelques chrétiens qui sont là, mais l’Église même en sa structure hiérarchique, le peuple de la Nouvelle Alliance tel que le Christ l’a groupé et organisé. »[35]
Ancienneté
Terminons en mentionnant l’ancienneté des oraisons du missel, en particulier des collectes, dont le noyau essentiel – c’est-à-dire les oraisons de la plupart des dimanches et grandes fêtes – a dû se constituer du IIIe au VIe siècle, à l’époque où la liturgie vit le passage du grec au latin[36].