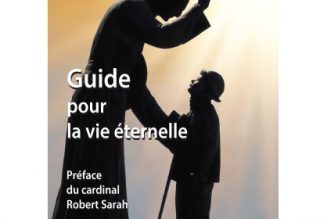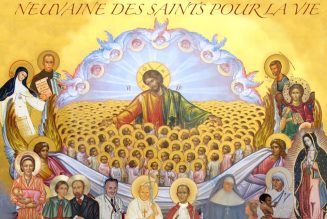De l’abbé Cras sur Claves :
La liturgie de la Semaine sainte nous offre d’entendre les quatre récits de la Passion du Christ : Matthieu (dimanche des Rameaux), Marc (mardi saint), Luc (mercredi saint) et Jean (vendredi saint). Il ne s’agit pas de quatre récits identiques, mais bien de quatre regards différents, en harmonie avec le projet de chaque Évangile.
Les différences entre les quatre versions sont méconnues. Dans l’inconscient collectif, la Passion du Christ correspond bien souvent aux souvenirs laissés par l’exercice du Chemin de la Croix, ou par le film de Mel Gibson. Beaucoup, par exemple, diront que Jésus a chuté trois fois, ce qui pourtant n’est pas précisé dans les textes. Et si on demande aux fidèles la différence entre la Passion lue le dimanche des Rameaux et celle du Vendredi saint, ils ne sauront que dire. Alors que les différences sont notables, et importantes à souligner, car Dieu a voulu les quatre versions, avec leurs tonalités particulières. La Passion du Christ est comme un grand diamant : il faut en découvrir chaque facette pour se faire une idée de l’ensemble, qui nous dépassera toujours. Car la Passion est un mystère de foi autant qu’un fait historique.
Marc et Matthieu
Ces deux évangiles sont très proches et montrent Jésus abandonné par les siens, affrontant seul une mort très douloureuse.
Tant chez Marc que chez Matthieu, la marche à la mort de Jésus est encadrée par deux prières. Au début, à Gethsémani, Jésus prie son Père et demande que le calice s’éloigne de lui, sans réponse. À la fin, au Golgotha, il prie encore, mais cette fois en disant « Mon Dieu » (la seule fois dans tous les évangiles) et en exprimant un sentiment d’abandon, qui est moqué par les spectateurs.
Les deux évangiles font état d’un procès juif suivi du procès romain. Dans les deux cas, Jésus est violenté physiquement. Ensuite, aucun ami ou disciple n’est présent au pied de la croix. Il n’y a que solitude, insultes et moqueries.
Finalement, en poussant un grand cri, Jésus expire, apparemment vaincu. Mais alors le Père intervient, alors qu’il semblait jusque-là comme absent. Il accomplit les paroles prophétiques de Jésus. Dans le procès juif, Jésus était accusé de vouloir détruire le Temple, et sur la croix on le lui rappela en se moquant de lui. Mais à sa mort, le voile du sanctuaire se déchire complètement. De même, Jésus avait été accusé de se prétendre le Messie, le Fils du Dieu béni, et bafoué pour cela sur la croix. Or, à sa mort, un centurion romain déclare : « Vraiment cet homme était le fils de Dieu ».
Ainsi ressort un thème bien marqué, que l’on trouvait déjà dans les chapitres précédents de Matthieu et Marc : Jésus doit souffrir et mourir, et ses disciples doivent prendre la croix et le suivre. Les deux évangélistes dramatisent les difficultés de la Passion : c’est à la fois un avertissement et une consolation pour les lecteurs. Si le maître lui-même trouve cela difficile, si les disciples perdent tout courage, c’est que la Passion dépasse les forces humaines. Mais Dieu a été finalement là pour Jésus, et il le sera aussi pour les disciples persécutés.
Les deux évangiles sont donc très proches, mais on peut relever quelques différences notables :
– Marc est très factuel. Il souligne l’échec des disciples à comprendre Jésus. Jésus n’y reçoit aucun soutien depuis la dernière cène jusqu’à sa mort. Marc est le plus brutal dans sa description de l’angoisse de Jésus et de la faillite des disciples. C’est en Marc qu’il y a le plus de souffrance. On peut dire que cet évangile se destine surtout à ceux qui souffrent et sont tentés de demander à Dieu : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
– Matthieu atténue un peu la noirceur de Marc. La prescience qu’a Jésus de ce qui doit lui arriver est plus claire, et sa souveraineté plus manifeste. Mais la grande différence avec Marc, c’est la question de la responsabilité : il faut désigner les coupables. Dans une série de scènes propres à Matthieu, on voit Judas essayant de rejeter sa responsabilité en rendant l’argent reçu, et les prêtres refusant cet argent. La femme de Pilate cherche à éviter à son époux sa responsabilité dans la mise à mort, et Pilate lui-même se déclare innocent en se lavant les mains. Pour Matthieu, tout le monde est coupable, à commencer par les chefs des Juifs à qui il fait dire : « que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». On peut noter aussi en Matthieu le thème de l’accomplissement des Écritures, ainsi que le rapport de la Passion de Jésus avec son enfance : dans les deux cas il y a des phénomènes cosmiques (étoile / tremblement de terre), dans les deux cas on voit des païens amenés à la foi (mages / soldats), dans les deux cas les manœuvres des puissants de ce monde sont vouées à l’échec (Hérode le Grand / Pilate). Tout l’évangile de Matthieu est cohérent et converge vers son point culminant, la Passion. La réflexion est bien organisée et plus aboutie. Elle présente une intelligence chrétienne des événements.
Luc, c’est l’évangile du pardon et de la miséricorde. Dans le récit de la Passion, il diverge beaucoup plus de Marc que ne le fait Matthieu. Il adoucit les événements. On n’y trouve pas l’insistance sur la solitude de Jésus, qui ne se dit pas triste à en mourir. À l’agonie à Gethsémani, il est même consolé par un ange. Surtout Jésus apparaît en communion constante avec son Père, au point qu’à la fin il ne s’écrie pas « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi… » mais il dit paisiblement : « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Luc ne mentionne même pas la fuite des disciples. Tout cela montre que la Passion selon Luc est moins négative. Le Père y est présent, et pas uniquement après la mort. Jésus guérit l’oreille blessée du serviteur du grand-prêtre, Jésus pardonne sur la croix, et promet le paradis au bon larron. Les Juifs ne sont pas tous hostiles : certains accompagnent Jésus jusqu’au Golgotha et s’en retournent en se frappant la poitrine, tandis que les filles de Jérusalem se lamentent sur lui. Cette version est plus émouvante : elle vise à toucher le cœur du lecteur pour l’encourager à devenir disciple.
Jean
La différence est nette avec les trois synoptiques, et avec Marc elle est très forte : la moitié environ du récit johannique diffère de la passion de Marc. On pourrait presque dire qu’en Jean, il n’y a pas de passion de Jésus. L’aspect historique de la Passion est déjà connu. Le déroulement exact des faits intéresse donc moins Jean que le message théologique qu’il faut en retirer.
La Passion selon Jean, c’est le récit de l’élévation et de la victoire de Jésus. La souffrance est minimisée. La scène de l’agonie à Gethsémani est omise, et il n’y a pas de procès juif. Le procès romain est très développé et manifeste la majesté de Jésus (scènes de l’Ecce homo et de l’Ecce rex vester). Le chemin de croix n’est pas détaillé. Sur la croix, Jésus n’est ni insulté ni moqué. Il n’exprime pas de sentiment d’abandon : il meurt avec le soutien de sa mère et du disciple bien-aimé. Tout est résumé en Jn 10,18 : « Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne ». Jésus et le Père sont un, et donc on ne voit pas Jésus demander (comme dans les synoptiques) que son heure soit repoussée ou que le calice de la Passion s’éloigne de lui. Au contraire, c’est son objectif : arriver à son heure, boire la coupe et accomplir sa mission, pour glorifier le nom de Dieu et accomplir les Écritures. Il contrôle tout. À Gethsémani, il n’a pas fléchi. Au contraire ce sont ceux qui venaient l’arrêter qui sont tombés à terre quand il a dit « c’est moi ». Jésus selon Jean, c’est le Fils de l’homme descendu des cieux et à qui le Père a remis tout jugement. Il ne peut donc pas être jugé par des créatures. Il faut souligner que le récit est structuré, avec pour centre le couronnement d’épines : Jésus est vraiment roi. C’est pourquoi il a pu dire au grand-prêtre : « pourquoi m’interroges-tu ? » Et à Pilate : « Tu n’as aucun pouvoir sur moi », ce qui l’impressionne. Tout au long de la Passion, Jésus n’est pas celui qui est jugé, mais celui qui juge. La victime est victorieuse… « Regnavit a ligno Deus » comme le chante l’hymne Vexilla regis : « Dieu a régné par le bois ». Notons bien que c’est la version choisie par l’Église pour le Vendredi Saint.
Conclusion
Les évangélistes ne se contredisent pas : ils se complètent, mettant en valeur les diverses facettes de la Passion. Comme Jésus l’a expliqué aux disciples d’Emmaüs : « ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » (Lc 24,26). De la souffrance à la gloire : les versions de la Passion expriment tout le parcours qui va de l’une à l’autre, de Marc insistant sur la souffrance, à Matthieu, puis Luc, puis Jean insistant sur la gloire.
Ainsi, on peut dire en forçant le trait que pendant la Passion :
– selon Matthieu et Marc, Jésus n’est vainqueur qu’aux yeux de Dieu. Sur la Croix il est méprisé.
– selon Luc, Jésus est vainqueur pour les disciples qui ont la foi. Sur la Croix il pardonne.
– selon Jean, Jésus est vainqueur aux yeux de tous. Sur la Croix, qui est son trône, il règne.
Comme l’Église le Vendredi Saint, il faut mettre en valeur ce dernier aspect, car la force des images fait que pour beaucoup de fidèles la Passion du Christ est celle que présente le film de Mel Gibson. C’est une vision ultra-réaliste et sanglante, basée sur Marc (et les révélations de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich). Elle est importante, mais pas suffisante. Si le Christ a dit à sainte Marguerite-Marie qu’il avait plus souffert à Gethsémani que sur la Croix, il faut mettre en valeur ses souffrances morales. Car nous n’avons pas été sauvés par la seule souffrance physique de Jésus, mais par la puissance de son amour, exprimé par son sacrifice, aussi intérieur qu’extérieur.