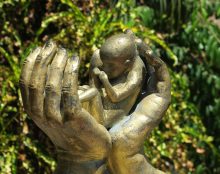“La proposition que nous discutons représente une rupture que je ne suis pas prêt à approuver à ce stade”
Intervention du député Stéphane Peu, président du groupe GDR (communiste), concernant l’article 2 de la loi sur l’euthanasie :
Je profite également de cet article 2 pour m’exprimer. Dans le prolongement des propos de Mme Firmin Le Bodo, j’aborde ce texte avec beaucoup de doutes, beaucoup d’humilité, beaucoup de questions. Je me félicite que le projet initial ait été scindé en deux, les soins palliatifs d’un côté et l’aide active à mourir de l’autre. Cela me semble une bonne chose.
La loi Claeys-Leonetti n’a que dix ans et elle est loin d’être appliquée. Nous venons d’adopter un texte sur les soins palliatifs et je ne comprends pas bien cette précipitation alors que la loi précédente n’est toujours pas appliquée. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe DR. – Mme Blandine Brocard applaudit également.)
La proposition que nous discutons représente une rupture que je ne suis pas prêt à approuver à ce stade. C’est une porte entrouverte, et nous savons que partout où une telle porte a été entrouverte, l’ouverture a ensuite été élargie à d’autres cas supplémentaires. À chaque fois, l’adoption d’une telle loi a représenté une rupture anthropologique. Nos concitoyens s’inquiètent beaucoup de la qualité des soins, de l’hôpital public, d’une loi sur le grand âge qui ne vient pas. Ils s’inquiètent également de la solitude de nos aînés, à laquelle notre société est bien en peine de répondre. Il y va de la responsabilité de la société tout entière, mais aussi de la responsabilité individuelle. Nous vivons un moment où l’individualisme triomphe et où bien d’autres périls menacent notre société – je pense notamment à la conception utilitariste et productiviste de l’être humain. Je me souviens qu’en 2020, lors de l’épidémie de covid, certains – notamment parmi les plus libéraux – ne comprenaient pas comment un pays pouvait mettre à l’arrêt son économie et dépenser autant d’argent pour lutter contre une épidémie qui ne concernait que les vieux.
Parler de « fin de vie » est trompeur
Première séance du mercredi 18 février 2026 à l’Assemblée nationale.
Article 1er (suite)
Mme la présidente :
Je suis saisie d’une série d’amendements identiques, nos 1, 81, 274, 284, 421, 487, 491, 827, 854, 1093, 1214, 1244 et 1807, tendant à supprimer l’article 1er. Sur ces amendements, je suis saisie d’une demande de scrutin public par les groupes Rassemblement national et Ensemble pour la République.
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 1.
M. Patrick Hetzel :
Nous souhaitons supprimer cet article, dont la rédaction est assez trompeuse. Il y est question de « fin de vie », alors qu’en réalité, il ne s’agit pas forcément de fin de vie : un malade peut être en phase avancée de la maladie mais avoir encore – et c’est heureux ! – quelques années à vivre. Je m’appuie à la fois sur les déclarations de l’Académie nationale de médecine et sur celles du Conseil consultatif national d’éthique (CCNE). Par ailleurs, 14 millions de personnes souffrent d’une affection de longue durée (ALD) dans notre pays ; toutes ne sont pas pour autant en fin de vie.
La loi doit respecter l’objectif constitutionnel d’intelligibilité, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être équivoque. Or parler de « fin de vie » pour désigner les situations couvertes par cette proposition de loi est équivoque. Nous aurons sans doute l’occasion d’y revenir, comme sur l’euphémisation qui est à l’œuvre, notamment lorsqu’on parle d’aide à mourir au lieu d’euthanasie ou de suicide assisté.
Il est important d’en discuter car ce dont il est question, c’est d’une rupture anthropologique – nous sommes un certain nombre à le penser, et beaucoup de nos concitoyens le pensent aussi. Les sondages de la Fondapol – Fondation pour l’innovation politique – montrent qu’à mesure que les débats avancent, les Français sont de plus en plus dubitatifs sur ces questions touchant à la fin de vie. Il est important que la société prenne conscience de la rupture anthropologique en train de se jouer dans notre hémicycle.
IVG, avortement et statut du fœtus : pourquoi le droit français est-il si contradictoire ?
Le législateur français a bâti autour du statut du fœtus une architecture juridique d’une complexité remarquable. Cette complexité n’est pas accidentelle : elle est le produit d’une tentative de concilier des impératifs irréconciliables. Mais en refusant de trancher la question ontologique — qu’est-ce qu’un être humain ? — le droit a généré une série d’anomalies qui, mises bout à bout, révèlent non pas une simple imprécision technique, mais une incohérence systémique. Examinons ces contradictions texte à l’appui.
L’absurdité géographique : quand quelques centimètres multiplient la peine par six
L’article 221-1 du Code pénal est sans ambiguïté : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. » (Code pénal, Livre II)
L’article 223-10 du même Code dispose : « L’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Or la distinction dans ces deux cas vient de l’attribution arbitraire de l’humanité de la part du droit français, en effet, on acquerrait notre personnalité juridique qu’une fois né viable. C’est pour cela qu’on distingue le fait de donner volontairement la mort à un fœtus, et le fait de la donner à un “humain” selon la loi.
La différence de traitement est vertigineuse. Un fœtus de sept mois, biologiquement identique d’une seconde à l’autre, voit son statut juridique basculer radicalement selon sa position dans l’espace. In utero, si un acte médical entraîne sa mort, la peine maximale est de 5 ans de prison. Ex utero, quelques secondes après l’expulsion, le même geste devient un meurtre passible de 30 ans de réclusion criminelle.
La question s’impose : comment expliquer qu’un trajet de quelques centimètres — la traversée du col de l’utérus — multiplie la peine par six ? La nature de la victime n’a pas changé. Son degré de développement est strictement identique. Sa capacité à ressentir la douleur, sa conscience, son activité cérébrale, son patrimoine génétique : tous ces paramètres biologiques sont les mêmes avant et après. Seule variable : la géographie.
Cette distinction révèle que le droit ne juge plus l’acte ni la victime, mais le lieu. L’humanité devient une convention territoriale. On ne protège plus un être ; on protège une localisation. Lorsqu’une loi pénale fait dépendre la qualification d’un homicide et l’ampleur de sa sanction de la position géographique de la victime, elle cesse de reposer sur un principe stable. Elle repose sur une fiction spatiale dont l’arbitraire est manifeste.
Notons d’ailleurs que cette incohérence n’est pas propre au droit pénal. Le Code civil lui-même contient une contradiction interne remarquable.
Quand le Code civil contredit le Code pénal : l’enfant conçu, tantôt né, tantôt inexistant
L’article 318 du Code civil dispose : « L’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt. » (Code civil, Livre I)
Cette règle, dite de l’infans conceptus, est un principe ancien du droit romain. Elle permet à l’enfant conçu mais non encore né de bénéficier d’une succession, de recevoir une donation, d’hériter. Le législateur reconnaît donc explicitement que l’enfant avant sa naissance peut être titulaire de droits patrimoniaux. Pour que ces droits puissent lui être attribués, il faut nécessairement qu’il soit considéré comme existant juridiquement.
L’article 725 du même Code civil confirme : dans les successions, l’enfant conçu est pris en compte s’il naît vivant par la suite. Le droit civil admet donc que l’enfant à naître possède une existence juridique rétroactive à la conception dès lors qu’il y va de son intérêt.
Or, confrontons cette reconnaissance à celle du Code pénal. L’article 223-10 sanctionne l’interruption de grossesse non consentie, mais ne qualifie jamais le fœtus de « personne ». L’article 221-1 sur le meurtre ne s’applique qu’après la naissance. Le Code pénal refuse donc de reconnaître au fœtus la qualité de sujet de droit protégé en tant que tel.
La contradiction est manifeste : le droit civil reconnaît l’enfant conçu comme existant juridiquement quand il s’agit de lui attribuer des biens, mais le droit pénal refuse de le protéger comme une personne quand il s’agit de le protéger contre la mort. L’existence juridique du fœtus est donc modulée selon la branche du droit concernée. Il existe pour hériter, mais pas pour être protégé. Il est « réputé né » pour recevoir, mais réputé inexistant pour survivre.
Cette asymétrie révèle que le statut juridique du fœtus n’est pas déterminé par une définition cohérente de l’humanité, mais par une sélection opportuniste selon les intérêts en jeu. Le droit ne définit pas ce qu’est un être humain, puis en tire des conséquences. Il définit d’abord le résultat souhaité — autoriser l’IVG, protéger la succession — puis ajuste le statut du fœtus en conséquence.
Ce que la France a signé et qu’elle préfère oublier
Le droit français ne vit pas en vase clos. Il s’inscrit dans un corpus de traités internationaux qui, en vertu de l’article 55 de la Constitution, ont une autorité supérieure aux lois nationales. Parmi ces traités figure la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), ratifiée par la France le 7 août 1990 et publiée par le décret n°90-917 du 8 octobre 1990.
Le préambule de cette Convention stipule explicitement : « Gardant à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l’enfant, “l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance”. » Texte intégral de la CIDE
Cette formulation n’est pas incidente. Elle reprend explicitement le principe IX de la Déclaration des droits de l’enfant de 1959. Elle est le résultat de négociations diplomatiques lors de la rédaction du texte. Elle signifie, en termes clairs, que l’enfant mérite une protection juridique appropriée avant la naissance.
La France a signé ce texte le 26 janvier 1990. Elle l’a ratifié le 7 août 1990. Elle en a accepté tous les termes, y compris ce préambule. Or, l’article L2212-1 du Code de la santé publique dispose : « La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l’interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse. » Code de la santé publique
Cette législation refuse précisément toute protection juridique au fœtus avant la naissance. La Convention affirme une protection « avant comme après la naissance » ; la loi française autorise explicitement la suppression du fœtus jusqu’à 14 semaines. L’incompatibilité est structurelle.
On objectera que le préambule d’une Convention n’a pas de portée normative directe, que des réserves ont été formulées lors de la ratification. Mais ces objections techniques ne changent rien au fond : un État qui ratifie un traité dont le préambule affirme la protection de l’être humain avant la naissance, puis légifère en sens inverse, n’est pas dans une position de cohérence. Il est dans une position d’inconfort qu’il gère par le silence.
Ce silence est révélateur. Si la contradiction était mineure, elle aurait été traitée explicitement. Une réserve spécifique sur ce passage du préambule aurait été formulée lors de la ratification. Rien de tel. La France a préféré laisser coexister deux régimes juridiques opposés, en comptant sur l’inattention pour que la tension ne soit jamais mise au jour dans le débat public.
L’application sélective des critères
Le législateur justifie implicitement le statut du fœtus en invoquant des critères biologiques : la conscience, la viabilité, l’activité cérébrale « organisée ». Mais ces critères, appliqués avec rigueur, posent un problème majeur : ils ne s’appliquent pas qu’au fœtus.
Le patient en état végétatif persistant ne présente aucune activité cérébrale organisée, aucune conscience vérifiable, aucune interaction sociale. S’il était soumis aux critères invoqués pour le fœtus, il cesserait d’être une personne au sens de la loi. Or, le droit français le reconnaît pleinement comme tel.
Le nourrisson de trois mois échoue au test de Gallup — test de reconnaissance de soi dans un miroir — jusqu’à l’âge de douze à dix-huit mois. Sa conscience de soi n’est pas établie. Sa rationalité est nulle. Pourtant, la loi le protège sans réserve.
Le patient atteint de démence sévère a perdu toute rationalité, toute mémoire de son identité, toute capacité d’interaction sociale. Les critères cognitifs de l’humanité, appliqués uniformément, ne le concernent plus.
Face à ces cas, deux positions seulement sont logiquement tenables :
Soit les critères retenus sont défectueux, car ils s’appliquent de manière inégale et révèlent qu’ils ne définissent pas l’humanité mais opèrent une sélection politique déguisée en argument biologique.
Soit les critères sont valides et doivent être appliqués uniformément — position que personne n’ose défendre, car elle conduit à des conclusions insoutenables.
L’absence de troisième option est instructive. Elle indique que le système actuel ne repose pas sur une définition cohérente de l’humanité, mais sur une décision politique préalable — autoriser l’avortement — que l’on a ensuite tenté de justifier après coup en bricolant des critères suffisamment étroits pour ne viser que le fœtus. Plus de détails ici
La confusion entre convention et universel
Tout ce qui précède converge vers une contradiction fondamentale : l’humanité juridique est traitée comme une convention, mais appliquée comme un universel.
Une convention sociale — la majorité à 18 ans, le permis de conduire — est une règle subjective destinée à réguler le « faire ». Elle est territoriale : l’interdiction de conduire sans permis s’arrête à la porte de votre propriété privée. Sa validité est contractuelle.
L’humanité, en revanche, relève de l’universel. Elle protège l’« être », non le « faire ». L’interdiction de tuer ne s’arrête pas au seuil de votre domicile. Elle ne dépend ni du contexte, ni du consensus. Elle traverse la frontière entre public et privé.
Or, en séparant l’être biologique du statut juridique, le législateur fait basculer l’humanité du côté de la convention. Si « être humain » devient une ligne sur un curseur législatif, elle perd sa portée inviolable. Ce que la loi accorde par convention, elle peut théoriquement le retirer selon l’époque ou le régime.
Mais le droit ne peut assumer cette logique jusqu’au bout. Car si l’humanité était vraiment conventionnelle, sa validité se limiterait au domaine public. On pourrait alors, chez soi, définir que certains individus n’y ont pas droit. L’absurdité est telle que le législateur préfère masquer la contradiction plutôt que de la résoudre — car la résoudre impliquerait d’admettre que le fœtus est un être humain, avec les conséquences juridiques qui en découlent.
Conclusion : Quand la cohérence cède devant l’impératif politique
Ces anomalies — l’absurdité géographique, la contradiction entre Code civil et Code pénal, la Convention internationale ignorée, les critères appliqués de manière sélective, la confusion entre convention et universel — ne sont pas des détails techniques. Ce sont les symptômes d’un système juridique qui tente de défendre une position indéfendable rationnellement.
Lorsqu’une loi multiplie les exceptions, les contradictions et les silences, ce n’est pas un défaut de rédaction. C’est le signe qu’elle protège non pas un principe, mais un résultat politique. Le droit français sur l’IVG ne repose pas sur une définition stable de l’humanité. Il repose sur un impératif : autoriser l’avortement. Tout le reste — les seuils, les critères, les peines — a été construit après coup pour donner une apparence de cohérence à ce qui, par nature, ne peut en avoir.
Un droit qui refuse de nommer ce qu’il fait ne protège pas la liberté. Il la simule. Et une humanité définie par commodité politique est une humanité en sursis.
Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.
La Turquie refuse de reconnaître son incapacité à respecter la liberté de religion et la liberté d’expression
Le Parti politique chrétien européen (ECPP) est déçu par la réaction du gouvernement turc à la résolution du Parlement européen condamnant l’expulsion ciblée de chrétiens et de journalistes étrangers. L’ECPP trouve profondément préoccupant que la Turquie refuse de reconnaître son incapacité à respecter la liberté de religion et la liberté d’expression.
Au cours des dernières années, la Turquie a interdit à plus de 300 missionnaires chrétiens étrangers de revenir dans le pays, les qualifiant de menaces pour la sécurité nationale sans preuve, sans procès et sans possibilité réelle de faire appel.
La semaine dernière, le Parlement européen a adopté une résolution condamnant fermement les expulsions ciblées de journalistes et de chrétiens étrangers menées sous des prétextes non fondés de sécurité nationale et sans procédure régulière. La résolution déplore l’absence d’accès aux preuves et à un contrôle judiciaire significatif, et réaffirme le soutien indéfectible du Parlement européen aux chrétiens et à la liberté de religion ou de conviction.
En réponse, le ministère turc des Affaires étrangères a publié un communiqué rejetant la résolution du Parlement et affirmant qu’elle « ne correspond pas à la réalité ». La déclaration rejetait également ce qu’elle qualifiait d’ingérence dans les procédures judiciaires et avertissait que la résolution allait à l’encontre des efforts visant à développer les relations entre l’UE et la Turquie, accusant le Parlement européen d’agir contre la Turquie et de tenter de s’ingérer dans ses affaires intérieures.
Le cri d’alerte de deux médecins en soins palliatifs
Claire Fourcade est médecin en soins palliatifs à Narbonne (Aude), ancienne présidente de la SFAP et Ségolène Perruchio est chef de service de soins palliatifs à Puteaux (Hauts-de-Seine), présidente de la SFAP. Dans une tribune publiée dans Le Figaro, elles alertent :
Quelques jours seulement après son examen au Sénat, la loi sur « l’aide à mourir » revient en deuxième lecture à l’Assemblée nationale dans une précipitation qui étonne autant qu’elle interroge.
Nous contestons en effet l’urgence d’un tel texte quand la fin de vie ne se classe qu’au 18e rang des priorités des Français du dernier baromètre Harris Interactive loin derrière bien d’autres questions, et en particulier celle de l’accès aux soins et dans un contexte national et international menaçant, incertain et anxiogène. La possibilité de demander à mourir est-elle la seule perspective à offrir ?
Nous contestons le récit dominant qu’on nous impose sur le consensus qui entourerait ce texte. La Fondapol (dans son étude très complète «les Français n’approuvent pas la proposition de loi visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté» de décembre 2025) comme les débats récents au Sénat et le vote très partagé de la première lecture à l’Assemblée, montrent les nuances et les ambivalences autour d’un projet clivant dès que l’on s’éloigne des questions binaires qui construisent des consensus factices pour entrer dans la complexité du sujet.
Nous contestons l’idée que la mort choisie et organisée par l’État serait la seule mort digne. Nous revendiquons l’égale dignité de toutes les personnes que nous accompagnons quelles que soient leurs vulnérabilités, leur âge ou leur utilité sociale. Sans exception.
Nous contestons qu’il s’agisse « d’une grande loi de liberté ». Liberté choisie pour un petit nombre certes, mais liberté perdue pour toutes les personnes « éligibles » dont la capacité à vouloir exister est rendue fragile par la maladie, la précarité ou la solitude de ne pas avoir à se demander si elles veulent continuer à vivre.
Nous contestons qu’il s’agisse d’une loi d’égalité quand tous les jours 500 patients meurent sans avoir eu accès aux soins palliatifs dont ils auraient eu besoin, quand la loi de 1999 garantissant un accès universel aux soins palliatifs laisse 50% des besoins non couverts et quand la stratégie décennale en cours n’a ni pilote, ni suivi, ni indicateurs.
Nous contestons qu’il s’agisse d’une loi de fraternité. « Ma vie, ma mort, mon choix, mon droit » est une logique ultra-libérale loin de la promesse d’un accompagnement inconditionnel et solidaire « parce que nous tenons à vous et que vous comptez pour nous tous ».
Nous contestons le tri des souffrances qu’impose cette loi. Comment déterminer de façon acceptable, claire et durable, les critères d’accès à ce nouveau « droit » ?
Nous contestons qu’il s’agisse d’une loi de modernité et de progrès social alors que les solutions qu’elle propose nous ramènent 40 ans en arrière quand la médecine pensait n’avoir d’autre choix que celui de donner la mort par les cocktails lytiques faute de mieux.
Nous contestons qu’il s’agisse d’une loi d’ultime recours pour des situations exceptionnelles. Elle devrait alors s’accompagner de conditions restrictives à l’image de la procédure autrichienne qui assume sa complexité. Le rejet de tous les amendements de protection et les critères larges et flous qui ont été adoptés consacrent au contraire l’ouverture d’un « nouveau droit » auquel rien ne doit faire obstacle : celui de choisir le moment de sa mort. Nous sommes en démocratie, ce choix est possible mais il doit être assumé clairement.
Nous contestons le tri des souffrances qu’impose cette loi. Comment déterminer de façon acceptable, claire et durable, les critères d’accès à ce nouveau «droit» ? Comment accepter que souffrir, expérience intime et subjective, puisse donner un droit à certains et non à d’autres ? Les personnes qui viendront demander l’accès à ce droit au motif de l’égalité de tous devant une souffrance qu’elles jugent insupportable seront bien sûr légitimes à le faire.
Nous contestons le pouvoir donné au médecin qui, à rebours de toute l’évolution récente de notre droit, se trouve être seul à décider, prescrire et administrer une substance létale au terme d’une collégialité et de délais minimaux et sans contrôle autre qu’a posteriori une fois la personne décédée. Il s’agit d’une loi du pouvoir médical et non d’une loi d’autonomie pour les citoyens.
Nous contestons la coercition exercée sur les soignants contraints, s’ils souhaitent user de leur clause de conscience, de rompre la promesse du non-abandon faite aux personnes accompagnées. Coercition également pour tous ceux qui voudraient soutenir le désir de vivre plutôt que celui de mourir par la création d’un délit d’entrave. Coercition enfin pour les établissements dont le projet s’opposerait à ces pratiques car si « les murs n’ont pas de conscience » comme on nous le répète, les murs ne soignent pas non plus, contrairement aux équipes qui les habitent.
Nous contestons l’idée d’une coexistence apaisée entre soins palliatifs et « aide à mourir ». Ce texte sera un frein aux progrès des soins palliatifs, du soulagement de la douleur et de l’accompagnement. Dans les dernières années, nous avons vu progresser à la fois les techniques (pompes d’analgésie intra thécale, chirurgie de la douleur…), les connaissances (développement des thérapies non médicamenteuses, littérature scientifique autour des souhaits de mort, « wish to hasten death ») et l’organisation des soins palliatifs (hôpitaux de jour orientés vers l’amélioration de la qualité de vie et permettant des soins palliatifs précoces, hospitalisation à domicile, projets de création de maisons d’accompagnement, équipes d’intervention rapide qui sont de véritables SAMU palliatifs…). Nous voyons naître outre- Atlantique, avec l’utilisation des thérapies psychédéliques, des perspectives qui pourraient révolutionner demain le soulagement de la souffrance. Qui peut croire que ce vaste mouvement se poursuivra inchangé si un tel texte est adopté quand on voit le recul spectaculaire des pays qui nous ont précédé sur ce chemin dans les classements internationaux de soins palliatifs (La Belgique a reculé de 21 places, le Canada de 11, l’Australie de 9 entre 2015 et 2021 quand le Royaume -Uni est resté 1er) ?
Nous contestons enfin que la mort provoquée puisse être considérée comme un soin qu’elle vient au contraire interrompre, supprimant la personne qui souffre et non sa souffrance et compromettant la confiance indispensable à la relation soignant-soigné.
Nous réaffirmons qu’un autre choix est possible et que la réponse à la souffrance ce n’est pas la mort mais le soin.
Levée de l’immunité parlementaire du député PS de l’Ariège Martine Froger
Le député socialiste de l’Ariège Martine Froger est mêlé à une enquête sur des abus de confiance, de biens sociaux et du travail dissimulé dans deux associations. Elle a omis de déclarer des revenus et la justice souhaite l’interroger. Le procureur a obtenu la levée de son immunité parlementaire.
L’enquête est menée depuis plus d’un an par le service de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN), le service de renseignement financier de Bercy.
Martine Froger, députée PS de l’Ariège, a omis de déclarer une partie de ses revenus à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, issus de deux associations ariégeoises dont elle était directrice salariée. Les deux associations sont le Centre d’accompagnement social aux techniques agropastorales (CASTA) et l’association BATI+, toutes deux liées à des chantiers d’insertion. L’enquête pointe aussi le fait que ces délits ont été couverts par d’autres personnes.
Mort de Quentin : la meute médiatique aux abois
Le dossier du jour : Quentin, lynchage mortel et mobilisation de la classe politico-médiatique
Les médias n’ont pas pu occulter l’affaire Quentin, tant l’émotion populaire était forte. Mais plutôt que le silence, ils ont choisi l’instrumentalisation. Les médias mainstream ont décidé d’orienter le récit pour charger l’extrême gauche tout en n’oubliant pas de cibler l’extrême droite. Jeune garde antifasciste et militants nationalistes se retrouvant ainsi face à face. Et si finalement c’était l’extrême centre qui sortait ses marrons du feu ? En présentant les deux extrêmes comme des repoussoirs, il s’impose comme le seul recours raisonnable, au mépris de la vérité des faits et de la mémoire de Quentin.
Les pastilles de l’info :
– Le ministère de l’Intérieur bascule LFI à l’extrême gauche, 70 % des Français approuvent.
– “Front commun contre l’extrême droite” : Les Inrockuptibles, Nova, StreetPress, Blast et L’Humanité sortent un hors-série
– Tuerie au Canada : Une femme ? Non un transsexuel !
– Sophie Adenot dans l’ISS : “La Terre est belle sans frontières”, le gauchisme de l’espace…
Portrait piquant : Patrick Cohen, l’éditorialiste bien-pensant
Fin de vie : une loi présentée comme un progrès, un recul éthique majeur
Intervention du député Patrick Hetzel à l’Assemblée à propos de la loi sur l’euthanasie :
L’Assemblée nationale examine actuellement, en deuxième lecture, une proposition de loi visant à instaurer en France un « droit à l’aide à mourir ». Présenté comme une avancée humaniste et comme l’ultime étape d’un progrès sociétal inéluctable, ce texte constitue en réalité une rupture profonde avec les principes éthiques qui fondent notre pacte social. Sous couvert de compassion, il introduit une logique nouvelle : celle selon laquelle donner la mort pourrait devenir une réponse légitime à la souffrance.
Chacun comprend l’émotion qui entoure les situations de fin de vie. Beaucoup d’entre nous ont été confrontés à la maladie grave d’un proche, à des douleurs difficiles à soulager, à l’angoisse de la déchéance. C’est précisément parce que ces situations sont humainement bouleversantes qu’elles appellent une grande prudence. La loi ne peut être écrite à partir de cas limites ou de récits poignants. Elle doit être élaborée en tenant compte de ses effets concrets sur l’ensemble de la société, sur les plus fragiles, et sur la manière dont nous concevons collectivement la dignité humaine.
Or la proposition actuelle repose sur une ambiguïté fondamentale. Elle prétend encadrer strictement l’aide à mourir, en la réservant à des situations exceptionnelles. Mais l’expérience des pays qui ont déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté montre que ces garde-fous initiaux s’érodent presque toujours. Aux Pays-Bas, en Belgique, au Canada, les critères se sont progressivement élargis : d’abord aux maladies non terminales, puis aux souffrances psychiques, parfois même à des mineurs ou à des personnes incapables d’exprimer leur volonté. Ce phénomène, bien documenté, n’est pas une dérive accidentelle : il est inscrit dans la logique même du dispositif.
Dès lors que l’on reconnaît qu’il existe des vies dont il serait légitime d’abréger le cours, comment refuser ce « droit » à d’autres situations jugées tout aussi douloureuses ? Une fois le principe admis, la frontière ne cesse de reculer. Ce qui est présenté aujourd’hui comme une exception risque fort de devenir demain une option thérapeutique parmi d’autres, voire une solution encouragée pour des raisons économiques ou organisationnelles.
Car il ne faut pas être naïf : dans un système de santé sous tension, la légalisation de l’aide à mourir modifiera inévitablement les pratiques et les mentalités. La pression, même implicite, sur les personnes âgées, dépendantes ou handicapées pourrait devenir considérable. Combien se sentiront coupables de « peser » sur leurs proches ? Combien finiront par demander la mort non par choix libre, mais par crainte d’être une charge ?
On affirme que cette loi consacrerait l’autonomie individuelle. Mais une liberté véritable suppose des alternatives réelles. Et c’est précisément là que réside l’un des dangers majeurs du texte : il risque de fragiliser le développement des soins palliatifs au moment même où ceux-ci devraient constituer la priorité absolue.
La France souffre déjà d’un retard important en la matière : inégalités territoriales criantes, nombre insuffisant d’unités spécialisées, formation encore trop limitée des professionnels, moyens humains et financiers souvent précaires. Dans de nombreuses régions, l’accès effectif à un accompagnement palliatif de qualité demeure aléatoire. Avant d’introduire un droit à provoquer la mort, n’aurait-il pas fallu garantir à tous le droit d’être soulagé, entouré, accompagné jusqu’au bout ?
L’éthique des soins palliatifs repose sur un principe clair : ne jamais abandonner le malade, soulager sa souffrance, l’accompagner sans chercher ni à hâter ni à retarder sa mort. En légalisant l’aide à mourir, on introduit une rupture profonde avec cette philosophie du soin. Le risque est réel de voir se développer une alternative faussement plus simple, moins coûteuse, et de détourner des ressources déjà insuffisantes. Là où l’on devrait investir massivement pour mieux soigner et mieux accompagner, on risque d’ouvrir une voie qui affaiblira durablement cette exigence.
Il existe également un enjeu majeur pour le corps médical. La vocation du médecin a toujours été de soigner et d’accompagner, jamais de donner la mort. En brouillant cette frontière essentielle, on fragilise la relation de confiance entre le patient et le soignant. Comment être certain, demain, que celui qui nous prend en charge agit exclusivement pour notre vie et pour l’apaisement de nos souffrances, et non pour abréger celle-ci ?
Refuser cette proposition de loi ne signifie pas ignorer la détresse des personnes en fin de vie ni se satisfaire du statu quo. Au contraire : c’est affirmer qu’une société humaine se grandit lorsqu’elle renforce la solidarité envers les plus vulnérables plutôt que lorsqu’elle organise leur disparition. C’est réclamer une politique résolue de développement des soins palliatifs, un accompagnement renforcé des familles, une présence humaine digne et compétente jusqu’au dernier instant.
La grandeur d’une civilisation se mesure à la manière dont elle traite ses membres les plus fragiles. En ouvrant la porte à l’aide à mourir, la France prendrait le risque d’un basculement anthropologique majeur, dont les conséquences pèseront longtemps sur les générations futures.
Nous avons le devoir collectif de chercher des réponses à la souffrance qui ne passent pas par la transgression de l’interdit fondateur de donner la mort. Soutenir, développer et sanctuariser les soins palliatifs constitue la voie la plus exigeante. Elle est aussi la plus fidèle à notre idéal d’humanité
Affaire Quentin : antifas criminels, gauche coupable et centre complice
Editorial d’Olivier Frèrejacques dans Liberté Politique :
Le drame qui a touché la capitale des Gaules il y a une semaine avec le meurtre du jeune nationaliste Quentin révèle une mécanique politique désormais criminelle rattachée à LFI, un système de complaisance du centre et un laisser-faire coupable du pouvoir macroniste.
Le déferlement médiatique autour du meurtre de Quentin, jeune nationaliste de 23 ans lynché par des militants antifa, a surpris jusque dans les rangs de la gauche, où l’on est d’ordinaire habitué à l’impunité. Le choc des images et la nouvelle donne médiatique n’ont cependant pas laissé de répit aux camarades de Jean-Luc Mélenchon. Les auteurs de l’attaque sont liés à La France insoumise : deux assistants du député Raphaël Arnault, ainsi qu’un de ses stagiaires, ainsi que d’autres militants de l’organisation antifasciste Jeune Garde. Cette structure criminelle faisait le service d’ordre de LFI à de multiples occasions et avait reçu le soutien appuyé de Mélenchon à de nombreuses reprises, notamment lors de sa dissolution en juin 2025. La gauche écologiste s’est également compromise avec ce groupement criminel. Le maire de Lyon lui-même a collaboré avec cette milice, l’affirmant publiquement.
Socialistes et macronistes : compères et complices
Plus généralement, toute la gauche rassemblée sous la bannière du Nouveau Front Populaire (NFP) a fait campagne autour de la Jeune Garde et a soutenu une alliance avec LFI qui impliquait ce rapprochement avec un groupe encore extra-parlementaire et violent. Le centre macroniste, en se retirant lors du second tour au profit des candidats NFP, a favorisé l’arrivée au Palais Bourbon de l’extrême gauche la plus violente. Par ailleurs, les autorités de l’État n’ont rien fait pour empêcher les agissements de la Jeune Garde après sa dissolution. Les noms, les coordonnées et les déplacements de ses membres sont connus des services, mais l’exécutif a laissé faire, et cela pour plusieurs raisons. Cette extrême gauche permet de pourrir les mouvements de contestation ; elle l’a fait lors des Gilets jaunes en venant casser là où la révolte, avant tout fiscale, était essentiellement pacifique. L’extrême gauche extra-parlementaire a également décrédibilisé les mobilisations syndicales lors de la loi travail, puis lors des manifestations sur la réforme des retraites. Enfin, ces organisations permettent de parasiter le débat politique en attaquant tout ce qu’elles considèrent comme fasciste, des LR au RN. Au-delà du drame qui s’est joué à Lyon, où un jeune homme a trouvé la mort, c’est le rapport de force politique qu’il convient d’envisager autrement. Il ne faut rien céder à l’extrême gauche, refuser son vocabulaire, sa réécriture de l’histoire et dénoncer sans relâche ceux qui la défendent directement et indirectement. Du centre complice à la gauche alliée et aux médias parasitaires, tous doivent être combattus.
Pour mieux comprendre la violence antifa, vous pouvez vous procurer les Cahiers de Liberté politique : Violences d’extrême gauche – Réalité, violences et réseau.
Jacques-Elie Favrot, assistant parlementaire du député insoumis Raphaël Arnault, a été mis en examen pour complicité de meurtre par instigation et placé en détention provisoire. Deux autres personnes ont été mises en examen pour homicide volontaire. Le magistrat avait requis la mise en examen de sept hommes pour homicide volontaire. Ils “contestent l’intention homicide”, a-t-il souligné. “Deux ont refusé de s’exprimer” pendant leur garde à vue, les autres “reconnaissent leur présence” sur les lieux de l’agression et “certains admettent avoir porté des coups” à Quentin Deranque “ou à d’autres victimes”. Quatre des onze personnes interpellées dans le cadre de l’enquête, soupçonnées d’avoir aidé les autres à se cacher, ont été remises en liberté. Ces trois hommes et une femme “seront ultérieurement convoqués pour s’expliquer sur ces faits”.
Kiabi ne cède pas aux Sleeping Giants et ne retirera pas ses publicités de la chaîne CNews
Alertée par le collectif Sleeping Giants France, l’enseigne Kiabi a annoncé retirer ses publicités de la chaîne d’information en continu, CNews :
« Bonjour ! Merci pour votre message et pour l’alerte. Cette situation ne reflète ni nos valeurs ni nos engagements. Nous nous en excusons sincèrement. Nous faisons le nécessaire dès à présent pour faire retirer nos publicités de cette chaîne et pour renforcer nos contrôles afin que cela ne se reproduise pas. Merci pour votre compréhension. »
Le lendemain, la direction de l’enseigne a pointé une «initiative individuelle», sans accord de la direction :
Ce jeudi 19 février, la direction de Kiabi a indiqué que l’annonce faite sur les réseaux sociaux était «une initiative individuelle», réalisée «sans consultation ni accord de la direction». «Il ne s’agit en aucun cas d’une décision stratégique de l’entreprise. Kiabi ne fait aucune discrimination dans sa politique de communication et communique dans tous les médias autorisés par la loi et l’Arcom».
Le collectif Sleeping Giants avait harcelé Kiabi il y a quelques jours, en découvrant une de ses publicités sur CNews. « Sur #CNews la discrimination et/ou l’incitation à la haine sont récurrents : plus de 20 avertissements et sanctions #Arcom concernent ces motifs. Sans compter sa condamnation pour racisme. Faut-il vraiment que vous financiez *ça* avec vos pubs ? ».

Dégradations de la cathédrale Saint-Pierre à Montpellier, en présence des forces de l’ordre restées sans intervention
Le Karnaval des Gueux se tient chaque Mardi gras à Montpellier, bien que ce soit un événement interdit depuis plusieurs années par la préfecture de l’Hérault, car elle se termine par des débordements. Cette nouvelle édition a rassemblé plusieurs centaines de personnes, dont certaines se revendiquant antifascistes, ou de groupes d’extrême gauche.
Thierry Tsagalos, suppléant du député UDR Chalres Alloncle et candidat à l’élection municipale à Montpellier a publié des images montrant un feu allumé par les participants sous le porche de la cathédrale. Les manifestants l’auraient fait brûler à même le sol puis ont dansé autour. Des tags sur les portes ainsi que sur certains murs de l’édifice religieux ont également été découverts, et le candidat montre aussi une photo du parvis de la cathédrale, abîmé par les flammes.
Oui, je le dis : c’est un acte de terrorisme.
Dégrader la Cathédrale Saint-Pierre de Montpellier.
Brûler une croix devant un lieu de culte.
Ce n’est ni du folklore ni un débordement festif.
C’est une attaque contre un symbole religieux et contre notre patrimoine.Frapper un… pic.twitter.com/0OH6EkdgmU
— Thierry Tsagalos Municipales Montpellier 2026 🇫🇷 (@ThierryTsagalos) February 18, 2026
Dans une vidéo tournée par l’un des participants, on peut voir un feu devant la cathédrale, ainsi que plusieurs autres allumés dans des bacs à ordures de la ville.
Au lendemain des faits, mercredi 18 février, le diocèse de Montpellier confirme les dégradations subies et réagit dans un communiqué de presse. L’archevêque de Montpellier, Mgr Norbert Turini, dénonce :
“Lors du festival des gueux, des individus se sont permis de souiller les portes et les murs de notre lieu de culte le plus central”.
Ces faits, survenus en présence des forces de l’ordre restées sans intervention, choquent aujourd’hui à la lumière du jour les fidèles et les habitants de notre ville.
L’archevêque interroge la “portée symbolique” de cet acte, soulignant que ce mercredi marque le premier jour du carême pour les catholiques. Le diocèse de Montpellier annonce avoir
“décidé de saisir la justice afin que toute la lumière soit faite sur les motivations de cet acte et sur l’inaction des services d’ordre présents sur place“. “Nous attendons des autorités compétentes qu’elles assurent la protection des lieux de culte et la sérénité des croyants.”
Le préfet de l’Hérault avoue son impuissance en indiquant que
“une offensive était trop risquée pour les personnes présentes”
La Fraternité Saint-Pie X se réjouit de l’ouverture d’une discussion doctrinale mais refuse le report des ordinations épiscopales
Communiqué de la Fraternité Saint-Pie X à la proposition du Dicastère pour la Doctrine de la Foi :
Lors de l’entrevue du 12 février dernier entre Monsieur l’abbé Pagliarani, Supérieur général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, et Son Éminence le cardinal Víctor Manuel Fernández, Préfet du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, organisée à la suite de l’annonce de futurs sacres épiscopaux pour la Fraternité, ce dernier avait proposé « un chemin de dialogue spécifiquement théologique, selon une méthodologie bien précise, […] pour mettre en évidence les minima nécessaires à la pleine communion avec l’Église catholique », conditionnant ce dialogue à la suspension des consécrations épiscopales annoncées.
À la demande du Préfet du Dicastère, le Supérieur général a présenté cette proposition aux membres de son Conseil, et a pris le temps nécessaire pour l’évaluer.
En date du 18 février, Monsieur l’abbé Pagliarani a fait parvenir sa réponse écrite au Cardinal, accompagnée de plusieurs annexes et signée par les cinq membres du Conseil général.
La question étant désormais du domaine public, en raison de la communication publiée par le Saint-Siège le 12 février, il paraît opportun de rendre également public le contenu de cette lettre et de ses annexes, afin de permettre aux fidèles intéressés de connaître avec précision la réponse apportée.
Monsieur le Supérieur général confie cette situation à la prière des membres de la Fraternité et de tous les fidèles. Il demande que la prière du chapelet, ainsi que les sacrifices du Carême qui s’ouvre, soient tout spécialement offerts pour le Saint-Père, pour le bien de la sainte Église, et pour préparer dignement les âmes à la cérémonie du 1er juillet.
Le cardinal Víctor Manuel Fernández a rencontré le pape Léon XIV aujourd’hui. Il a du lui rendre compte de cette longue lettre :
Réponse du Conseil général de la Fraternité Saint-Pie X au Préfet du Dicastère pour la Doctrine de la Foi.
Menzingen, le 18 février 2026
Mercredi des Cendres
Éminence Révérendissime,
Tout d’abord, je vous remercie de m’avoir reçu le 12 février dernier, ainsi que d’avoir rendu public le contenu de notre rencontre, ce qui favorise une parfaite transparence dans la communication.
Je ne peux qu’accueillir favorablement l’ouverture à une discussion doctrinale, manifestée aujourd’hui par le Saint-Siège, pour la simple raison que c’est moi-même qui l’avais proposée il y a exactement sept ans, dans une lettre datée du 17 janvier 2019 1. À l’époque, le Dicastère n’avait pas vraiment exprimé d’intérêt pour une telle discussion, au motif – exposé oralement – qu’un accord doctrinal entre le Saint-Siège et la Fraternité Saint-Pie X était impossible.
Du côté de la Fraternité, une discussion doctrinale était – et demeure toujours – souhaitable et utile. En effet, même si l’on ne parvient pas à se mettre d’accord, des échanges fraternels permettent de mieux se connaître mutuellement, d’affiner et d’approfondir ses propres arguments, de mieux saisir l’esprit et les intentions qui animent les positions de son interlocuteur, surtout son amour réel pour la Vérité, pour les âmes et pour l’Église. Cela vaut, en tout temps, pour les deux parties.
Telle était précisément mon intention, en 2019, lorsque j’ai suggéré une discussion dans un moment serein et pacifique, sans la pression ou la menace d’une éventuelle excommunication qui aurait rendu le dialogue un peu moins libre – ce qui, malheureusement, se produit aujourd’hui.
Cela dit, si je me réjouis, bien sûr, d’une nouvelle ouverture au dialogue et d’une réponse positive à ma proposition de 2019, je ne puis accepter, par honnêteté intellectuelle et fidélité sacerdotale, devant Dieu et devant les âmes, la perspective et les objectifs au nom desquels le Dicastère propose une reprise du dialogue dans la situation actuelle ; ni, d’ailleurs, le report de la date du 1er juillet.
Je vous en expose respectueusement les raisons, auxquelles j’ajouterai quelques considérations complémentaires.
- Nous savons d’avance tous deux que nous ne pouvons pas nous mettre d’accord sur le plan doctrinal, en particulier concernant les orientations fondamentales prises depuis le Concile Vatican II. Ce désaccord, du côté de la Fraternité, ne relève pas d’une simple divergence de vue, mais d’un véritable cas de conscience, né de ce qui s’avère une rupture avec la Tradition de l’Église. Ce nœud complexe est malheureusement devenu encore plus inextricable avec les développements doctrinaux et pastoraux survenus au cours des récents pontificats.
Je ne vois donc pas comment un processus de dialogue commun pourrait aboutir à déterminer ensemble ce qui constituerait « les exigences minimales pour la pleine communion avec l’Église catholique », puisque – comme vous l’avez vous-même rappelé avec franchise – les textes du Concile ne peuvent être corrigés, ni la légitimité de la Réforme liturgique remise en cause.
- Ce dialogue est censé permettre de clarifier l’interprétation du Concile Vatican II. Mais celle-ci est déjà clairement donnée dans le post-Concile et les documents successifs du Saint-Siège. Le Concile Vatican II ne constitue pas un ensemble de textes librement interprétables : il a été reçu, développé et appliqué depuis soixante ans, par les papes qui se sont succédé, selon des orientations doctrinales et pastorales précises.
Cette lecture officielle s’exprime, par exemple, dans des textes majeurs tels que Redemptor hominis, Ut unum sint, Evangelii gaudium ou Amoris lætitia. Elle se manifeste également dans la Réforme liturgique, comprise à la lumière des principes réaffirmés dans Traditionis custodes. Tous ces documents montrent que le cadre doctrinal et pastoral dans lequel le Saint-Siège entend situer toute discussion est d’ores et déjà déterminé.
- Le dialogue proposé se présente aujourd’hui dans des circonstances qui ne peuvent être ignorées. En effet, nous attendions depuis sept ans un accueil favorable à la proposition de discussion doctrinale formulée en 2019. Plus récemment, nous avons écrit par deux fois au Saint-Père : afin de solliciter d’abord une audience, puis pour exposer avec clarté et respect nos besoins et la situation concrète de la Fraternité.
Or, après un long silence, ce n’est qu’au moment où des sacres épiscopaux sont évoqués que l’on propose la reprise d’un dialogue, lequel apparaît donc comme dilatoire et conditionné. En effet, la main tendue de l’ouverture au dialogue s’accompagne malheureusement d’une autre main déjà prête à infliger des sanctions. Il est question de rupture de communion, de schisme 2 et de « graves conséquences ». Qui plus est, cette menace est désormais publique, ce qui crée une pression difficilement compatible avec un vrai désir d’échanges fraternels et de dialogue constructif.
- Par ailleurs, il ne nous paraît pas possible d’entreprendre un dialogue pour définir quels seraient les minima nécessaires à la communion ecclésiale, tout simplement parce que cette tâche ne nous appartient pas. Tout au long des siècles, les critères d’appartenance à l’Église ont été établis et définis par le Magistère. Ce qui devait être cru obligatoirement pour être catholique a toujours été enseigné avec autorité, dans une fidélité constante à la Tradition.
Dès lors, on ne voit pas comment ces critères pourraient faire l’objet d’un discernement commun par le moyen d’un dialogue, ni comment ils pourraient être réévalués aujourd’hui au point de ne plus correspondre à ce que la Tradition de l’Église a toujours enseigné, et que nous désirons observer fidèlement, à notre place.
- Enfin, si un dialogue est envisagé en vue d’aboutir à une déclaration doctrinale que la Fraternité puisse accepter, concernant le Concile Vatican II, nous ne pouvons ignorer les précédents historiques des efforts déployés en ce sens. J’attire votre attention en particulier sur le plus récent : le Saint-Siège et la Fraternité ont eu un long parcours de dialogue, commencé en 2009, particulièrement intense pendant deux ans, puis poursuivi de manière plus sporadique jusqu’au 6 juin 2017. Pendant toutes ces années, on a cherché à atteindre ce que le Dicastère propose maintenant.
Or, tout s’est finalement terminé de manière drastique par une décision unilatérale du préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, le cardinal Müller, qui, en juin 2017, a solennellement établi, à sa manière, les « minima nécessaires pour la pleine communion avec l’Église catholique », incluant explicitement tout le Concile et le post-Concile 3. Cela montre que, si l’on s’obstine dans un dialogue doctrinal trop forcé et sans suffisamment de sérénité, à long terme, au lieu d’obtenir un résultat satisfaisant, on ne fait qu’aggraver la situation.
Ainsi, dans le constat partagé que nous ne pouvons pas trouver d’accord sur la doctrine, il me semble que le seul point sur lequel nous pouvons nous rejoindre est celui de la charité envers les âmes et envers l’Église.
En tant que cardinal et évêque, vous êtes avant tout un pasteur : permettez-moi de m’adresser à vous à ce titre. La Fraternité est une réalité objective : elle existe. C’est pourquoi, au fil des années, les Souverains Pontifes ont pris acte de cette existence et, par des actes concrets et significatifs, ont reconnu la valeur du bien qu’elle peut accomplir, malgré sa situation canonique. C’est également pour cela que nous nous parlons aujourd’hui.
Cette même Fraternité vous demande uniquement de pouvoir continuer à faire ce même bien aux âmes auxquelles elle administre les saints sacrements. Elle ne vous demande rien d’autre, aucun privilège, ni même une régularisation canonique qui, dans l’état actuel des choses, s’avère impraticable en raison des divergences doctrinales. La Fraternité ne peut pas abandonner les âmes. Le besoin des sacres est un besoin concret à court terme pour la survie de la Tradition, au service de la sainte Église catholique.
Nous pouvons être d’accord sur un point : aucun d’entre nous ne souhaite rouvrir des blessures. Je ne répéterai pas ici tout ce que nous avons déjà exprimé dans la lettre adressée au pape Léon XIV, et dont vous avez directement connaissance. Je souligne seulement que, dans la situation présente, la seule voie réellement praticable est celle de la charité.
Au cours de la dernière décennie, le pape François et vous-même avez abondamment prôné « l’écoute » et la compréhension des situations particulières, complexes, exceptionnelles, étrangères aux schémas ordinaires. Vous avez également souhaité une utilisation du droit qui soit toujours pastorale, flexible et raisonnable, sans prétendre tout résoudre par des automatismes juridiques et des schémas préétablis. La Fraternité ne vous demande rien d’autre dans le moment présent – et surtout elle ne le demande pas pour elle-même : elle le demande pour ces âmes dont, comme déjà promis au Saint-Père, elle n’a d’autre intention que de faire de véritables enfants de l’Église romaine.
Enfin, il est un autre point sur lequel nous sommes également d’accord, et qui doit nous encourager : le temps qui nous sépare du 1er juillet est celui de la prière. C’est un moment où nous implorons du Ciel une grâce spéciale et, de la part du Saint-Siège, de la compréhension. Je prie en particulier pour vous le Saint-Esprit et – ne le prenez pas comme une provocation – son épouse très sainte, la Médiatrice de toutes les grâces.
Je tiens à vous remercier sincèrement pour l’attention que vous m’avez accordée, et pour l’intérêt que vous voudrez bien porter à la présente question.
Veuillez agréer, Éminence Révérendissime, l’expression de mes salutations les plus distinguées et de mon dévouement dans le Seigneur.
Davide Pagliarani, Supérieur général
+ Alfonso de Galarreta, Premier Assistant général
Christian Bouchacourt, Second Assistant général
+ Bernard Fellay, Premier Conseiller général, Ancien Supérieur général
Franz Schmidberger, Second Conseiller général, Ancien Supérieur général
Un bébé qui était atteint d’une « tumeur vasculaire rare » et qui « risquait de mourir » a été soigné in utero
Belle nouvelle rapportée par Généthique :
La tumeur a été détectée vers la fin du septième mois de grossesse. Risquant de « comprimer la respiration », elle « grandissait très vite », « atteignant toute la base du visage du bébé » et mettant en jeu son pronostic vital.
En effet, le syndrome de Kasabach Merritt est « une tumeur très agressive » qui « a comme particularité d’aspirer les plaquettes, les plaquettes étant un élément important pour la coagulation ». Dès lors, « le bébé se retrouve avec un taux de plaquettes très bas et soumis à des hémorragies qui peuvent être fatales », explique le professeur Laurent Guibaud qui a proposé le traitement anténatal.
Face aux « signes de souffrance laissant supposer que sa coagulation devait commencer à être défectueuse », les médecins des Hospices civils de Lyon ont décidé, en accord avec la famille, de l’administration d’un antiangiogénique, le Sirolimus, visant à limiter la prolifération des vaisseaux. Le traitement a été administré par voie orale, à la mère.
« C’est la première fois que ce traitement a été utilisé en anténatal pour traiter une tumeur vasculaire de ce type-là », affirme le Pr Guibaud.
Issa est né par césarienne, le 14 novembre 2025, à la maternité de Hautepierre à Strasbourg. La taille de la tumeur a diminué et il n’a pas besoin d’être intubé pour respirer. Toutefois son taux de plaquettes est « assez bas », requérant une transfusion. « Malgré sa tumeur, c’est un enfant normal, il mange bien, il grandit bien », témoigne sa maman reconnaissante.
Cette thérapie anténatale avait déjà été utilisée pour soigner d’autres types de malformations. Issa poursuit son traitement et est régulièrement suivi par l’hôpital de Mulhouse. « C’était très stressant », confie la maman d’Issa, « mais on a bien fait de garder espoir : il est là ».
Jean-Louis Picoche est décédé le 3 février 2026. Picoche ? un nom répertorié dans toutes les bonnes bibliothèques ! Mais qui était Jean-Louis Picoche ?
Jean-louis Picoche est né à Paris en 1931. Fils d’instituteur, il entame ses études d’espagnol à la Sorbonne ; Capes, Agrégation d’espagnol, Doctorat es lettres. Il poursuit ensuite une carrière d’enseignant, d’abord en secondaire puis dans le cadre de l’Université. Spécialisé dans les auteurs romantiques espagnols, il publie des études tant en France qu’en Espagne.
Passionné par l’enseignement et acteur infatigable de la transmission et du témoignage, il écrit pour les jeunes d’excellents romans d’aventures basés le plus souvent en Espagne. Il connait si bien ce pays qu’il le fait découvrir et aimer à toutes les époques au fil des pages. Il est publié par Elor, Clovis et avec succès par les Editions Bulle d’Or.
Grand ami de Marie-Claude Monchaux, il lui demande d’illustrer son roman Histoire d’un peintre et d’une Infante, co-écrit avec Marie Chevallier qui reçut le prix Saint-Exupéry Romand jeunesse, en 1992 édité par Bulle d’Or.
Dans son numéro de 2017, la revue critique littéraire jeunesse Plaisir de Lire écrira : Erudition et justesse de ton. « Nous sommes en 1654 et l’Espagne est en pleine décadence quand le jeune Gabriel rentre à la cour de Philippe IV. A ce titre il côtoie les grands et saura gagner tout particulièrement l’estime et le cœur de l’infante Margarita. Aux côtés de Gabriel les jeunes lecteurs découvriront Madrid au XVIIe siècle et les fastes de la Cour mais aussi ses drames. Ils pénétreront avec bonheur dans l’atelier du grand Vélasquez où s’élaborent lentement les toiles du Maître. Un ouvrage exceptionnel pour son érudition et sa justesse de ton.
Un autre roman de Jean-Louis Picoche, toujours aux éditions Bulle d’Or, Au-delà de Canicosa, est également sélectionné pour le Prix Saint-Exupéry, Valeurs jeunesse. Les illustrations toniques et flamblyantes de Daniel Lordey entrainent le lecteur au cœur de la tourmente et la tornade espagnole. « Un chevalier chrétien ne se rend pas sans combattre ». Nous sommes en Espagne, au Xe siècle… L’empire musulman d’Almanzor menace presque toute la péninsule ibérique. Quelques preux chevaliers castillans unissent leurs forces avec leurs voisins pour amorcer la reconquista… Sur fond de querelles familiales, cette enquête historique éclaircira le mystère de la mort des sept infants de Lara. Le récit est aussi célèbre en Espagne que l’est la Chanson de Roland chez nous
D ’autres ouvrages retiennent l’attention du public, parmi eux le poignant : Cristeros, aux éditions Clovis.
En juillet 1926, un événement extraordinaire survient au Mexique : toutes les églises catholiques sont fermées, les prêtres exilés, le culte interdit. A Tlaloc, Mariano, étudiant en agronomie, et Guadalupe, une jeune indienne organisent la résistance. Mais les soldats fédéraux se mettent à tuer ceux qui s’opposent aux consignes officielles. Mariano et Guadalupe s’enfuient pour rejoindre les premiers éléments de guérilla qui combattent sous l’étendard du Christ-Roi, d’où leur surnom de Cristeros. Ils deviennent soldats, réalisant des coups de main audacieux, puis espions, s’infiltrant dans les lignes ennemies. Mais la trahison les guette. Telle sera l’épopée merveilleuse et tragique des Cristeros, dont la foi et l’héroïsme rayonnent encore aujourd’hui au coeur du Mexique catholique.
Jean-Louis Picoche a dans tous ses ouvrages voulu transmettre cette flamme qui l’animait. Cette flamme de la foi, cette flamme du vrai, de la belle histoire qui se raconte de générations en générations. Sa plume alerte qui séduit le jeune lecteur, a conquis aussi bien des cœurs plus aguerris. Ses pages sont si belles, si tragiques parfois et si pleines d’espérance.
Rappelé à Dieu le 3 février 2026, à l’âge de 96 ans, ses obsèques traditionnelles ont été célébrées en la chapelle Notre-Dame des Grèves de Pornichet en Loire Atlantique le 9 février 2026.
Nos prières l’accompagnent comme il avait lui-même accompagné avec nous l’édition de ces deux grands ouvrages primés, avec conviction et ferveur.
Retrouvez tous les ouvrages de Jean-Louis Picoche sur LIVRES EN FAMILLE
https://www.livresenfamille.fr/4451_jean-louis-picoche?ref=043193205
Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.
La prophétie de Sodome
– Si Dieu existe, il ne peut pas laisser passer ça !
Ma compagne a entièrement raison de s’indigner ainsi, et heureusement d’autres l’ont fait avant elle. Ainsi, Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères a fait part de son « indignation » à la Presse en découvrant qu’un diplomate français était impliqué dans le scandale lié aux dossiers Epstein. Mieux, La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a affirmé à l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi 11 Février que toute la lumière devrait être faite sur cette affaire « effroyable et tentaculaire ». Mais le summum a été atteint ce lundi 16 Février avec cette déclaration de Tim Burchett, député républicain du Tennessee. Selon lui, les fameux fichiers Epstein contiendraient « des horreurs indicibles venues des profondeurs de l’enfer ». Il a fortement déconseillé à quiconque de consulter les pièces jointes : « ça vous collera à la peau, ça vous hantera » !
Depuis plus d’une semaine, chaque jour apporte son lot d’informations sensationnelles sur l’affaire Epstein. Cet énorme scandale a des ramifications dans de nombreux pays et touche indifféremment des « Têtes couronnées », des milliardaires, des hommes politiques ou même des artistes célèbres. Surtout, son niveau d’abomination semble être sans limite, chaque nouvelle révélation est plus sordide que la précédente !
Face à tant d’horreur, je rassure ma compagne :
– Tu as raison, jamais Dieu ne laissera passer cela : quand ça va trop loin, il intervient. Et là, c’est vraiment allé trop loin. Du temps d’Abraham, il y a déjà eu une histoire de ce genre et à l’époque, Dieu était intervenu assez brutalement !
– Ah bon ! Tu veux dire une affaire avec des caméras et des jets privés ! Dit-elle moqueuse.
Je poursuis, imperturbable :
– Alors qu’Abraham avait choisi d’installer son camp sur les collines environnantes de la cité de Sodome, son neveu décida de se fixer en ville. Quelques années plus tard, Lot était devenu un notable de la célèbre cité. Malheureusement, la ville était réputée pour son immoralité, et les abominations y avaient pris de telles proportions que Dieu envoya des messagers avec ordre de la détruire. En les voyant arriver, Lot les invita chez lui, mais tous les habitants de Sodome se pressèrent devant sa maison en réclamant qu’il leur livre les visiteurs pour les violer selon leurs coutumes. Comme Lot ne voulait pas qu’ils les maltraitent, il leur proposa ses deux filles encore vierges afin qu’ils les traitent selon leurs envies. Cependant, la foule ne voulut rien entendre et décida de pénétrer dans la maison pour s’emparer de l’ensemble des occupants. Les deux messagers de Dieu aveuglèrent les assaillants qui durent renoncer à leur funeste projet. Le lendemain matin, dès l’aube, Lot et sa famille acceptèrent de fuir la sinistre ville sans emporter le moindre bagage. A peine avaient-ils quitter Sodome qu’une pluie de feu s’abattit sur la cité maudite, détruisant tout sur son passage, même les habitants.
– Et tu penses qu’aujourd’hui Dieu voudrait détruire tous ces monstres impliqués dans cette horrible affaire ? Me demande Léna légèrement sceptique.
– Disons qu’il y a deux manière de lire ce récit biblique. Soit on le lit comme une histoire du passé révélant le niveau de perversion de certaines populations à cette époque lointaine, soit on le lit comme un texte prophétique qui nous parle de la fin des temps.
– Et alors, ça nous apprend quoi sur cette fin des temps ? Demande-t-elle soudain intéressée.
– Abraham a fait le choix d’habiter sur les collines en dehors de Sodome : il représente les croyants qui vivent en accord avec Dieu. Lot, de son côté, est une sorte de croyant non pratiquant : il craint Dieu mais veut surtout profiter des plaisirs de la vie. Quand vient l’heure de la destruction finale, Lot et sa famille ont juste le temps de fuir, mais sans rien sauver d’autre que leur propre vie. Quant aux autres habitants, ils périssent dans les flammes de la colère divine. Tu vois, ce récit est une bonne illustration de ce qui attend l’ensemble de l’humanité à la fin des temps.
– D’accord, mais c’est pour quand ? Demande-t-elle impatiente.
– Disons que ça se rapproche de plus en plus rapidement. Mais patience, ça bouge !
Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.
La Jeune Garde, bras armé de la France Insoumise
Le Parisien révèle l’accord entre la milice d’extrême-gauche et la parti de Mélenchon. Un ancien membre de la Jeune Garde témoigne du fonctionnement interne du mouvement et sur ses figures centrales, Raphaël Arnault et Jacques-Elie Favrot, interpellé mardi soir dans le cadre de l’enquête pour « homicide volontaire ».
Ce militant expérimenté affirme que Jacques-Elie Favrot était l’un des « cadres solides » de la Jeune Garde, fondée en 2018. « Ce sont les deux meilleurs potes, Jef est loyal, il fait sa sécurité. C’est Raph qui l’a formé, c’est le suiveur », raconte-t-il à propos de sa proximité avec Raphaël Arnault. Décrit comme « plutôt taiseux », Favrot aurait, selon lui, appartenu à « un groupe antifa d’action au niveau de Lyon destiné à taper ». « Jef, c’est celui qui frappe ».
Concernant les faits ayant conduit à la mort de Quentin Deranque, l’ancien militant assure ne pas avoir été surpris : « On savait que ça arriverait un jour ou l’autre ». Les violences qui ont entouré la mort de Quentin Deranque ne l’ont donc « pas du tout surpris ». Onze personnes ont été interpellées dans ce dossier et demeurent présumées innocentes.
Au sein de la Jeune Garde, le rapprochement entre Raphaël Arnault et Jean-Luc Mélenchon, entre 2022 et 2024, a été vécu comme une victoire.
« Pour nous, c’était tapis rouge ». « On savait qu’on aurait des postes, tant qu’on se faisait discret, poursuit-il. On fait le sale boulot et on est remerciés avec des postes derrière ».
Des membres du mouvement assuraient « systématiquement » le service d’ordre lors d’événements de LFI.
« On fait le sale boulot et on est remerciés avec des postes derrière ».
« Systématiquement, on s’occupait du service d’ordre. Et quand on n’est pas de service d’ordre, on se met autour de l’événement, on fait du repérage, du cadrage… »
Lors des questions parlementaires à l’Assemblée, Gérald Darmanin souligne :
« Il y a de la brutalisation quand on justifie l’action de la Jeune Garde et qu’on investit aux élections législatives son dirigeant ». « La Jeune Garde tue et la France insoumise devrait le condamner ».
Quant à Sébastien Lecornu, il a recadré Mathlde Panot qui accusait Némésis :
« Ce que vous venez de faire est absolument ignoble et abject ». « Il est temps que vous fassiez le ménage (…) dans vos propos, (…) dans vos idées et surtout (…) dans vos rangs »
Lettre ouverte au Dr Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Le Dr Geneviève Bourgeois, médecin gériatre, signe une lettre ouverte au Dr Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées :
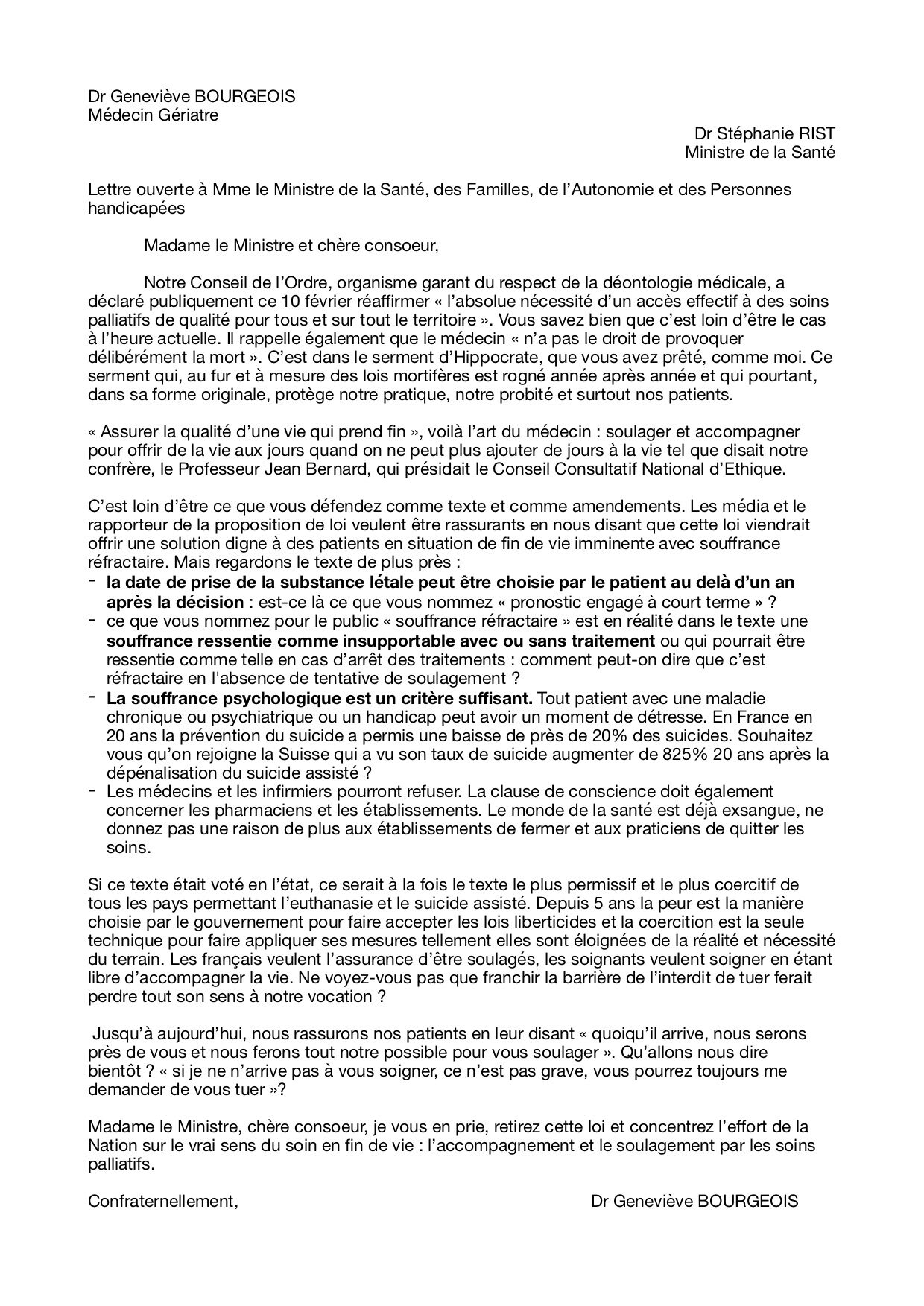
Christine Lagarde croit en la victoire du RN à la Présidentielle de 2027
La semaine dernière, on apprenait que le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, anticipait une victoire du RN à la Présidentielle de 2027. Et que par conséquent il démissionne pour que ce soit Macron qui nomme son successeur.
Cette semaine, c’est Christine Lagarde qui croit en la victoire du RN à la Présidentielle de 2027. Le Financial Times affirme que la gardienne de l’euro envisageait de quitter ses fonctions avant l’échéance de son mandat de huit ans, en 2027. Et ce, afin de laisser le président français participer au choix de son successeur. La présidente de la BCE Christine Lagarde prévoirait de démissionner avant la fin du mandat d’Emmanuel Macron, alors que son mandat s’achève en octobre 2027.
À Bruxelles comme à Paris, on craint qu’un parti souverainiste à la tête de la France complique la sélection du futur dirigeant de la plus importante institution financière européenne.
Banque de France, Banque Centrale Européenne… l’extrême-centre ne veut pas que l’on touche au grisbi.
Un député italien demande si Raphaël Arnault ne serait pas impliqué dans des violences commises à Rome
En janvier 2026, Raphaël Arnault était à Rome avec le réseau antifasciste international, pour manifester contre la cérémonie d’Acca Larentia en hommage à l’assassinat commis par plusieurs militants d’extrême gauche, à Rome le 7 janvier 1978, devant le siège du Mouvement social italien, situé via Acca Larenzia. Durant ces jours, plusieurs militants de la Jeunesse nationale (Gioventù Nazionale), mouvement de jeunesse du parti Fratelli d’Italia (FdI), ont été agressés à Rome. Quatre d’entre eux collaient des affiches commémorant les événements tragiques de 1978. Ils ont été encerclés et agressés sur un parking par une vingtaine de personnes. Tous les quatre sont hospitalisés. Leur état est préoccupant.
Les antifas, agresseurs, ne parlent pas italien. Les jeunes, en portant plainte, le soulignent. Les médias européens le confirment : un réseau antifasciste violent existe, imbriqué avec des anarchistes et l’islam radical. Et de fait, certains de ces agresseurs parlent un étrange dialecte « arabo-européen ».
Fabio Rampelli, vice-président de la Chambre des députés, a posé une question concernant l’attaque contre les jeunes du GN. Le mode opératoire, la technique et le matériel (notamment des radios bidirectionnelles) laissent penser à une préméditation. Il ne s’agit que d’une hypothèse, mais le député souhaite savoir si la présence de Raphaël Arnault, et peut-être celle de son groupe « La Jeune Garde », pourrait avoir un lien avec les événements.
« L’enquête courageuse d’Il Giornale confirme nos dires et leurs investigations. La présence d’Arnault à Rome durant cette période de tensions ouvre de nouvelles pistes qu’il convient d’explorer. »
Depuis Rome, Arnault a également publié une vidéo sur Instagram dénonçant la prolifération des « fascistes en Europe ». Dans cette même vidéo, il accuse Giorgia Meloni de propager ce qu’il qualifie de « fascisme ».
Atteint du Covid, il est euthanasié
Cette glaçante affaire autrichienne pourrait être d’actualité en France, si les parlementaires votent la loi sur l’euthanasie.
Samuel a été enterré mercredi 11 février à l’âge de 22 ans. Le suicide assisté de ce grand brun à peine sorti de l’adolescence a choqué l’Autriche. Atteint du syndrome de fatigue chronique, ou encéphalomyélite myalgique (EM/SFC), Samuel avait décidé d’alerter le public sur sa situation, douze jours avant sa mort, en annonçant sur le forum en ligne Reddit sa décision de se suicider en raison « du niveau de souffrance inimaginable » et en dénonçant le manque de reconnaissance officielle de cette maladie encore mal connue. Se traduisant par une fatigue extrême, ce syndrome parfois assimilé à une des formes de Covid long s’était déclenché chez Samuel à la suite d’une infection au Covid-19 contractée en 2024.
Logique mercantile soutenue par les mutuelles : il est moins cher d’éliminer le malade que de chercher à le soulager.
Les législateurs du Nouveau-Mexique font progresser un projet de loi obligeant les assureurs à financer l’avortement et les mutilations génitales
Le Comité fiscal du Sénat du Nouveau-Mexique a voté pour faire avancer une législation qui obligerait les compagnies d’assurance à subventionner l’avortement, la contraception et les procédures de « transition de genre », les entités religieuses étant exemptées des contraceptifs mais pas des autres éléments.
La loi SB 189 exige que les régimes d’assurance maladie collective « couvrent le coût total des soins [dits] d’avortement » et des « soins d’affirmation de genre » (définis comme toute « procédure, service, médicament, dispositif ou produit [destiné à traiter] l’incongruence entre l’identité de genre de l’individu et le sexe qui lui a été assigné à la naissance » ; et « au moins un produit ou une forme de contraception dans chacune des catégories de méthodes contraceptives identifiées par la Food and Drug Administration fédérale », ainsi que les « services cliniques connexes » à la contraception.
Le projet de loi stipule qu’« une entité religieuse souscrivant une assurance maladie individuelle ou collective peut choisir d’exclure les médicaments ou dispositifs contraceptifs», mais ne contient aucune disposition comparable les exemptant de l’avortement ou du « changement de sexe », ce qui expose les hôpitaux religieux et le personnel religieux à être contraints de participer à de telles procédures.
Selon Live Action, le projet de loi est examiné en procédure accélérée à la demande du gouverneur démocrate Michelle Lujan Grisham. Les démocrates contrôlent les deux chambres de l’Assemblée législative du Nouveau-Mexique avec une large majorité ; le SB 189 devrait donc parvenir sans difficulté à son bureau pour être promulgué.
« Ce projet de loi inverse les priorités. Il subventionne les avortements de convenance à motivation idéologique, dont 98 % sont utilisés comme moyen de contraception, et les chirurgies de réassignation sexuelle à des fins non essentielles, tout en ignorant les soins de santé vitaux et médicalement nécessaires », a témoigné Elisa Martinez de la New Mexico Alliance for Life.
Le Nouveau-Mexique défend ardemment le « droit à l’avortement », au détriment de la liberté de choix de celles et ceux qui s’y opposent. En 2024, l’État a dépensé 400 000 dollars de fonds publics en publicités visant à « inviter cordialement et avec enthousiasme » les praticiens d’avortement d’autres États à s’y installer. L’année dernière, le Bureau des droits civiques (OCR) du département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) a ouvert une enquête sur l’hôpital presbytérien du Nouveau-Mexique, soupçonné d’avoir tenté de contraindre son personnel médical à pratiquer des avortements.
« Ite Missa est » : La fin de la messe
Les prières dites à voix basse après la communion
Après être remonté à l’autel, le prêtre qui vient de donner la communion aux fidèles range le ciboire dans le tabernacle puis entreprend de purifier les vases sacrés qui ont été utilisés pour le renouvellement du sacrifice, et qui ont ainsi été mis en contact avec le précieux corps et le sang du Christ. En accomplissant ces gestes précis et soignés, le prêtre récite deux courtes prières.
Ces prières sont de même nature et de même provenance que celles qui préparent et accompagnent la communion[1]
Quod ore sumpsimus
Il semble que cette prière figurait déjà comme post-communion dans le Sacramentaire Léonien (Ve-VIe siècle à Rome) : « elle exprime en une double antithèse le vœu qu’à la réception sacramentelle dans le temps corresponde une efficacité intime d’éternelle durée[2].
Dans cette première prière, on demande que la communion sacramentelle (le « don temporel », c’est-à-dire le don pour cette vie, ce moyen de salut qui passera ; mais aussi « temporel » parce qu’il se réalise en un instant précis, et est appelé à durer spirituellement) soit aussi spirituelle, plus profondément vraie encore. Tout l’enjeu spirituel de la communion est dans cette connexion entre « recevoir » et « accueillir ».
| Quod ore súmpsimus, Dómine, pura mente capiámus :
et de múnere temporáli fiat nobis remédium sempitérnum. |
Ce que notre bouche a reçu, Seigneur, que notre âme l’accueille avec pureté,
et que ce don fait dans cette vie nous soit un remède pour la vie éternelle. |
Corpus tuum Domine
La prière suivante semble quant à elle plutôt issue de la liturgie gallicane (on la trouve dans un « Missale gothicum » du VIIe siècle). Le RP. Jungmann juge que cette prière marque une progression de pensée par rapport à celle qui la précède. En effet, elle n’oppose plus au signe extérieur son efficacité intime, mais tend à considérer le Sacrement lui-même comme étant la grâce : par sa substance, il est si pur et si saint que sa seule présence en nous suffit en quelque sorte à éliminer et consumer toute souillure de péché
| Corpus tuum, Dómine, quod sumpsi, et Sanguis, quem potávi, adhǽreat viscéribus meis :
et præsta ; ut in me non remáneat scélerum mácula, quem pura et sancta refecérunt Sacraménta : Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. Amen. |
Votre Corps que j’ai mangé et votre Sang que j’ai bu, Seigneur, qu’ils adhèrent à mes entrailles,
et accordez que le péché ne laisse aucune tache en moi, quand je viens d’être restauré par ce sacrement si pur et si saint, vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. |
Les gestes d’ablution
Le plus ancien[3] des gestes d’ablution est sans doute l’ablutio oris (purification de la bouche) prise en même temps qu’est récitée la première prière. Il s’agissait en effet de s’assurer qu’il ne demeure pas de précieux sang dans la bouche du prêtre, et de faire consommer par la même occasion les dernières parcelles d’hostie qui auraient pu y rester. Cette ablution était prescrite dans les premiers temps de l’Église pour les fidèles aussi bien que pour le célébrant. On en trouve un vestige dans l’ordination des sous-diacres, diacres et prêtres, qui communient seulement au corps du Christ, mais prennent ensuite cependant une ablution de vin.
La seconde ablution est faite en versant quelques gouttes de vin puis de l’eau sur les doigts joints du prêtre, au-dessus du calice : les parcelles d’hostie qui auraient pu y rester attachées sont ainsi dissoutes et consommées. Ces gestes complètent et achèvent l’ensemble de rites destinés à accroître la dévotion eucharistique et à marquer le respect pour la présence réelle.
L’antienne de communion
Pour le RP. Jungmann, « L’introduction du chant antiphonique à la communion comme à l’offertoire remonte en Afrique à l’époque de saint Augustin et ne doit guère être plus récente à Rome. L’absence de chant de communion le samedi saint est un vestige des temps antérieurs à cette institution[4]. »
En réalité, cette antienne est plutôt chantée juste après la communion : pour le RP. Jungmann, elle était chantée après la communion du prêtre, puis après celle des fidèles. Il note aussi que c’est l’Agnus Dei a « pris valeur de véritable chant de communion, cela du moins pour la communion du prêtre[5] ».
La postcommunion
Parallélisme avec la collecte et la secrète
La Postcommunion est la dernière grande prière de la messe : chantée ou dite à voix haute par le prêtre, elle résume et récapitule l’esprit et les supplications du sacrifice qui vient d’être renouvelé. Le RP. Jungmann relève le parallélisme clair avec la Collecte et Secrète : « […] coulée exactement dans le même moule [que la collecte et la secrète], elle présente l’aspect d’une prière de demande […][6] ».
Le parallélisme va jusque dans l’enchaînement de l’antienne et de la prière chantée à voix haute par le prêtre au nom de tout le peuple : « Ouverture de la messe, offertoire et communion représentent, en effet, des ensembles liturgiques aux exactes correspondances.
Chaque fois, s’accomplit un acte extérieur qui comporte un mouvement local : la procession d’entrée, la procession d’offrande, la procession de communion ; chaque fois, et primitivement à ces trois seuls moments, le chœur intervient par la psalmodie antiphonique ; chaque fois, et de nouveau presque uniquement en ces trois cas, l’oraison succède à diverses prières à voix basse, dont le célébrant nourrit sa dévotion.
Chant du chœur et prière du prêtre trouvent ainsi chaque fois leur achèvement dans une oraison, conçue selon les mêmes règles de style et précédée, plus ou moins immédiatement, du salut rituel Dominus vobiscum et de l’exhortation Oremus[7]. »
Objet
Examinée dans son objet, la postcommunion tire son thème de la communion qui vient d’avoir lieu […]. Relativement rares sont les formules qui ne regardent pas la communion mais se contentent d’une visée plus générale, d’une allusion à la fête du jour ou à une intention particulière[8].
À travers ces prières antiques « on voit se préciser une image saisissante de ce qui est, dans l’esprit de l’Église, l’authentique doctrine de l’Eucharistie et de la communion. Ce que nous avons reçu est proclamé don très saint, repas céleste, nourriture spirituelle, mystère efficace, corps sacré et sang précieux. » En quelques mots, avec la concision des vieilles formules romaines, la postcommunion « tient toujours notre regard fixé sur la totalité du sacrifice que, conjointement avec lui [le Christ], nous avons offert à Dieu, et auquel nous participons maintenant[9] ».
Pour le RP. Jungmann « cette manière de concevoir la communion est la plus excellente forme d’action de grâces, même si le mot “reconnaissance” s’y exprime rarement, puisque c’est “reconnaître” ce que Dieu a fait pour nous[10] ».
Ayant ainsi commémoré le bienfait qu’est la réception du Sacrement, la postcommunion se hâte d’ordinaire d’en solliciter les effets sacramentels spécifiques. Rassasiés du Corps et du Sang du Christ, ce que nous en espérons et implorons, c’est le progrès et le triomphe final en nous de son œuvre rédemptrice […]. Cela implique affranchissement des obstacles intérieurs et extérieurs […]. Le bien corporel lui-même est sans cesse rappelé et demandé dans l’antithèse fréquente de corps et âme, de présent et avenir, d’intérieur et extérieur […]. Mais l’effet essentiel est d’ordre intérieur et doit se traduire pour nous en santé et vigueur spirituelles […]. Avant tout, puisse le sacrement de l’union faire croître en nous la charité […][11].
Les demandes formulées dans la postcommunion portent ainsi en elles un profond message théologique sur la grâce et la libre coopération de l’homme à l’action divine, puisqu’elles nous font demander cela même à Dieu : que nous coopérions librement à notre propre rédemption. « Nous savons bien que notre libre coopération est indispensable ; mais celle-ci même nous la demandons, à titre sacramentel. »
Enfin, les demandes de la postcommunion – les dernières à être solennellement adressée à Dieu, en conclusion de la messe, tournent naturellement notre regard vers les fins dernières.
C’est un idéal de fidélité chrétienne qui resplendit lorsque, faits participants du Sacrement, nous souhaitons n’en être jamais séparés […], voire ne plus cesser d’en rendre grâces […]. Mais le fruit suprême du Sacrement, selon la promesse du Seigneur, c’est la vie éternelle […].
Le mystère célébré à l’autel demeure dans le monde intentionnel des signes ; nous aspirons à la pleine réalité […]. Ce que nous avons reçu, si grand soit-il, n’était pourtant que le gage, les arrhes […][12].
Le renvoi du peuple – Ite missa est
Après la conclusion de la postcommunion, le prêtre revenu au centre de l’autel l’embrasse et se retourne vers le peuple. Après un dernier « Dominus vobiscum » chanté, il annonce l’envoi : « Ite missa est ! »
Le mot missa y garde initialement sa signification primitive de renvoi, de clôture, avec l’idée – remontant au IVe siècle – qu’il s’agit du renvoi d’une assemblée.
Puisque cette valeur technique n’est plus déjà aussi nette au début du Moyen-Âge, le RP. Jungmann affirme : « On ne risque guère de se tromper en tenant l’Ite missa est pour aussi ancien que la messe latine elle-même[13]. »
Il semble par ailleurs que cette formule était d’un genre courant dans la vie sociale des romains : « Appliquée au renvoi des fidèles, le formule gagne une certaine gravité, une aura religieuse, à s’inscrire entre le Dominus vobiscum qui y prélude et la réponse Deo gratias[14].
Le Deo gratias signifie quant à lui la « simple assurance que l’on a entendu et compris, mais toute baignée de la gratitude, qui est la disposition fondamentale du chrétien[15]. »
Ainsi, malgré son caractère antique voire anachronique (après la fin des rites de renvoi des catéchumènes), l’Ite missa est est demeuré emblématique de la messe romaine, au point de la désigner par son nom le plus commun.
L’Ite missa est a gardé cette autre modalité extérieure, qui convient à un appel adressé au peuple, d’être proféré comme la salutation (Dominus vobiscum), face à l’assistance. Et par là […] est resté bien en relief son caractère de rite final de la cérémonie[16].
Dernier salut à l’autel – Placeat
Après (ou pendant) la réponse de l’assemblée, le prêtre se retourne et, incliné et les mains jointes posées sur l’autel, dit à voix basse la prière du Placeat, prélude à la bénédiction finale. En terminant la prière il embrasse une dernière fois l’autel, comme un « salut de départ, contrepartie du baiser qui fut le salut d’arrivée, au début de la messe[17]. »
À ce baiser qui semble avoir été le rite le plus antique, on n’a pas tardé à joindre, sur le sol franc, une parole approprié, comme ce fut le cas pour le baiser initial (il semble que dans les premiers temps, seuls ces deux baisers aient été en usage). C’est ainsi que l’on trouve dès le IXe siècle (à Amiens notamment) le Placeat tibi, sancta Trinitas… L’origine gallicane de cette prière se ressent notamment dans l’invocation trinitaire.
La pensée qui l’inspire est tout à fait de circonstance : en quittant la table du sacrifice, implorer une fois encore sur ce qui s’y est accompli un regard favorable de Dieu. Le double sens du sacrifice est à nouveau évoqué : l’honneur rendu à la majesté divine, à qui nous demandons d’agréer notre acte; la requête en faveur de nous-mêmes et de tous nos frères, que nous souhaitons voir gracieusement exaucée[18].
Ajoutons encore qu’avec le Suscipe sancta Trinitas de l’offertoire, le Placeat fait partie de ces précieuses prières qui rappellent que le sacrifice de la messe est offert à « toute » la Trinité (et non pas seulement au Père, auquel sont adressées la plupart des prières)[19].
Notons enfin dans le Placeat la mention explicite du caractère propitiatoire du sacrifice de la messe : « que votre miséricorde en fasse un sacrifice de propitiation pour moi et pour tous ceux en faveur de qui je vous l’ai présenté… »
Le Placeat est la seule prière après la communion qui se récite au milieu de l’autel, parce qu’il doit accompagner le baiser à l’autel. Ce baiser étant un geste propre au célébrant, la formule reste au singulier. Correspondant à l’Oramus te Domine, au début de la messe, et comme lui supplication personnelle (peccata mea), le Placeat a encore en commun avec lui d’être prononcé à voix basse, dans une attitude inclinée, les mains reposant sur l’autel[20].
Euthanasie et trafic d’organes
Les promoteurs de l’euthanasie ne veulent surtout pas évoquer les enjeux économiques de la loi actuellement débattue à l’Assemblée (sur ce point, vous pouvez lire une intéressante étude de la Fondapol: Les non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie). On sait pourtant que la mort administrée est une “solution” assez radicale pour résorber le déficit des retraites ou celui de la Sécu – et ce n’est pas un hasard si elle est abondamment promue par les mutuelles.
Mais on oublie souvent un autre aspect de cette sordide équation financière: l’euthanasie et le suicide assisté permettent de disposer d’organes “frais” (ce qui est particulièrement lucratif pour les hôpitaux). En ce domaine, le débat suscité par l’histoire de Karen Duncan, Australienne qui vient de mourir par suicide assisté et de donner ses organes, est emblématique. Le Professeur Dominique Martin, enseignant en éthique médicale à l’université Deakin, a commenté avec un “understament” tout anglo-saxon: « L’aide médicale à mourir et le don d’organes post-mortem sont deux pratiques qui reposent énormément sur la confiance du public envers les systèmes de santé et les professions de la santé afin de garantir que les personnes ne soient ni exploitées ni contraintes en fin de vie. » Et on peut ajouter que la confiance du public avait déjà été sérieusement émoussée par la crise covidique et que l’euthanasie va l’achever. De là à penser que certains vont utiliser “l’aide à mourir” pour récupérer des organes, et que oui, bien sûr, certaines personnes seront contraintes et exploitées en fin de vie, il n’y a qu’un pas…
Pauvre peuple…
D’Aurelio Porfiri, éditeur et écrivain catholique italien, pour le Salon beige:
Le compte X de l’Ambassade de France auprès du Saint-Siège souhaite un bon ramadan [Addendum]
Mais rien sur le carême. Encore une version de l’hallaïcité
À l’occasion du Ramadan, nous souhaitons adresser nos vœux les plus respectueux à nos amis et partenaires de projets. Que ce mois sacré, moment de réflexion et de recueillement, soit porteur de paix, de solidarité et de renouveau spirituel.
Marcel Escure
Chargé d’affaires a.i. pic.twitter.com/5bstSti8jN— La France au Vatican (@FranceauVatican) February 18, 2026
Addendum : Quelques heures après, un message pour le carême est enfin apparu :
En ce début de Carême, l’Ambassade adresse ses vœux de cheminement spirituel à tous les fidèles de l’Église catholique. Temps de prière, de partage et d’attention aux plus fragiles, il invite à l’espérance. @vaticannews_fr @Eglisecatho pic.twitter.com/aC33Z8waH3
— La France au Vatican (@FranceauVatican) February 18, 2026
Proposition de loi sur l’euthanasie : en matière de vie ou de mort, l’abstention n’est pas une solution
Dans le JDD, Baptiste Laroche, consultant en relations publiques et diplômé de philosophie, interpelle les parlementaires qui se sont abstenus en première lecture :
À vous, députés qui vous êtes abstenus lors du vote en première lecture du mardi 27 mai 2025, il faut le dire clairement : l’abstention n’est pas suffisante. Votre abstention exprime un doute, une hésitation sincère face à un texte d’une gravité exceptionnelle. Ce doute est légitime. Il est même nécessaire lorsqu’il s’agit de questions qui engagent la vie, la mort, la vulnérabilité humaine et la mission même de la médecine et de l’accompagnement. Mais précisément parce que ces décisions sont irréversibles, le doute ne peut se traduire par la neutralité. En matière de vie ou de mort, l’abstention n’est pas une position d’attente : elle a des effets. Elle laisse passer.
S’abstenir, dans un tel contexte, ce n’est pas se retirer du débat. C’est accepter que d’autres décident à votre place. C’est laisser entrer dans le droit un texte dont les conséquences humaines sont pourtant connues. Face à l’irréversible, l’abstention ne protège ni les personnes, ni les consciences, ni la société.
Ce texte n’est pas seulement inquiétant par son principe, il l’est par sa dynamique. Avant même son adoption définitive, les critères ont été élargis, les garde-fous affaiblis puis levés. Les souffrances psychologiques, les situations de grande vulnérabilité et même les personnes sous tutelle ont été intégrées. Ce qui devait rester exceptionnel devient une option parmi d’autres. À cette dérive s’ajoute un délit d’entrave qui fait peser une pression inédite sur les soignants et les proches : refuser la mort pourrait demain devenir suspect. La liberté de conscience recule, la confiance se brise. Les garde-fous s’effondrent avant même que la loi ne soit votée : que restera-t-il demain ?
Mais au-delà de cette dérive, il faut nommer le cœur du problème. Ce projet de loi ne renforce pas l’accompagnement de la fin de vie : il en altère profondément le sens. Donner la mort n’est ni un soin ni une aide. C’est un basculement. En faisant entrer la mort provoquée dans le champ du soin et de l’accompagnement, la loi bouleverse la finalité même de la médecine, qui ne serait plus seulement de soigner et de soulager, mais aussi de mettre fin à la vie. C’est une rupture éthique majeure.
Cette rupture envoie un message d’une violence silencieuse aux plus fragiles : personnes âgées, malades, handicapées, dépendantes. Elle installe l’idée que certaines vies pourraient ne plus mériter d’être accompagnées jusqu’au bout. Là où la société devrait affirmer sans ambiguïté que toute vie mérite une présence, un soin et une fidélité jusqu’au terme, le signal devient troublant : la mort apparaît comme une solution.
Face à un texte qui bouleverse ainsi les repères les plus fondamentaux, le doute ne peut conduire à l’attentisme. En matière de vie ou de mort, le principe de prudence commande non pas l’attente, mais la clarté. Lorsqu’une loi soulève plus de questions qu’elle n’apporte de garanties, lorsqu’elle ouvre des brèches impossibles à refermer, s’abstenir revient à laisser faire.
Sur un sujet éthique de cette ampleur, personne ne reprochera jamais à un parlementaire d’avoir voté contre par doute ou par prudence. L’histoire ne retient pas les abstentions. Et aujourd’hui, un vote contre peut encore empêcher un basculement irréversible et préserver l’essentiel : le refus de l’abandon et la protection inconditionnelle des plus vulnérables.
Les députés destinataires de la lettre :
Franck Allisio, Frédéric Falcon, Stéphanie Galzy, Hervé Berville, Danielle Brulebois, Olivia Grégoire, Jean-Michel Jacques, Daniel Labaronne, Marie Lebec, Laure Miller, Anne-Sophie Ronceret, Éric Woerth, Caroline Yadan, Christophe Bex, Idir Boumertit, Abdelkader Lahmar, Christian Baptiste, Jacques Oberti, Fabrice Brun, François-Xavier Ceccoli, Vincent Descoeur, Julien Dive, Virginie Duby-Muller, Alexandra Martin, Jean-Pierre Taite, Marie Pochon, Philippe Bolo, Mickaël Cosson, Marc Fesneau, Sandrine Josso, Sophie Mette, Sabine Thillaye, Paul Christophe, Nathalie Colin-Oesterlé, François Jolivet, Jean-François Portarrieu, Anne-Cécile Violland, Jean-Pierre Bataille, Michel Castellani, Paul-André Colombani, Harold Huwart, Max Mathiasin, Christophe Naegelen, Nicole Sanquer, Olivier Serva, Soumya Bourouaha, Mereana Reid Arbelot, Emmanuel Tjibaou, Belkhir Belhaddad.
Laisserons-nous dire que la France est favorable au tourisme abortif?
Nos amis de One of Us nous disent que la France ne figure qu’en 10e position parmi les 27 Etats membres de l’Union européenne pour les signataires de leur pétition contre le tourisme abortif. Il est encore temps de nous rattraper: vous pouvez signer et faire signer en cliquant ici.
Une nouvelle lecture du texte sur l’euthanasie envisagée en juin
Le programme parlementaire est assez ambitieux, ponctué par les élections municipales en mars. Le gouvernement va tenter de faire passer le projet de loi constitutionnelle réformant le corps électoral en Nouvelle-Calédonie fin mars, début avril, et convoquer un congrès (la réunion des deux chambres à Versailles) mi-avril si la situation le permet, car la gauche s’oppose fortement à ce texte, examiné à partir n commission par les sénateurs.
En mai, les députés pourraient avoir à se pencher sur le projet de loi sur “la sécurité du quotidien” et sur un texte instaurant une allocation sociale unique. Emmanuel Macron aimerait que l’actualisation de la loi de programmation militaire soit adoptée d’ici au 14 juillet. Les sénateurs en débattront en premier, en mai, avant que les députés ne s’y collent en juin, où une nouvelle lecture du texte sur la fin de vie est envisagée. Ce sera la 3e et dernière lecture. Sans oublier l’examen d’un projet de loi d’urgence agricole promise par le Premier ministre sous la pression des agriculteurs. Les sénateurs devraient l’examiner à la fin du printemps.
Concernant la deuxième lecture du texte sur l’euthanasie, elle est prévue au Sénat la semaine du 30 mars.
La loi sur l’euthanasie sera abrogée car la vie triomphera!
Vincent Trébuchet, député UDR, a prononcé hier un discours courageux contre l’euthanasie devant l’Assemblée nationale:
🗣️Notre Assemblée reprend les débats sur la fin de vie.
➡️ Elle n’en sortira grandie que si elle a le courage de choisir la vie,
de rejeter le mensonge d’un “droit” à donner la mort,
et d’offrir enfin à chaque Français un accès aux soins palliatifs.@groupeudr @asso_SFAP pic.twitter.com/eGT8Iblffr— Vincent Trébuchet (@Vt_Trebuchet) February 17, 2026
La complaisance coupable de Sciences Po Lyon avec l’extrême gauche
Après le meurtre de Quentin, des élèves et anciens élèves de différents Institut d’études politiques (IEP) plaident dans Le Figaro pour que l’on réexamine les subventions publiques attribuées à des associations affiliées de près ou de loin au mouvement «antifa» :
L’extrême gauche lynche, l’extrême gauche tue. L’actualité récente a hélas particulièrement souligné que la violence politique est désormais essentiellement l’apanage d’une ultragauche radicalisée, sans limites, qui n’a plus la moindre pudeur à faire l’apologie du terrorisme, à inciter à la haine et à la violence voire à provoquer à commettre des crimes. Depuis le 7-octobre, la rhétorique des plus radicaux ne fait plus mystère non plus de leur antisémitisme. À mesure que son hégémonie culturelle s’effrite dans le pays, la violence de l’extrême gauche se déchaîne dans nos universités, nos grandes écoles et nos rues.
Parce qu’il protégeait de jeunes militantes venues manifester pacifiquement à proximité d’une intervention de Rima Hassan à Sciences Po Lyon, Quentin, un jeune catholique identitaire de 23 ans, étudiant en mathématiques, a été attaqué, roué de coups au sol, par les membres d’un gang antifa». Après avoir lutté entre la vie et la mort, Quentin a rendu son âme.
Nous dénonçons non seulement le silence et l’inaction de la direction de l’IEP de Lyon, mais surtout sa complaisance coupable avec l’extrême gauche ; en particulier avec la nébuleuse «antifa» et ses ramifications. L’école est de longue date l’otage de ces associations radicales, mais il est clair qu’un cap a été franchi, jeudi dernier, avec la survenance de ce meurtre au motif clairement politique, aux abords des salles de cours.
Le terme même de «conférence» relève ici de la fiction sémantique. Rima Hassan n’est pas une intellectuelle, et encore moins une universitaire, mais une militante politique. Il ne s’agissait ni d’une véritable conférence, ni d’un colloque où s’invite la contradiction, mais bien d’une réunion publique, un meeting politique, organisé par une élue LFI dans le grand amphithéâtre de Sciences Po Lyon. Autrement dit, la direction de l’établissement a donné son accord à la mise à disposition, en nature, de moyens publics et de son image de marque — un lieu, une logistique, une caution académique — au bénéfice d’une députée européenne dont la rhétorique violente, les prises de position clivantes et radicales, suscitent des tensions prévisibles. L’université doit être un lieu de liberté d’expression, il ne s’agit pas ici de contester le droit d’une élue de s’exprimer. Mais lorsqu’un établissement accueille un tel événement, il lui appartient d’agir avec prudence et de mettre en balance la liberté d’expression avec la prévention des troubles à l’ordre public.
Nous interrogeons donc la décision de Sciences Po Lyon, d’avoir autorisé la tenue de cet évènement dans ces conditions, sans avoir manifestement pris la pleine mesure des risques sécuritaires qu’il présentait. Or l’ordre public ne saurait être appréhendé de manière restrictive, limité au seul périmètre de l’établissement. Les violences qui ont éclaté — à quelques centaines de mètres à peine de l’amphithéâtre, dans une rue parallèle — ne sont pas étrangères à l’événement ; elles en ont constitué le débordement direct. À l’intérieur, l’acclamation d’un discours de polarisation, structuré autour d’une dialectique de l’affrontement, est une chose. À l’extérieur, le passage de la confrontation verbale à la violence physique en est une autre, naturellement plus grave encore.
Cette issue tragique est précisément la négation de l’exigence démocratique du débat pluraliste et libre, qui devrait prévaloir à Sciences Po. La liberté d’expression protège les opinions, elle ne dispense jamais d’une obligation de vigilance, et ne saurait servir de paravent à l’intimidation ni d’alibi à la violence. Nul ne peut s’en prévaloir pour justifier une complaisance, fût-elle passive, à l’égard de groupes qui recourent à la pression, à la menace ou à la force pour faire taire leurs contradicteurs. Cet épisode révèle une dérive plus profonde des IEP. Il y règne un climat d’entre-soi, une forme d’archipélisation, qui rend impossible toute confrontation sereine des idées, pourtant essentielle à la compréhension du monde. Ces établissements ne peuvent demeurer des îlots d’hégémonie culturelle de la gauche et de l’extrême gauche, coupés des équilibres politiques réels du pays. Selon une étude de l’institut Hexagone, plus de 60% des personnalités invitées par les associations étudiantes des IEP appartiennent à la gauche et à la gauche radicale, contre à peine 3% provenant de la droite et 0% de la droite radicale. Lorsqu’un certain séparatisme intellectuel s’installe et que le pluralisme se réduit, la contradiction est perçue comme une provocation inacceptable, qui pour certains justifie la violence voire de s’affranchir du tabou de tuer.
À Sciences Po Paris, en 2024, son directeur, Luis Vassy, avait pris une décision courageuse et nécessaire. Face à un risque sérieux de troubles à l’ordre public, il avait refusé que l’établissement serve de cadre à l’intervention de cette même Rima Hassan. La décision fut attaquée, mais le Conseil d’État la valida, rappelant que le chef d’établissement est le garant d’un équilibre fragile entre libertés et ordre public.
Il est désormais temps de passer aux actes face à la menace « antifa » au niveau français comme européen. Évidemment, nous souhaitons d’abord que l’enquête aboutisse rapidement et que la justice passe. Mais la situation exige aussi une action politique forte et déterminée. En juin 2025, Bruno Retailleau, alors ministre de l’Intérieur, avait pourtant dissous en conseil des ministres le groupuscule lyonnais La Jeune Garde – suspecté d’être impliqué dans l’agression de Quentin – fondé par une autre figure très controversée de La France insoumise, le député Raphaël Arnault. Ce n’était bien sûr pas suffisant. La galaxie «antifa», tentaculaire, est constituée de différents groupes informels qui se recomposent en permanence et gravitent autour de partis politiques, dont LFI en France. En septembre de la même année, les États-Unis avaient désigné la mouvance « antifa » dans son ensemble comme une organisation terroriste, à l’échelle nationale comme internationale, à la suite de l’assassinat du militant conservateur américain, Charlie Kirk.
Début janvier 2026, Raphaël Arnault et Jean-Luc Mélenchon ont lancé un nouveau mouvement « antifa », baptisé «Éteignons la flamme-Génération antifasciste», une reconstitution de ligue dissoute à peine masquée, avec pour objectif de répondre à l’appel du leader LFI de mettre en pratique des «méthodes impactantes».
Au lendemain de ce nouveau drame, nous appelons donc le gouvernement français à se saisir enfin de la lutte contre la menace terroriste intérieure d’extrême gauche. Au regard de la gravité des faits, des menaces proférées et des intentions criminelles revendiquées par le mouvement «antifa», ses alliés et ses satellites, le gouvernement ne peut plus se contenter de condamnations de principe. Il doit examiner la qualification de ces milices au regard de la législation antiterroriste nationale et en tirer toutes les conséquences. Cela implique que, si les critères juridiques sont réunis, elles soient qualifiées et traitées comme des organisations terroristes, avec l’activation complète des dispositifs prévus par le droit en vigueur : poursuites spécialisées devant les juridictions compétentes, dissolution et démantèlement des structures, gel des avoirs, et engagement de poursuites pénales contre toute personne apportant un concours matériel, logistique ou financier à leurs activités.
Nous appelons aujourd’hui tous les mouvements politiques qui se reconnaissent dans notre civilisation européenne qui a fait de la démocratie son modèle, à l’affirmer clairement : l’extrême gauche est la menace existentielle pour notre démocratie.
Nous appelons l’État, les établissements d’enseignement supérieur et les collectivités territoriales à réexaminer urgemment les subventions publiques attribuées à des associations affiliées de près ou de loin au mouvement «antifa».
Nous appelons enfin le gouvernement et les députés français au Parlement européen, toutes forces politiques confondues, à se saisir d’une initiative résolue visant à inscrire la mouvance «antifa» et ses responsables sur la liste européenne des organisations terroristes, au regard de son idéologie mortifère pour l’Europe, notre civilisation.
Les signataires :
Édouard Bina (IEP de Lyon, promotion 2025), Jehanne Sakhi, (IEP de Lyon, 2024), Édouard Josse (IEP de Lyon, 2015), Nicolas Bauer (IEP de Paris, 2018), Robin Nitot (IEP de Strasbourg, 2022), Étienne Arsac (IEP de Saint-Germain-en-Laye, 2022), Baudouin le Roux (IEP de Paris, 2015), Rémi Tell (IEP de Paris, 2017), Marguerite Frison-Roche (IEP de Paris, 2019), Bertrand Moine (IEP de Paris, 2017), Amazigh Aichiou (IEP de Grenoble, étudiant), Léo Besnet (IEP de Paris, étudiant), Laura Pratt (IEP de Paris, étudiante), Louis Ducreux (IEP de Paris, étudiant), Manuel Gaboriau (IEP de Lyon, étudiant), Charles Pitre (IEP de Lyon, étudiant), Maxence Dupouy (IEP de Lyon, étudiant), Victor Marciniszyn (IEP de Lyon), Marc Santamaria (IEP de Grenoble, 2022), Frédéric Thibault (IEP de Lyon, étudiant), Victor Cote (IEP de Lyon, étudiant).

























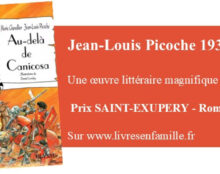

















![Le compte X de l’Ambassade de France auprès du Saint-Siège souhaite un bon ramadan [Addendum]](https://lesalonbeige.fr/wp-content/uploads/2018/09/islam-en-france-220x174.jpg)
![Le compte X de l’Ambassade de France auprès du Saint-Siège souhaite un bon ramadan [Addendum]](https://lesalonbeige.fr/wp-content/uploads/2018/09/islam-en-france-80x80.jpg)