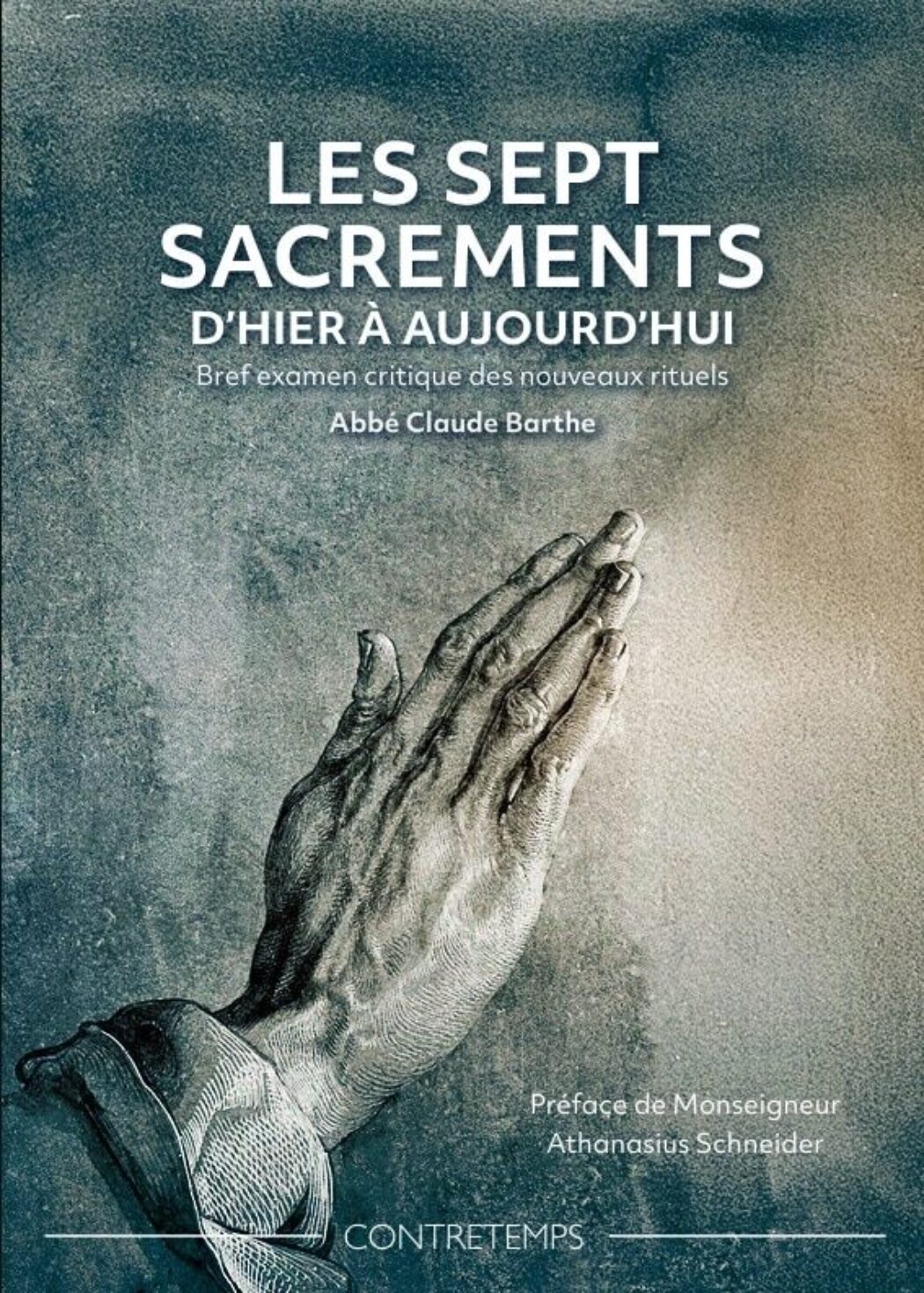Dans Res Novae, l’abbé Claude Barthe répond aux critiques formulées par l’abbé Spriet concernant son dernier ouvrage. Extrait :
[…] Je ne prétends pas que tout soit mauvais dans les nouveaux rituels (et notamment je ne conteste nullement leur validité, même si leur malléabilité extrême fait qu’en certains cas on peut se demander si la manière indécente dont ils sont interprétés ne manifeste pas que le célébrant n’a pas l’intention de faire ce que veut l’Église). « La grâce suinte ou ruisselle à travers les décombres de la liturgie détruite », disait Mauriac quelque part dans son Bloc-Notes. Le bouleversement a touché chacun d’eux, à des degrés divers, et tous, comme la nouvelle messe, souffrent d’un amoindrissement de signification. Ainsi, le vice du nouveau missel est-il d’exprimer plus faiblement, en comparaison avec le missel qu’il a prétendu remplacer, le caractère sacrificiel de l’Eucharistie, mais aussi la spécificité du sacerdoce hiérarchique, la transcendance de l’action qui s’y déroule, l’adoration due à la présence réelle. De même, l’ensemble du nouveau rituel du baptême affaiblit-il l’aspect de lutte du Christ contre le démon asservissant l’âme du fait du péché originel qui la souille ; le nouveau rituel de l’onction des malades dévalue le sacramentum extremæ unctionis en une célébration pour personnes âgées. Il y a non pas négation, mais affaiblissement – et cela seul est considérablement dommageable – des arêtes du dogme. Certes, à des degrés divers : le nouveau rituel du mariage verse dans les formules trop bavardes et évacue la grande bénédiction consécratoire de l’épouse ; mais le nouveau rituel de l’ordination appauvrit le symbolisme même de la cérémonie concernant les prêtres et évacue la couronne des ordres mineurs et du sous-diaconat.
La réforme liturgique a été totale, confectionnant, avec des éléments anciens mais à nouveaux frais, la messe, tous les sacrements, tous les sacramentaux. Immense bouleversement opéré en quelques années, dont il faut au minimum convenir qu’il ne fut pas un succès : la nouvelle liturgie n’a pas rempli les églises, ou à tout le moins elle ne les a pas empêchées de se vider. Au contraire, la liturgie ancienne qu’elle voulait remplacer et qui a survécu en maints lieux attire les jeunes fidèles, engendre les vocations, brille par ses pèlerinages. On objectera que ces considérations valent surtout pour l’Occident. Mais c’est à Rome qu’a eu lieu cette grande mutation cultuelle, au sein de cet Occident où l’ultra-libéralisme a triomphé dans les années même où s’est réalisée la grande démolition-reconstruction de la liturgie romaine.
La réforme de Paul VI est ainsi apparue aux analystes critiques et au public des fidèles – « on nous change la messe ! », « on nous change la religion ! » – comme donnant des gages à l’esprit du temps : tonalité plus immanente des cérémonies (face au peuple, emploi de la langue courante, évacuation d’un symbolisme trop traditionnel) ; distinction hiérarchique des ministres du culte et des fidèles laïcs, atténuée ; formes du respect vis-à-vis de la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie, atrophiées ; rappel des grandes vérités (la mort, le jugement) et dogmes « durs » (la messe comme sacrifice sacramentel, le péché originel empêchant l’accès de l’âme à la vision béatifique), adoucis.
Le rite se voulant immuable étant remplacé par un canevas sur lequel chacun brode selon son charisme, sa piété propre. Désormais, « il revient à la communauté de créer elle-même sa liturgie et non de la recevoir de traditions devenues incompréhensibles : la communauté se représente et se célèbre elle-même », disait le cardinal Ratzinger. L’« esprit » de Vatican II dont procédait ce culte rénové allait dans un sens tout opposé à celui des grandes réformes de l’Église qu’ont été ce qu’on appelle la « réforme grégorienne » ou la contre-réforme tridentine, avec leur restauration exigeante de la discipline, de la piété et de la formation du clergé, de la rigueur de la vie religieuse. Les thèmes des réformateurs de la liturgie d’après le Concile (équilibrer la « table de la Parole » et la « table de l’Eucharistie ; promouvoir la participation active des laïcs ; restaurer la concélébration, la communion à la coupe) étaient en dissonance de style, de spiritualité, de substrat théologique, avec ce qui avait été hérité du passé. Ces mutations ayant un parfum de catholicisme libéral en son dernier avatar, la Nouvelle Théologie que dénonçait Pie XII. Catholicisme libéral qui croit pouvoir faire certaines concessions à la modernité (liberté moderne, effacement des différences entre confessions, adoucissement des croyances qui « passent » mal) en caressant l’espoir – toujours déçu – de se voir reconnaître une place au sein du monde moderne. Les transformations rituelles représentaient ainsi une sorte d’« inculturation », certes modérée, médiocre comme on eût dit au XVIIe siècle. Sauf que la culture dont on se rapprochait était une non-culture.
Ce phénomène d’une réforme que je qualifie de libérale se double d’un autre : un catholicisme libéral subordonné, second par rapport au catholicisme réformateur, qui s’est développé chez certains traditionnels, qu’on pourrait qualifier de tradilibéralisme. La grande inquiétude de l’abbé Spriet – qui me prête assurément beaucoup trop d’influence – est que mon discours « intégraliste » sur la liturgie nouvelle en général et sur les sacrements réformés en particulier, exaspère les autorités ecclésiastiques et leur cache la bonne volonté de certains traditionnels qui, dans l’espoir – toujours déçu – de se voir accorder une certaine reconnaissance, sont prêts à certaines concessions, qu’ils parent de l’expression ratzinguérienne de « réforme de la réforme », qui veut dire pour eux réforme du rite traditionnel, ce que le terme même contredit, comme je le dirai plus loin. […]