Le contenu de cet article a été reproduit sous la forme d’une vidéo consultable ici :
L’association la Phalange Liturgique, qui vous partage cet article, vous propose aussi sur son site internet des articles semblables, tournant autour des thèmes de la liturgie, de la spiritualité et de la féminité catholique.
La messe est essentiellement un sacrifice pendant lequel le Christ se donne à Dieu le Père à la façon d’un culte. Au centre de la messe culmine cet acte par lequel le sacrifice de la croix, c’est à dire la mort de Jésus, vrai homme et vrai Dieu, est renouvelé mystiquement.
Le rite consécratoire, rend le sacrifice de la croix sacramentellement présent dans la liturgie de la messe.
Il convient surtout pour comprendre la messe, non pas d’en comprendre les cérémonies qui ne sont que le contenant, mais surtout d’en comprendre l’esprit et l’acte, surtout, autour duquel cet esprit gravite.
Il y a deux sacrifices. Le sacrifice de la Croix, c’est la mort de Jésus en l’an 30, mort douloureuse, mort sanglante, la mort de laquelle suit la Résurrection, la mort pendant laquelle les péchés du monde sont expiés.
L’autre sacrifice, c’est celui de l’autel, celui qui se produit à chaque messe. Il n’est pas douloureux, il se produit après la Résurrection.
Ainsi, le Christ hérite déjà de son corps glorieux, donc immortel. Le sacrifice de l’autel peut ainsi se reproduire à l’infini, en tout temps et tout lieu, et pour cause, Jésus ne meurt plus. On parle pourtant de sacrifice. À l’autel, en effet, le sacrifice de la croix est rendu présent, mais d’une manière toute particulière.
Donc le Sacrifice de la Croix est rendu présent d’une manière sacramentelle à l’autel. Alors que le sacrifice de la croix est réalisé d’une manière physique.
Une mort physique réelle, (mystique veut dire réel aussi, mais sous un autre rapport), mais il y a une mort qui est physique, qui est douloureuse, qui est sanglante.
De l’autre côté, il va aussi y avoir un aspect physique à l’autel, mais qui n’est pas immédiatement le Sacrifice.
On pourrait avoir un aspect physique également, physique et mystique, des deux côtés. Physiquement, à l’autel, il y a la transsubstantiation.
Vous avez le corps et le sang qui se trouvent entre les mains du célébrant mais l’essentiel de la messe, ce n’est pas cela.
C’est certes une caractéristique essentielle de la messe, que la consécration et la transsubstantiation se fassent. Mais il faut le rappeler, s’il n’y a pas de sacrifice, s’il n’y a pas de transsubstantiation et le corps de Jésus, ce n’est que la matière du sacrifice.
Le sacrifice de la croix est reproduit d’une manière cependant mystique sur l’autel, mais c’est le même sacrifice. Il n’est pas produit de la même manière, mais c’est le même.
Le sacrifice qui est reproduit ne l’est pas au moyen d’une imitation ou d’un mime. Il y a une unité, une certaine forme d’égalité entre sacrifice de l’autel et sacrifice de la croix.
Il est certain, cependant, qu’il existe une certaine forme de dépendance. Le sacrifice de la croix est le premier dans le temps, évidemment. Et si le sacrifice de la croix n’avait pas été consommé, le sacrifice de l’autel ne pourrait pas être réalisé.
Ce qui fait le sacrifice de la croix, je répète un peu, c’est qu’il est physique, donc sanglant, douloureux, et il occasionne la mort.
À l’autel, le sacrifice est mystique, ainsi il ne peut pas être sanglant et il n’y a pas de mort.
Jésus ne meurt qu’une fois, ensuite c’est par une immolation mystique qu’il se donne en victime.
Une immolation mystique, comme Jésus est mystiquement lié au membre de son corps qui est l’église.
Comme la Bible, bien qu’elle ne contienne que des mots humains, est véritablement, mystiquement, la parole de Dieu agissant dans les âmes.
La notion du Mystique
Mystique et physique sont deux aspects du réel. Mystique ne veut pas dire pas symbolique.
Il y a aussi, à l’autel un symbole du fait que le sacrifice de la croix se retrouve sur l’autel.
D’ailleurs, l’autel est orné d’une croix, qui est son centre, le sacrifice de l’autel signifie aussi le sacrifice qui fut accompli en l’an 30.
Mais dans le même temps, il le reproduit, il l’actualise de sorte à le rendre véritablement réel au moment de la messe.
Le lien qui unit les deux sacrifices relève aussi, le mot important c’est aussi, du souvenir, du mémorial : On se souvient au moment de réaliser ce sacrifice à l’autel, du sacrifice de la croix.
Une erreur, serait de considérer qu’il n’y a que le souvenir et qu’il n’y a pas l’acte. Ça va être quelque chose qu’on entend beaucoup chez les modernistes, chez les protestants surtout (par exemple c’est ce qui exprimé dans la Présentation Générale du missel Romain en 1969, la définition de la messe alors ne faisait référence qu’au mémorial, et pas au sacrifice, sans doute une hérésie par omission, c’était là le point d’achoppement le plus clair dénoncé dans le Bref Examen Critique par les Cardinaux Ottaviani et Bacci, en 1970 ce document a été modifié pour réintégrer heureusement la mention de sacrifice réel).
Le Sacrifice selon matière Matière et Forme
Précisons un peu le propos en distinguant le sacrifice de la messe selon sa matière et sa forme. Un sacrifice consiste en l’oblation, c’est-à-dire l’offrande d’un objet.
L’offrande d’un objet et l’objet qui est offert sont formes et matières du sacrifice.
On doit voir cette dualité :
L’offrande d’un objet, « oblation rei » et « res oblata », la chose offerte.
Donc oblatio rei, ç’est l’acte qu’on pose, l’oblation de la chose.
Res oblata, c’est l’objet qui est offert, donc c’est uniquement la matière. En l’occurrence, la matière du sacrifice c’est la victime. D’un côté la victime, de l’autre l’offrande de la victime.
Pour le sacrifice de la croix particulièrement, on a bien sûr une matière et une forme.
La matière c’est la victime, c’est Jésus. Pas seulement son corps, pas seulement son sang, mais aussi son âme, et donc toute son humanité.
La forme, l’oblatio rei pour le sacrifice de la croix, c’est donc l’offrande de cette victime.
Elle est offerte par une immolation (c’est la mort). La mort c’est l’acte par lequel l’humanité de Jésus est offerte.
On retrouve la même chose dans le sacrifice de l’autel qui reproduit le sacrifice de la Croix.
La victime c’est l’humanité de Jésus Christ, rendue présente de manière mystique. La forme c’est donc l’oblation mystique.
Dans l’aspect physique de la messe, on va donc retrouver au moment d’offrir les oblats, les hosties qui pour l’instant n’ont rien de spécial.
Au moment de la Consécration, l’humanité de Jésus Christ est véritablement présente (et physiquement par la présence réelle et mystiquement par l’actualisation du Sacrifice). Et on va avoir donc les paroles de la consécration qui sont encore l’offrande de cette humanité de Jésus Christ. Noter ainsi que la matière du sacrifice de l’autel ce n’est pas la présence réelle, mais la présence mystique. La présence réelle est physique, en théorie et avec des gros guillemets, la messe pourrait être sans la présence réelle, Jésus aurait pu instituer la messe d’une autre façon, qui ne ferait pas intervenir la transsubstantiation.
Il y a en outre une analogie entre l’aspect physique et l’aspect mystique de la messe. Entre la matière mystique et la matière physique.
L’offrande c’est l’acte, l’objet c’est la victime. Sans l’un ou sans l’autre, il n’y a aucun sacrifice. Le sacrifice ne consiste pas dans une victime. Le sacrifice ne consiste pas en ce que le corps du Christ soit juxtaposé et soit présent à côté du calice, le calice du sang. D’ailleurs c’est une question qui est posée par saint Thomas : « Y a-t-il un sacrifice lorsque les deux espèces, le corps et le sang, sont juxtaposées ? » : Bien sûr que non. Il faut qu’il y ait cet acte qui pourrait-on dire les lie ensemble. Il faut qu’il y ait cette offrande mystique pour rendre la messe efficace.
Une erreur très commune consiste à dire que le but de la messe c’est la transsubstantiation, pour produire la Communion.
Cela nous amène à cette erreur très commune La Consécration rend ainsi présent non seulement le corps et le sang du Christ mais aussi et surtout son oblation.
Avec des guillemets, on pourrait donc dire que la présence mystique et physique du corps de Jésus pendant le sacrifice de l’autel est quelque chose de tout à fait secondaire au rapport de l’acte qui est posé au même moment.
Une erreur très répandue à travers tous les âges chez les modernistes mais aussi beaucoup dans la tradition, serait de considérer la messe comme un pieux rituel où le prêtre exerce son pouvoir de changer le pain au corps et le vin au sang du Christ. Un rite productif de communion, une cérémonie destinée à nous assurer des hosties consacrés pour remplir nos ciboires et garnir nos ostensoirs.
Pourtant, le culte public de la Sainte Réserve Eucharistique n’est pas du tout d’institution divine mais ecclésiastique. Il est à l’origine une réaction aux hérésies de Tanchelin qui affirmait au XIe siècle que les hosties perdaient leur consécration après la messe.
On commence donc à instituer un culte public, avant il n’y avait qu’un culte privé de la Sainte Réserve. Ainsi apparaissent progressivement les tabernacles (la sainte réserve prenait par le passé d’autres formes, par exemple les tours eucharistiques, un orifice perçu dans le mur de l’abside, sur le côté du sanctuaire, et qui n’était donc pas bien visible par les fidèles, et pas proposé à leur adoration) et les processions au saint Sacrement.
« Il n’y a en effet aucune comparaison à établir entre une courte messe basse où le sacrifice même de notre rédemption est rendu présent où le Christ, souverain prêtre, enferme toutes ses énergies adoratrices à la gloire du Père, tout son rayonnement de vie et de sanctification pour nous.
Et un salut ou une procession, si solennel soient-ils, où nous, pauvres pécheurs, couvrons la sainte Hostie de nos humbles adorations humaines, toujours déficientes, si ferventes soient-elles. »
Croegaert
La Place central qu’occupe la Consécration dans l’économie liturgique de la messe
Il n’est pas étonnant dès lors que le rite consécratoire, tel la pierre dans la bague, occupe une place centrale dans l’ « économie liturgique » du sacrifice.
Celle-ci vise nettement à un certain équilibre entre les rites et les formulaires pré et post consécratoires du canon de la messe. Par exemple, la scission (potentielle) du sanctus et du benedictus, avant et après la consécration, entoure celle-ci d’un cadre mélodique homogène.
Encore par la symétrie des deux memento, des vivants avant, et des mort après la Consécration. Des deux diptyques aux listes de saints Communicantes avant la Consécration et Nobis quoque peccatoribus après. Des signations rituelles : pendant le canon 3 + 5 signes de croix avant la Consécration et 5 + 3 après.
Enfin la mise en relief du rite consécratoire lui-même, par les deux élévations accompagnées de sonneries des clochettes, de la cloche, dans le silence impressionnant de la foule, qui interrompt le chant du sanctus et abandonne la station de bout du canon pour la génuflexion et l’adoration.
Bien plus encore, d’une part toute la liturgie de l’Offrande du pain et du vin, jusqu’à la secrète, est subordonnée à la consécration, parce qu’elle en constitue la préparation.
D’autre part, toute la liturgie de la Communion, depuis la fraction jusqu’au post communion, est subordonnée à la consécration, parce qu’elle constitue la participation plénière du célébrant et des fidèles à l’oblation du sacrifice eucharistique qui a lieu en la Consécration.
La liturgie des trois parties essentielles de la messe suit au rapport de leur intensité une sorte de parabole (géométrique), avec l’Offertoire, la Consécration, la Communion. Et tous les artifices liturgiques, toutes les figures de style liturgiques participent à mettre en relief ce moment unique de la Consécration.
Une vidéo produite par l’association qui reprend le contenu de cet article :
Louis Djeddi, la Phalange LiturgiqueCet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.


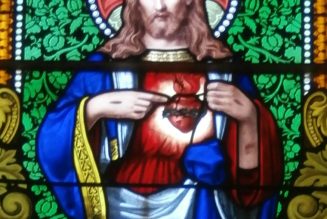

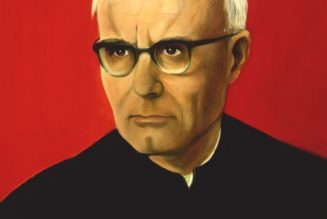


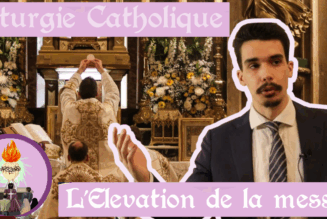

TontonJean
Très long article, lorsque l’on arrive à la fin, on ne se rappelle plus du début.
-La crucifixion de Jésus eut lieu en l’an 33. L’an 30 est le début de Sa vie public après les noces de Cana: “Faites ce qu’Il vous dira”.
-De quel rite de Sacrifice parlez-vous? Le rite extra-ordinaire ou le rite ordinaire? Ce dernier rite étant qualifié “d’équivoque”. “Que votre OUI, que votre NON soit non, tout le reste vient du démon”. Pour moi, ce qui est trouble ou équivoque n’est pas dans la Vérité!
LaPhalangeLiturgique
Bonjour,
Je ne parle que du rite romain traditionnel, je ne connais pas le rite moderne.
Trophyme
Selon Talleyrand : “tout ce qui est excessif est insignifiant”, on dirait aujourd’hui “pas sérieux”. Cet aphorisme vient à l’esprit quand on lit sous votre plume, cette énormité : “Avec des guillemets, on pourrait donc dire que la présence mystique et physique du corps de Jésus pendant le sacrifice de l’autel est quelque chose de tout à fait secondaire au rapport de l’acte posé au même moment.”.
Or, pour prétendre à une théologie digne de ce nom, il est indispensable d’avoir le sens de la mesure, de la pondération, de la nuance.
Ainsi, s’il est vrai qu’à la messe, le sacrifice a une priorité ontologique, cela ne signifie nullement que la présence de Notre Seigneur serait “tout à fait secondaire” même avec plein de guillemets ! C’est si énorme qu’on s’étonne que Mr Janva ait laissé passer une telle impiété, puisque la présence réelle et substantielle de Notre Seigneur est la finalité du Sacrifice de l’autel.
Voici une lointaine comparaison (certes maladroite mais qui fait saisir l’énormité de votre assertion) : ce n’est pas parce que la mastication de vos repas est préalable à leur digestion, que celle-ci est tout-à-fait secondaire !
Trophyme
Il convient toutefois de vous féliciter pour votre recherche et ce texte, car, d’une part, malgré son amateurisme, il est globalement juste au plan théologique, d’autre part, il traite d’un sujet capital trop méconnu des fidèles. Espérons donc que, pour l’édification des lecteurs, vous pourrez corriger la phrase épinglée, qui fait l’effet d’une tache de sauce sur une nappe blanche…
Un détail concernant le terme “mémorial” : ce mot a un sens précis en théologie catholique. Vous semblez l’ignorer car vous l’employez en son sens protestant, où il est synonyme du terme “souvenir”. Pourquoi n’étudiez vous pas cela avant votre article où sa place est capitale puisque le prêtre reprend ces paroles de Notre Seigneur : “Haec quotiescumque feceritis, in mei memoriam facietis”, traduction littérale: “… que vous ferez en mémorial de moi” ? En voici une définition classique (les détails sont entre parenthèses afin d’éviter les ambiguïtés) :
Le mémorial liturgique (catholique) est un rite rappelant l’événement du salut (= la mort de N.S.J.C., événement historique passé une fois pour toutes) afin que les participants (au rite, c-à-d les fidèles à la messe) en revivent la grâce propre, et ainsi avivent (renouvellent) leur espérance que ce salut s’accomplira parfaitement un jour dans la gloire.
Le rôle du mémorial (liturgique) est donc d’actualiser cet événement unique de l’Histoire du Salut, en représentant sacramentellement (de façon rituelle non sanglante) le Sacrifice (sanglant) du Calvaire, dans le but de permettre à chaque catholique (par sa communion quelques instants après) d’y participer, quelque soit le lieu ou l’époque, et ainsi (en particulier) de voir que ce Salut vient à lui personnellement.
Autrement dit, le mémorial (au sens catholique) inclut intrinsèquement le Sacrifice, sous une forme qui lui est propre, et que N.S.J.C. a voulu exprimer lui-même précisément pour que personne n’en puisse douter.
Louis, en théologie, fiez vous à Notre Seigneur et ses saints plutôt qu’à Luther et ses suppôts !
Trophyme
Cette phrase “La présence réelle est physique, en théorie et avec des gros guillemets, la messe pourrait être sans la présence réelle, Jésus aurait pu instituer la messe d’une autre façon, qui ne ferait pas intervenir la transsubstantiation” contient en effet 3 propositions étrangères à la doctrine et à l’habitus catholiques.
Or, autant il faut encourager les jeunes gens désireux de comprendre davantage les mystères de la foi, autant il leur faut se former sérieusement en théologie auprès de maîtres compétents pour ne pas s’égarer, ce qui est ici le cas. On est gêné d’avoir à dire cela, et pourtant il le faut car, sur une telle pente, on lira bientôt que “avec des guillemets, Dieu aurait pu ne pas s’incarner, ne pas être ce qu’Il est, etc…”
Le SB engage ici sa responsabilité, en publiant sans les vérifier des contributions portant sur le domaine sacré de la foi catholique, comme s’il s’agissait de critique de cinéma ou de tout autre domaine où l’opinion est reine. La théologie catholique admet depuis toujours des positions diverses, mais toujours aussi l’orthodoxie d’une position est normée par la Sainte Écriture et la Tradition. Le fait d’écrire ce qui nous passe par la tête sans avoir l’humilité de le faire discerner par un magistère autorisé existe depuis longtemps : cela l’appelle le “libéralisme” (théologique). Et cela fait peur sur le SB.
Michel Janva
Non le SB n’engage pas sa responsabilité sur le domaine sacré de la foi, ou alors vous ne savez pas lire cette tribune libre (et cela fait peur). Oui le Bon Dieu aurait pu nous sauver sans envoyer son Fils, comme NSJC aurait pu s’incarner sans mourir sur la croix, et il aurait pu instituer la messe d’une autre façon. Je ne vois pas ce qu’il y a d’hétérodoxe à écrire cela, puisqu’il s’agit d’une façon d’insister sur la réalité du Saint Sacrifice.
Trophyme
L’objet de la tribune en cause est de présenter un aspect du mystère de la Sainte Eucharistie. On est donc autorisé à penser que, même sans le dire explicitement, son A. se place sur le terrain de la théologie catholique, comme plusieurs passages de sa contribution l’indiquent.
Or la théologie catholique est une science qui naît de la Révélation et se nourrit de la Tradition, lesquelles norment précisément son usage de la raison. On peut certes raisonner hors de ce cadre (ainsi les protestants ou les agnostiques par ex.) : il s’agit alors non de théologie mais d’une approche philosophique libérale, où les mystères sont un domaine d’investigation comme un autre, et où l’imagination de l’A. peut s’exercer sans contrainte.
C’est ce que vous soulignez en rappelant qu’il s’agit d’une “tribune libre” (alors qu’on parle d’un mystère chrétien !)… Et “libre” au sens maximal : l’A. serait entièrement libre d’écrire ce qu’il pense. Pourquoi pas, mais à condition de préciser que cet essai relève, non de la théologie (au sens catholique romain) mais d’une approche intrinsèquement “libérale” ou “naturaliste”.
Vous avez raison: je n’ai pas su lire cette tribune “libre”, et m’excuse de vous avoir fait peur.
Michel Janva
Non ça n’a rien à voir avec une approche intrinsèquement “libérale” ou “naturaliste”. Visiblement, vous ne connaissez pas la définition des termes, ni la rhétorique.
Trophyme
vous en oubliez : ni la théologie.