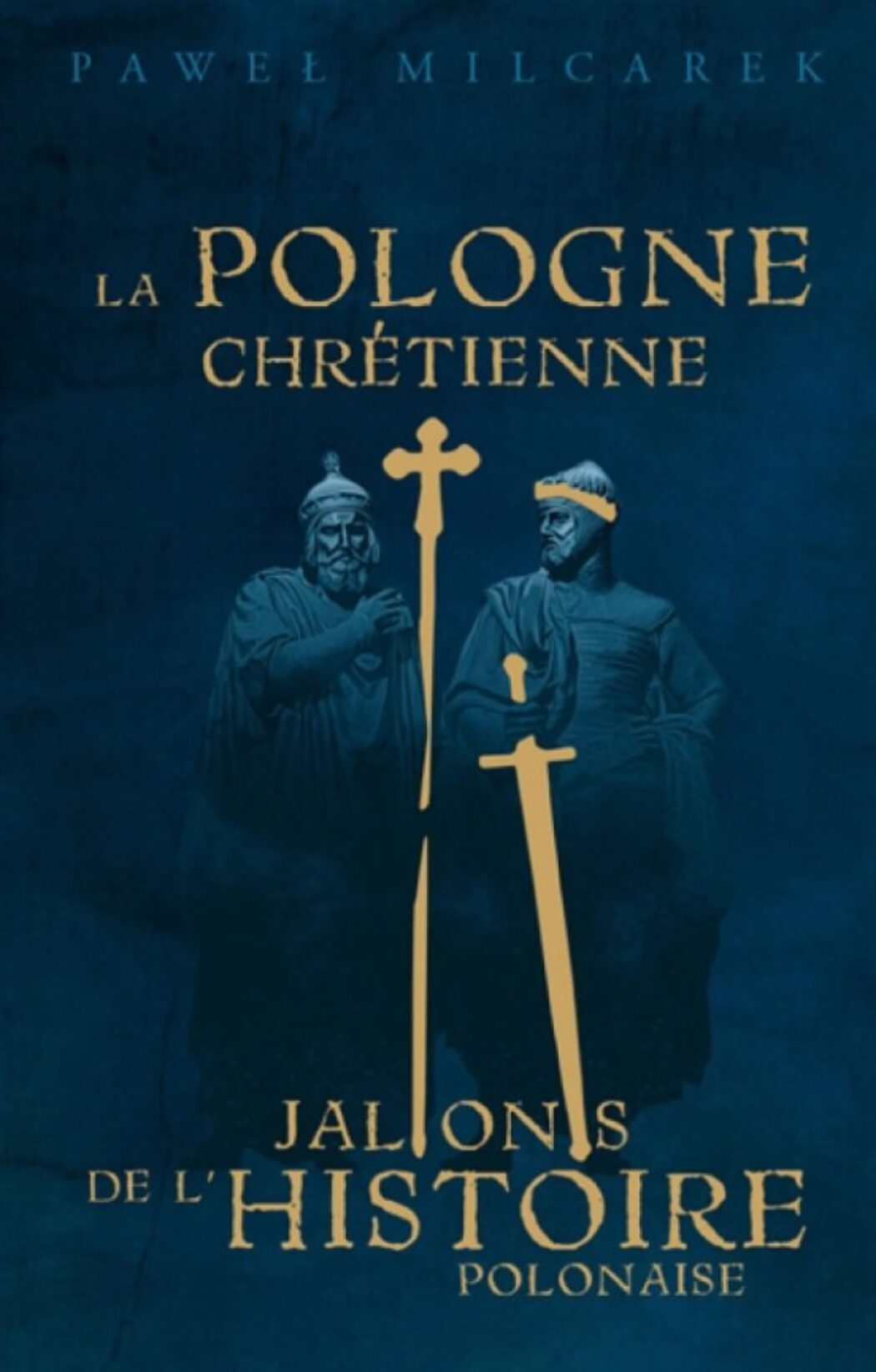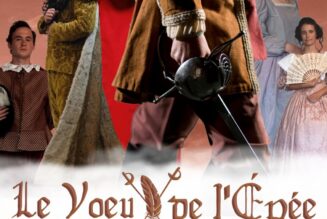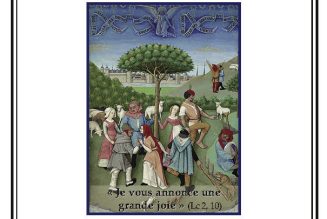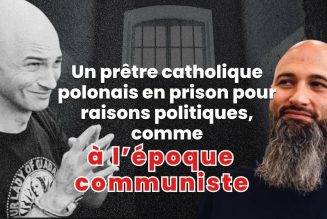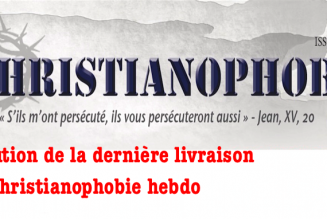Samedi, une centaine de milliers de Polonais défilaient dans Varsovie dans une mer de drapeaux blanc et rouge pour fêter les mille ans du couronnement de la Pologne et les 500 ans de l’hommage prussien. Le premier anniversaire se réfère au couronnement de Boleslas Ier le Vaillant en 1025, juste avant sa mort. Fils du fondateur de la dynastie des Piast, Mieszko, le premier roi de Pologne avait jusqu’alors porté, à l’égal de son père, le titre de duc. Si le baptême du duc des Polanes Mieszko en 966 donna naissance à la Pologne et marqua le début de l’histoire de ce pays, le couronnement de Boleslas et la transformation de l’État de Gniezno (première capitale) en Royaume de Pologne consacra son statut d’État indépendant sur la scène européenne, notamment face au Saint-Empire romain germanique voisin, mais aussi de son ancrage à l’Occident latin. Depuis l’an 1000, la Pologne avait déjà sa propre métropole ecclésiastique, fruit de l’activité missionnaire de Saint Adalbert et du soutien spirituel et politique des deux personnages les plus importants de l’Europe de l’époque : le pape et l’empereur. Le deuxième anniversaire commémoré samedi se réfère quant à lui à la transformation en 1525 de l’État monastique des chevaliers Teutoniques en duché de Prusse, vassal du Royaume de Pologne.
La manifestation de samedi avait une forte connotation politique. Les Polonais étant moins enclins que les Français à descendre dans la rue, rassembler une telle foule peut être considéré comme un grand succès pour les organisateurs et une marque de défiance vis-à-vis de la coalition gouvernementale, qui avait choisi de tourner ces commémorations en dérision et d’appeler ses partisans à venir manifester leur patriotisme pour soutenir leur candidat en mai, entre les deux tours des élections présidentielles. En pleine campagne présidentielle à l’approche de ces élections, c’est en effet le parti Droit et Justice (PiS) qui avait convoqué la manifestation du millénaire en l’absence de toute commémoration de la part du gouvernement européiste de Donald Tusk. La manifestation a toutefois rassemblé au-delà du PiS dans un contexte d’insatisfaction grandissante face à la politique de la coalition gaucho-libérale au pouvoir depuis décembre 2023 avec le soutien de Bruxelles (verbal, mais aussi financier, les fonds européens bloqués sous le gouvernement du PiS ayant été rapidement débloqués une fois Donald Tusk redevenu premier ministre) : inflation en hausse, début d’immigration massive avec les refoulements depuis l’Allemagne (acceptés par le gouvernement de Tusk qui ne contrôle même pas si les clandestins « refoulés » étaient vraiment arrivés en Allemagne depuis la Pologne) et entrée en vigueur l’année prochaine du pacte migratoire européen avec son programme de redistribution à grande échelle des migrants, répressions contre l’opposition et autres comportements ouvertement antidémocratiques au nom d’un supposé « rétablissement de l’État de droit ». Un État de droit qui aurait été mis à mal, d’après le camp gaucho-libéral et ses alliés bruxellois, par huit années de gouvernements conservateurs. Mais il y a aussi les attaques contre l’identité chrétienne de la Pologne et sa tradition de liberté, avec un nouveau programme d’éducation sexuelle à partir de septembre prochain qui sera en phase avec les scandaleuses recommandations de l’OMS pour l’Europe (https://lesalonbeige.fr/les-standards-deducation-sexuelle-voulus-par-loms-pour-nos-enfants/), une loi contre les « discours de haine » qui, on l’espère, va se heurter au veto du président Andrzej Duda, la réduction des cours de catéchisme à l’école en violation du concordat, le retrait des fonds qui avaient été alloués pour la construction d’un musée Saint Jean-Paul II, le maintien en prison pendant de longs mois du père Olszewski (https://lesalonbeige.fr/le-calvaire-dun-pretre-catholique-polonais-emprisonne-sans-jugement-par-leuropeen-donald-tusk/) et les mauvais traitements dont il fit l’objet au moment de son arrestation, les efforts pour interdire la grande Marche de l’Indépendance du 11 novembre (https://lesalonbeige.fr/les-liberaux-pro-ue-au-pouvoir-en-pologne-veulent-interdire-la-grande-marche-patriotique-annuelle-de-varsovie/), la circulaire du ministère de la Santé et celle du parquet pour forcer les hôpitaux et les médecins à accepter les demandes d’avortement quand celles-ci sont contraires à la loi et à la Constitution (qui ne les autorisent qu’en cas de danger pour la vie ou la santé physique de la femme enceinte lié à la grossesse ou quand la grossesse est issue d’un viol) etc. etc.
À un moment où les cercles bruxellois cherchent à pousser discrètement, avec le soutien de Berlin et Paris, une grande réforme des traités des traités européens qui transformerait cette fois véritablement l’UE en un super-État centralisé (https://www.valeursactuelles.com/societe/europeennes-la-reforme-des-traites-europeens-un-enjeu-majeur-des-prochaines-elections) et mettrait fin à la souveraineté des pays membres et, de fait, à la démocratie, ces efforts du gouvernement européiste de Donald Tusk pour déchristianiser la Pologne et la rendre plus multiculturelle (avec notamment 49 centre d’accueil de migrants en construction à travers le pays) ne sont pas une simple coïncidence.
La Pologne chrétienne
Pour comprendre à quel point identité polonaise et christianisme sont étroitement liée, et pourquoi une déchristianisation de la Pologne serait aussi sa dépolonisation, un petit ouvrage que j’ai eu le plaisir et l’honneur de traduire en français arrive à point. Intitulé : « La Pologne chrétienne – Jalons de l’histoire polonaise », il vient d’être publié à l’intention des lecteurs francophones par les éditions Dębogóra (https://debogora.com/), qui publie en polonais des auteurs français comme Jean Raspail, Jean Madiran, Vladimir Volkoff, Charles Maurras, l’historien Stéphane Courtois et d’autres encore. L’édition française de « La Pologne chrétienne – Jalons de l’histoire polonaise » est enrichie d’une introduction de l’auteur, l’historien polonais Paweł Milcarek, et aussi d’une très belle préface de Bernard Antony. Précisons encore que l’auteur et l’éditeur polonais sont deux francophiles épris de la vieille France catholique et qu’ils sont des visiteurs réguliers de l’abbaye bénédictine de Fontgombault. « Nous devons beaucoup à cette abbaye, y compris en matière d’idées de publications », m’expliquait il y a quelques années dans un entretien pour le regretté journal Présent (https://lesalonbeige.fr/la-culture-francaise-en-pologne/) Bogusław Kiernicki, le propriétaire des éditions Dębogóra. Précisons encore que Bogusław Kiernicki est un des organisateurs de la Marche nationale pour la vie qui se déroule chaque année à Varsovie.
La préface de Bernard Antony
Comme je ne saurais pas mieux que Bernard Antony parler de l’ouvrage de l’historien Paweł Milcarek ni même de cette Pologne chrétienne que j’aime tant pour y avoir vécu depuis maintenant plus de trente ans et surtout pour y avoir retrouvé la foi catholique et fondé une famille, je me contenterai de citer ici cette magnifique préface de cet autre amoureux de la patrie de Saint Jean-Paul II.
Préface de Bernard Antony à l’ouvrage « La Pologne chrétienne – Jalons de l’histoire polonaise »
Pour les nombreux Français qui aiment la Pologne et qui, quelquefois, comme moi, la considèrent comme une seconde patrie en déplorant de ne pas, hélas, en parler la langue, cette édition du très utile et très lumineux petit ouvrage de l’historien Paweł Milcarek sur la Pologne chrétienne constituera un précieux vecteur de connaissance autour de ces vingt-sept ou même vingt-huit « jalons » si bien identifiés. Par eux, on chemine au long de plus de mille ans d’imprégnation de son illustre nation par la religion catholique qui est au cœur et dans l’âme de son identité nationale. Ces jalons, Paweł Milcarek les égrène en effet superbement à la manière des méditations d’un chapelet, à partir de l’acte fondateur de sa patrie, le baptême en 966 de son premier souverain, Mieszko.
Notons ici d’emblée que, comme l’évoque Paweł Milcarek, ce baptême de Mieszko, duc de Pologne, constitua le « premier jalon d’or du christianisme en Pologne ». Car ne fut-il pas aussi, simultanément, le baptême de la Pologne ? Et ce, grâce à la farouche volonté catholique de Dubravka, la fille du duc de Bohême. Celle-ci n’avait-elle pas exigé impérativement que Mieszko soit baptisé, avant que leur mariage soit possible ? Ces deux sacrements successifs marquèrent ainsi l’entrée de la Pologne en Chrétienté ; et par la volonté de Mieszko et de Dubravka, leur royaume fut en effet placé sous la protection du Saint-Siège à Rome.
Chers lecteurs français de ces jalons de l’histoire chrétienne de la Pologne, vous allez par ces textes mesurer toute la densité de foi, d’héroïsme, qui, au long de plus d’un millénaire, a maintenu ce pays dans son être ; non sans qu’il soit traversé aussi par bien des vicissitudes, des tragédies, des défaites et encore des injustices et des trahisons. Mais vous allez peser aussi en quoi la Pologne a été non seulement un grand pays de chrétienté mais a constitué également, sous certains aspects très importants, une exception dans cette chrétienté : « l’exception polonaise », l’exception du pays « premier rempart de la chrétienté » ainsi qu’il en est traité dans le 18e jalon.
En première partie de son ouvrage, Paweł Milcarek expose le rôle majeur, dans l’éclosion de la civilisation, des moines de saint Benoît, obéissant jusqu’à nos jours à l’admirable Règle édictée par leur fondateur. Bénédictins et Cisterciens furent les bâtisseurs inlassables de tous ces monastères autour desquels se modela ce qui allait devenir, sans qu’ils l’aient recherché, l’Europe chrétienne.
On y lira ce qu’il en fut encore en Pologne de l’éclosion des Dominicains et des Franciscains. On y découvrira l’originale tentative de synthèse monastique menée par le père Ladislas Kornilowicz s’efforçant de joindre trois éléments : la vie liturgique bénédictine, le thomisme dominicain et la simplicité de vie franciscaine. Cette tentative, écrit l’auteur, ne fut pas vaine, puisqu’elle eut une influence durable sur la recherche intellectuelle de nombreux penseurs polonais. Mais, ajoute-t-il, « le gouvernement des âmes » du catholicisme polonais serait bien plus tard, pour une grand part, assuré par les Franciscains de Niepokalanów avec l’influence du mensuel « Le chevalier de l’Immaculée » de saint Maximilien Kolbe, tiré à un million d’exemplaires en 1939.
On lira les grands traits de la passionnante histoire de l’Union polono-lituanienne bâtie sur le mariage des deux pays et la christianisation de la Lituanie (XIVe et XVe siècle). Et aussi, le très plaisant rappel du splendide mariage à Cracovie, dans la cathédrale du Wawel, de Ladislas Jagellon avec Hedwige d’Anjou préalablement sacrée « roi de Pologne » – on lit bien « roi » ! Le titre était alors, fort justement, celui de la fonction. Le stupide féminisme révolutionnaire de notre époque ne déferlait pas comme aujourd’hui.
Particulièrement intéressantes sont les pages (10e jalon) consacrées à la doctrine juridique de l’Université Jagellonne de Cracovie. Elles prouvent combien, dans la très catholique « République des deux nations » ([la république nobiliaire] de Lituanie et de Pologne), on défendait, bien avant « l’idéologie des droits de l’homme sans Dieu », une doctrine très chrétienne d’inspiration thomiste du respect des droits de la personne humaine, stipulant notamment grâce à l’élaboration d’un droit international, de ne pas priver de leurs biens les infidèles vivant pacifiquement parmi les chrétiens. Les enseignements du recteur de l’Université Jagellonne, Paul Włodkowic, nullement à l’opposé de l’enseignement traditionnel de l’Église, s’inscrivaient alors en contraste avec les agissements brutaux des chevaliers Teutoniques prétendant imposer leur foi par la force. La doctrine de l’Université Jagellonne était à l’époque non pas celle de « l’humanisme » mais, nuance, celle d’un « humanisme chrétien ».
Le cadre d’une préface ne permet évidemment pas de développer tout ce que l’on peut tirer, jalon après jalon, des textes de Paweł Milcarek, admirables de par leur sens de l’essentiel et leur clarté. On y découvrira l’importance de l’œuvre des Jésuites en Pologne (du XVIe au XVIIIe siècle) collaborant particulièrement avec les missionnaires de saint Vincent-de-Paul. On y méditera sur le fait que si la « République des deux nations » ne fut pas épargnée par les divisions confessionnelles issues de la Réforme, la loi des bûchers ne l’emporta pas. On y lit comment, après le décès du dernier roi jagellon, Sigismond II Auguste, l’institution appelée « Confédération de Varsovie », instituée le 28 janvier 1573 par la Diète, élabora la grande charte de la tolérance polonaise. Cette charte sera alors constitutive du serment précédant leur couronnement que devront désormais jurer les rois élus. On lira l’anecdote sur les hésitations d’Henri de Valois lorsqu’il fut élu au trône de Pologne (1573). On méditera sur la différence, ultérieurement, entre la première République française et la première République polonaise. Alors que l’ère des guillotines, des pontons, des déportations, des grands massacres et colonnes infernales exterminatrices de la Vendée (atrocités que Lénine admirait tant) allait s’ouvrir chez nous, l’article 1er de la Constitution polonaise du 3 mai 1791 proclamait : « La religion catholique, apostolique et romaine est et restera à jamais la religion nationale, et ses lois conserveront toute leur vigueur. Quiconque abandonnerait son culte pour tel autre que ce soit, encourra les peines portées contre l’apostasie. Cependant l’amour du prochain étant un des préceptes les plus sacrés de cette religion, nous devons à tous les hommes, quelle que soit leur profession de foi, une liberté de croyance entière, sous la protection du gouvernement. »
Tout, bien sûr, ne fut pas parfait, idyllique, dans la Pologne chrétienne. Ainsi Paweł Milcarek regrette-t-il (15e jalon) la discrimination imposée à l’Église uniate par la hiérarchie latine. D’autant que, lorsque vint le mauvais temps de l’occupation par la Russie, celle-ci, précise Milcarek, considéra que « les Uniates étaient en fait des orthodoxes qu’il fallait libérer de leur soumission au pape ». Elle mit alors en œuvre contre les Uniates les pires violences qui firent bien des morts pour imposer la religion moscovite. Milcarek rappelle à ce propos que, plus tard, « en 1946, sur ordre de Staline, l’Église uniate devait être liquidée dans son intégralité ». Étrangement, à notre époque en France, il y aura eu certains catholiques d’extrême-droite ou de droite à avoir oublié cette abomination et qui ne furent nullement gêné de prodiguer le même soutien à Vladimir Poutine que des chefs syndicalistes communistes de la CGT tel, au mois de mars 2023, le leader marseillais Olivier Mateu.
Bien sûr, on lira dans les textes du 16e jalon ce qu’il en a été du « déluge suédois », dans l’été 1655, catastrophe venant après l’agression russe de 1654. Mais la description de cet épisode va nous amener au cœur du haut lieu spirituel de la Pologne, le monastère de Jasna Góra, sanctuaire abritant l’icône miraculeuse de la Vierge noire de Częstochowa, universellement connue.
Lecteurs attentifs de ce livre, vous vous pencherez tout particulièrement sur les pages du 18e jalon intitulé : « Premier rempart de la Chrétienté – La mission sarmate en Europe ». Rappelons que l’adjectif « sarmate » désigne la culture et les traditions de la noblesse polonaise entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Naturellement, l’historien Paweł Milcarek évoque-t-il dans la fin du XVIIe siècle ce sommet de la gloire polonaise que fut la victoire que le roi polonais Jean III Sobieski, non sans l’appui du duc Charles de Lorraine, remporta sur l’immense armée ottomane qui assiégeait Vienne, menaçant ainsi tout le reste de l’Europe. L’auteur rappelle que c’est le pape Innocent XI lui-même qui, dans une lettre au Sénat polonais en 1678, avait déjà qualifié la Pologne de « puissante et illustre fortification de la République chrétienne ». Hostile à toute emphase et toute enflure nationaliste, Milcarek observe avec un brin de plaisante autodérision patriotique que « dans l’idéologie du premier rempart, il n’est pas difficile de percevoir non seulement un trait de bravoure et le sens du devoir, mais aussi une tendance à la mégalomanie nationale ». Nous sommes plus indulgent que lui !
Après Vienne, les jalons fixés par Paweł Milcarek rentrent dans l’histoire moderne. Les limites de cette préface déjà longue nous imposent de nous en tenir à quelques idées essentielles que l’on dégagera de ces derniers textes : d’abord l’observation que le rationalisme, le positivisme, le laïcisme, le scientisme n’ont pas miné autant la société chrétienne polonaise que la française. Et, sans doute, le plus grand auteur polonais du XIXe siècle, le romantique Adam Mickiewicz, est demeuré avant tout un poète catholique ardemment patriote tel qu’évoqué par Milcarek. De même, lorsqu’en 1905 Henri Sienkiewicz reçoit le prix Nobel de littérature, c’est surtout son œuvre « Quo Vadis ? », la plus universelle car la plus chevillée à l’héritage antique et chrétien, qui lui vaudra sa juste notoriété.
C’est ensuite le siècle noir du face-à-face avec le communisme et le nazisme, également monstrueux, que Milcarek va aborder. D’abord, en dégageant remarquablement les données essentielles du contexte et du déroulement de la bataille de Varsovie jusqu’à la victoire, premier arrêt de l’avancée du communisme en 1920. Ensuite, la terrible période dans laquelle, écrit l’historien, citant les souvenirs d’un prêtre qui, séminariste, avait servi en tant que brancardier en 1920 et avait plus tard vécu l’invasion de 1939 : « le même ennemi de la Pologne, qui était en même temps l’ennemi du nom du Christ, tomba d’accord avec un autre envahisseur… » Accord, en effet, pour dépecer la Pologne après le diabolique pacte germano-soviétique dont le rappel est aujourd’hui interdit en Russie.
L’avant-dernier jalon, jusqu’à nous, de l’histoire de la Pologne, est titré : « Des rois sans couronne ». L’expression désigna bellement et pour des raisons évidentes le cardinal Stéphane Wyszyński, « le Primat du millénaire » (presque mille ans en effet depuis le baptême de Mieszko en 966).
Quant au 28e et dernier chapitre de l’ouvrage, il consiste, vous le verrez, en une émouvante interrogation de son auteur sur la destinée du « Petit journal » de sainte Faustine Kowalska : « Sera-t-il un jour cité comme un jalon ? Un jalon de l’histoire de la Pologne chrétienne dont la force des significations se dévoile dès à présent pour nous et pour les générations futures ».
Puisse Dieu faire que ce jalon ne soit donc pas le dernier !
Bernard Antony
À la lecture de ce magnifique et très accessible petit livre d’histoire, on ne peut s’empêcher de penser que, décidément, pour reprendre les paroles de l’hymne national polonais créé alors que l’État polono-lituanien, la République des deux nations, venait de disparaître à la suite du troisième partage entre les puissances voisine (Russie, Prusse et Autriche) à la fin du XVIIIe siècle, « la Pologne n’a pas encore péri, tant que nous vivons ». Ce « nous » désignant bien sûr les Polonais eux-mêmes. Mais l’on réalise aussi que si la Pologne devait un jour suivre les autres nations européennes dans la voie de l’apostasie, alors elle ne sera plus.
Petite précision intéressante pour conclure cet article : « la République » (Rzeczpospolita) en polonais a une connotation tout à fait différente de celle qu’on lui donne en France. De fait, Rzeczpospolita est synonyme de « Pologne », les républiques des autres pays étant appelées en polonais avec le mot d’origine latine « republika ». La république polonaise se dit ainsi Rzeczpospolita Polska tandis que la république française se dit Republika Francuska. Les Polonais parlent de leur Première République pour désigner l’ancienne république nobiliaire polono-lituanienne du milieu du XVe siècle jusqu’aux partitions du pays à la fin du XVIIIe siècle. La Deuxième République est la République de Pologne de l’entre-deux-guerres. Celle-ci ayant perduré pendant et après la deuxième guerre mondiale avec le gouvernement en exil à Londres, la Pologne communiste sous occupation soviétique était la République Populaire, tandis que la République de Pologne actuelle est la Troisième République.
Cet article est une tribune libre, non rédigée par la rédaction du Salon beige. Si vous souhaitez, vous aussi, publier une tribune libre, vous pouvez le faire en cliquant sur « Proposer un article » en haut de la page.